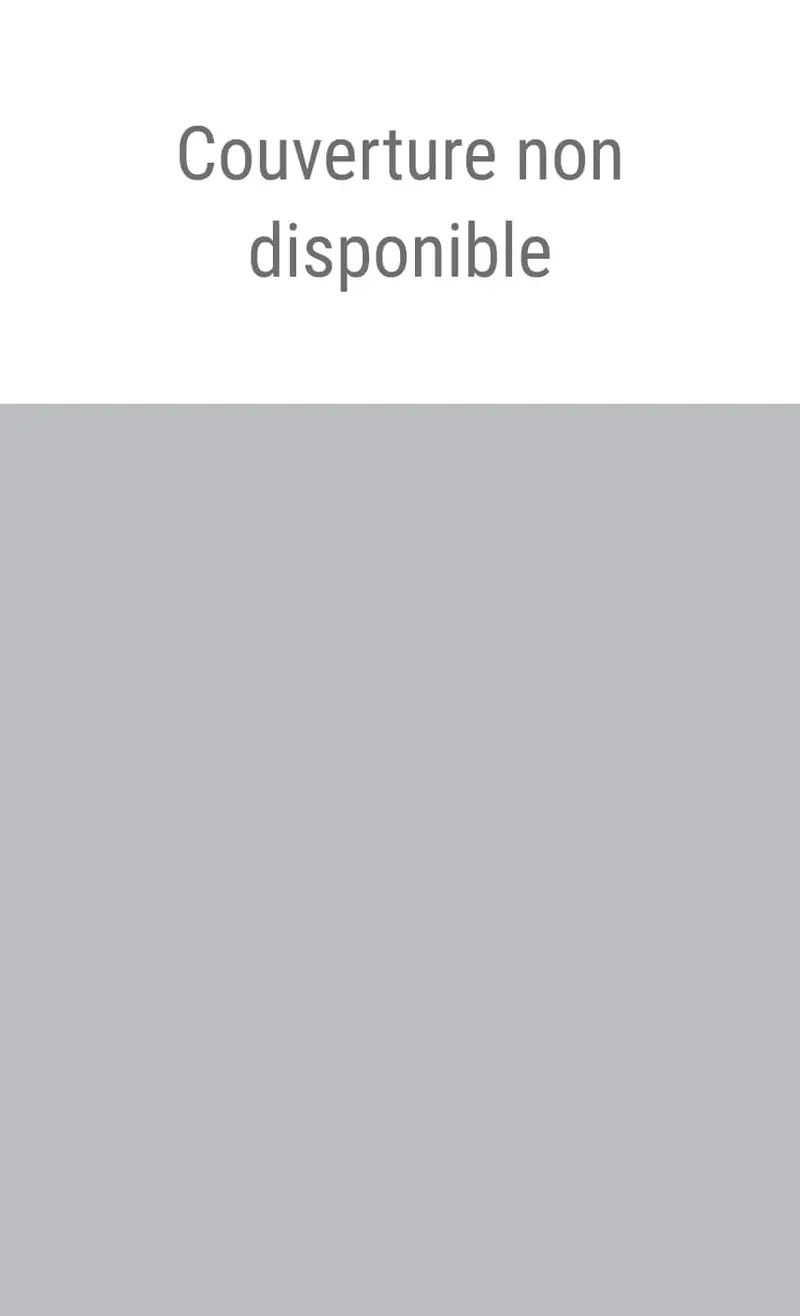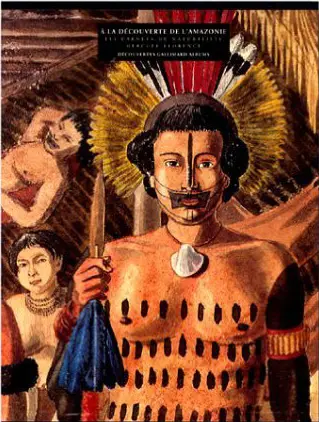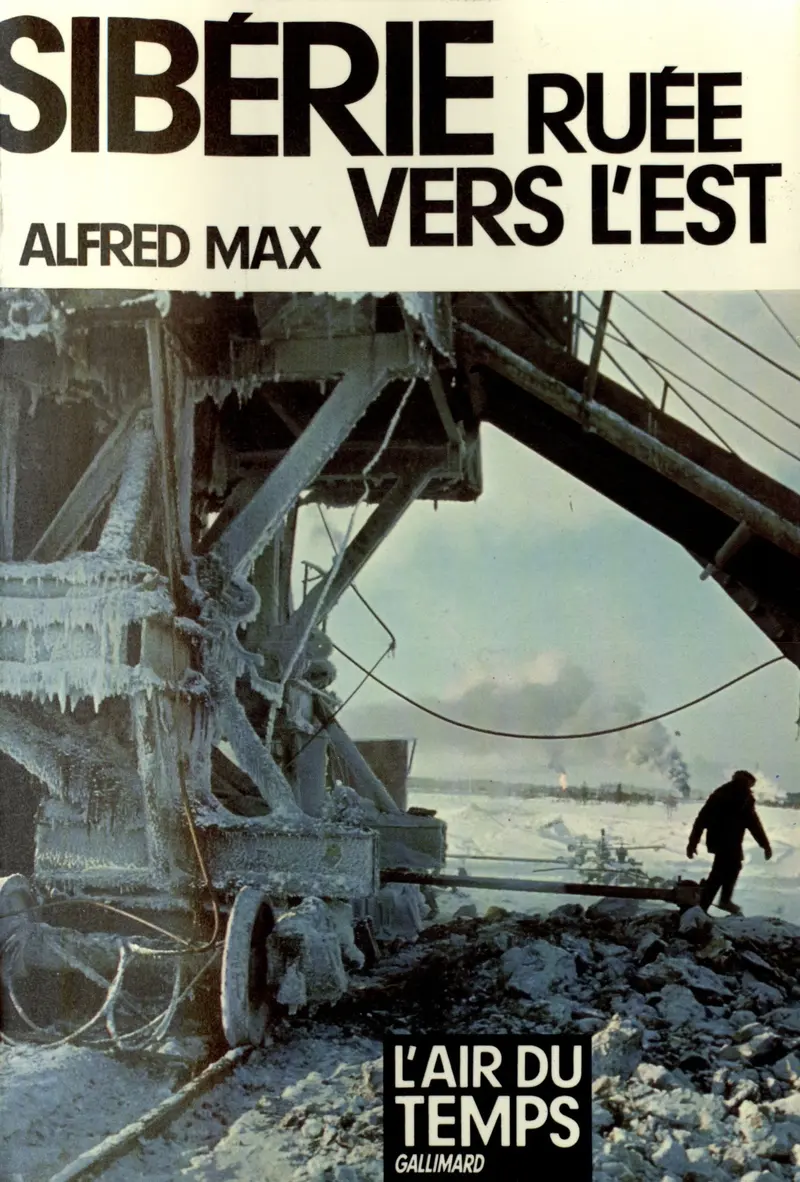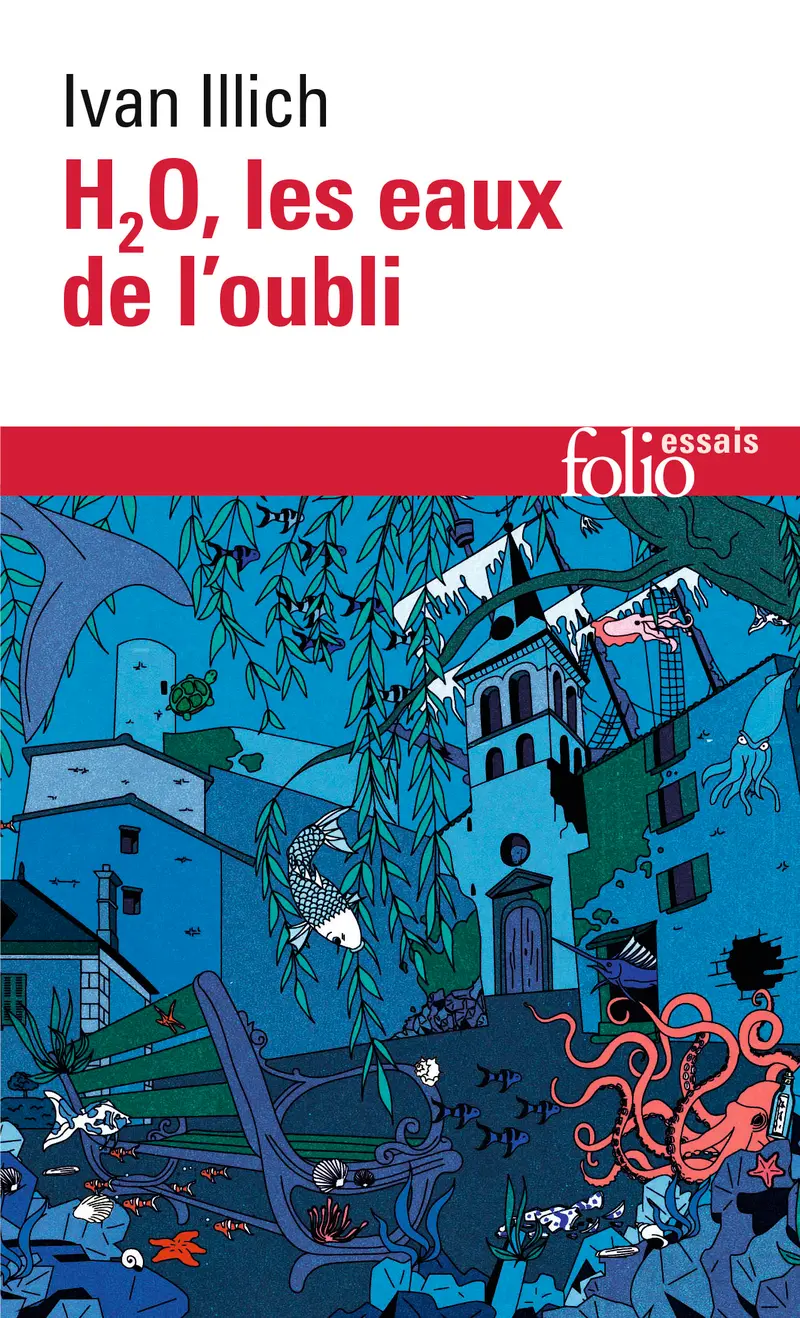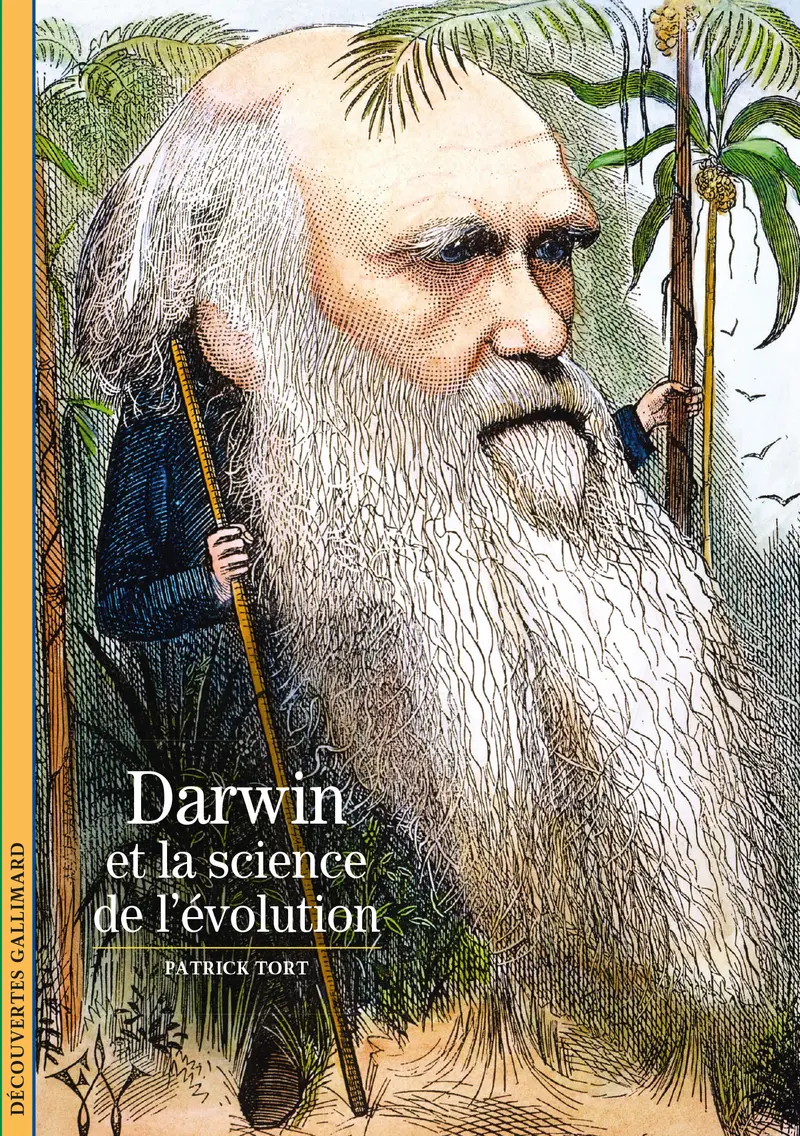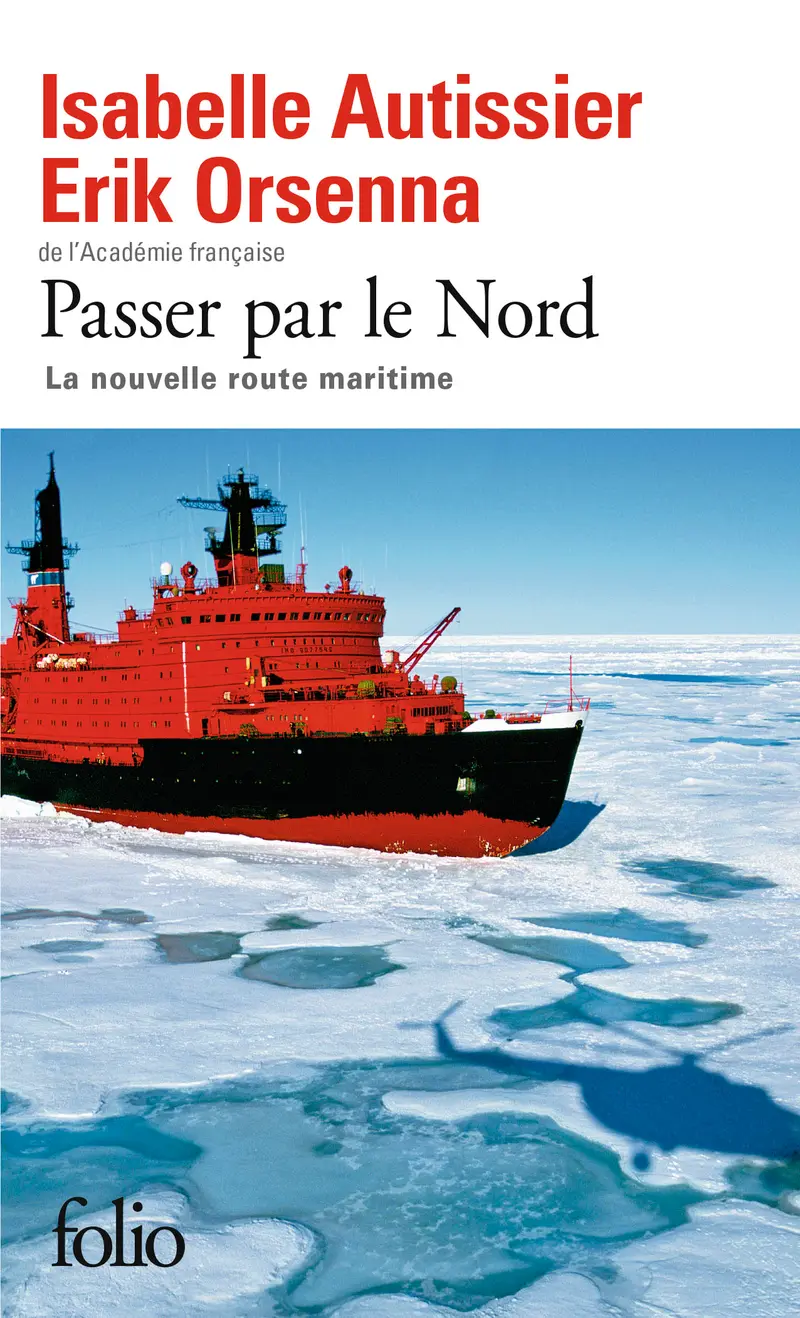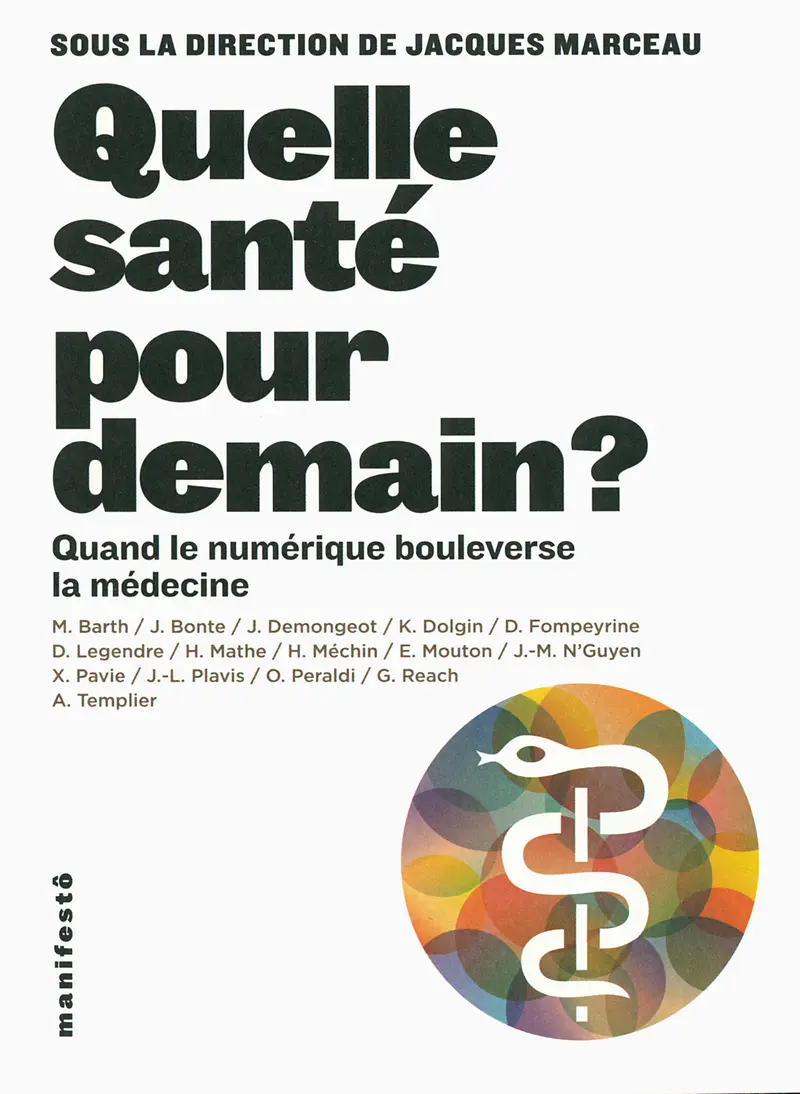La Provence et le comtat venaissin
Gallimard
Parution
L'histoire populaire de la Provence envisage la vie même de l'homme, sur lequel ont eu si peu d'action les révolutions de la «grande histoire». Dans la province la plus ancienne de la Gaule, dont la civilisation remonte à l'antiquité grecque et romaine, la découverte de la vie populaire est une œuvre d'historien : l'antique saisit le présent, ou du moins un passé si récent qu'il est d'hier. L'archéologie collabore à
l'enquête ethnographique : ainsi apparaît le génie de la race, qui échappe à l'investigation de l'histoire politique, administrative ou économique, dont le domaine est restreint aux apparences officielles.
L'homme de Provence est situé dans son cadre géographique. Celui-ci ne correspond point au cloisonnement du département, dont la division arbitraire n'est pas sensible dans le folkore, mais à la configuration du pays : Provence littorale et rhodanienne, où sont nées les villes, à la frontière de la province, Provence moyenne, correspondant au glacis des montagnes alpines, réservoir de population, où a subsisté le type de la race.
Ce sont là les deux visages du Provençal, attiré par la mer, mais resté terrien, l'esprit ouvert aux innovations venues du dehors, mais conservateur des traditions : dans sa vie matérielle, avec son habitation, son outillage, son costume, dans sa vie psychique, qui révèle, mieux qu'en nulle autre province, la pérennité de ses coutumes : fêtes et pèlerinages saisonniers aux saints protecteurs des travaux et des jours, usages de la vie sociale relatifs à la vie communautaire, à la naissance, au mariage, aux funérailles, croyances et rites traditionnels, langue enfin demeurée plus proche de la souche latine, qui a acquis ses titres de noblesse littéraire avec Mistral.
L'homme de Provence est situé dans son cadre géographique. Celui-ci ne correspond point au cloisonnement du département, dont la division arbitraire n'est pas sensible dans le folkore, mais à la configuration du pays : Provence littorale et rhodanienne, où sont nées les villes, à la frontière de la province, Provence moyenne, correspondant au glacis des montagnes alpines, réservoir de population, où a subsisté le type de la race.
Ce sont là les deux visages du Provençal, attiré par la mer, mais resté terrien, l'esprit ouvert aux innovations venues du dehors, mais conservateur des traditions : dans sa vie matérielle, avec son habitation, son outillage, son costume, dans sa vie psychique, qui révèle, mieux qu'en nulle autre province, la pérennité de ses coutumes : fêtes et pèlerinages saisonniers aux saints protecteurs des travaux et des jours, usages de la vie sociale relatifs à la vie communautaire, à la naissance, au mariage, aux funérailles, croyances et rites traditionnels, langue enfin demeurée plus proche de la souche latine, qui a acquis ses titres de noblesse littéraire avec Mistral.