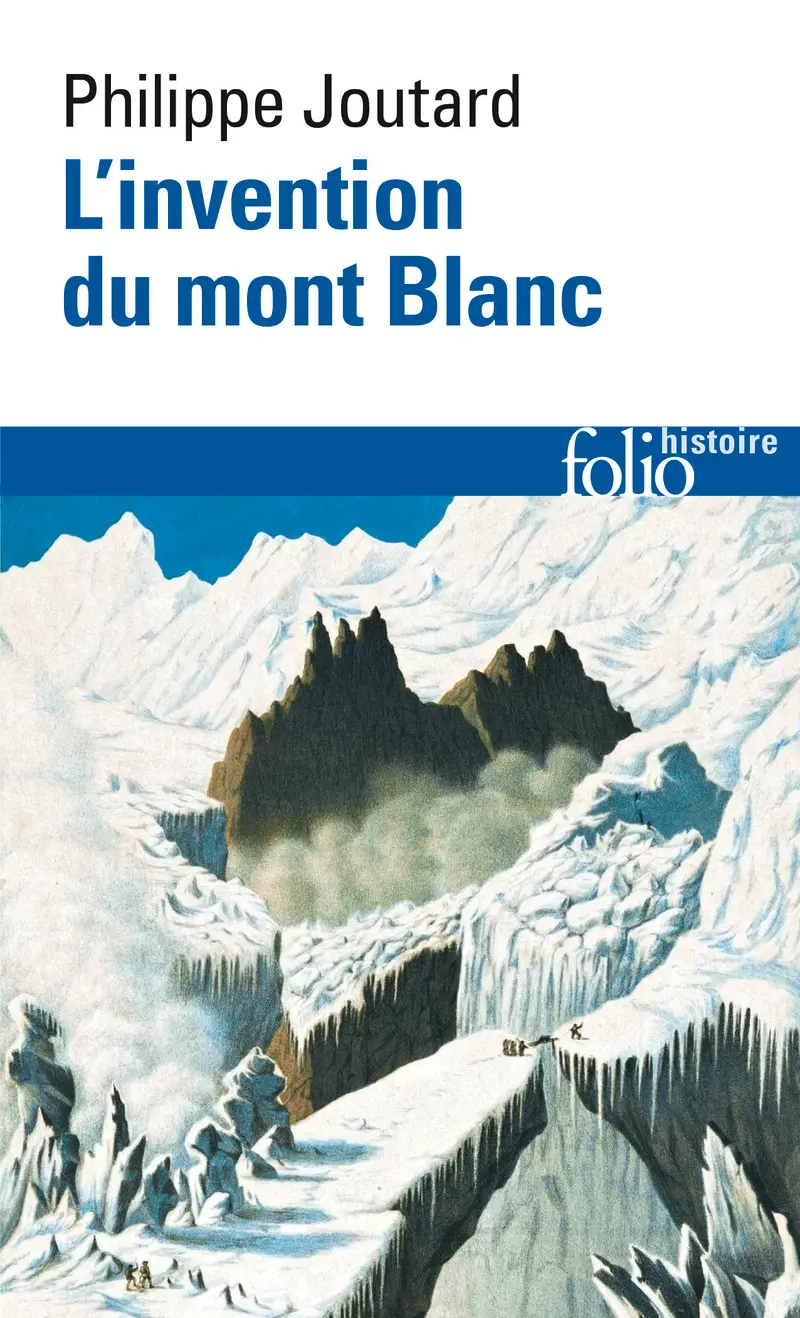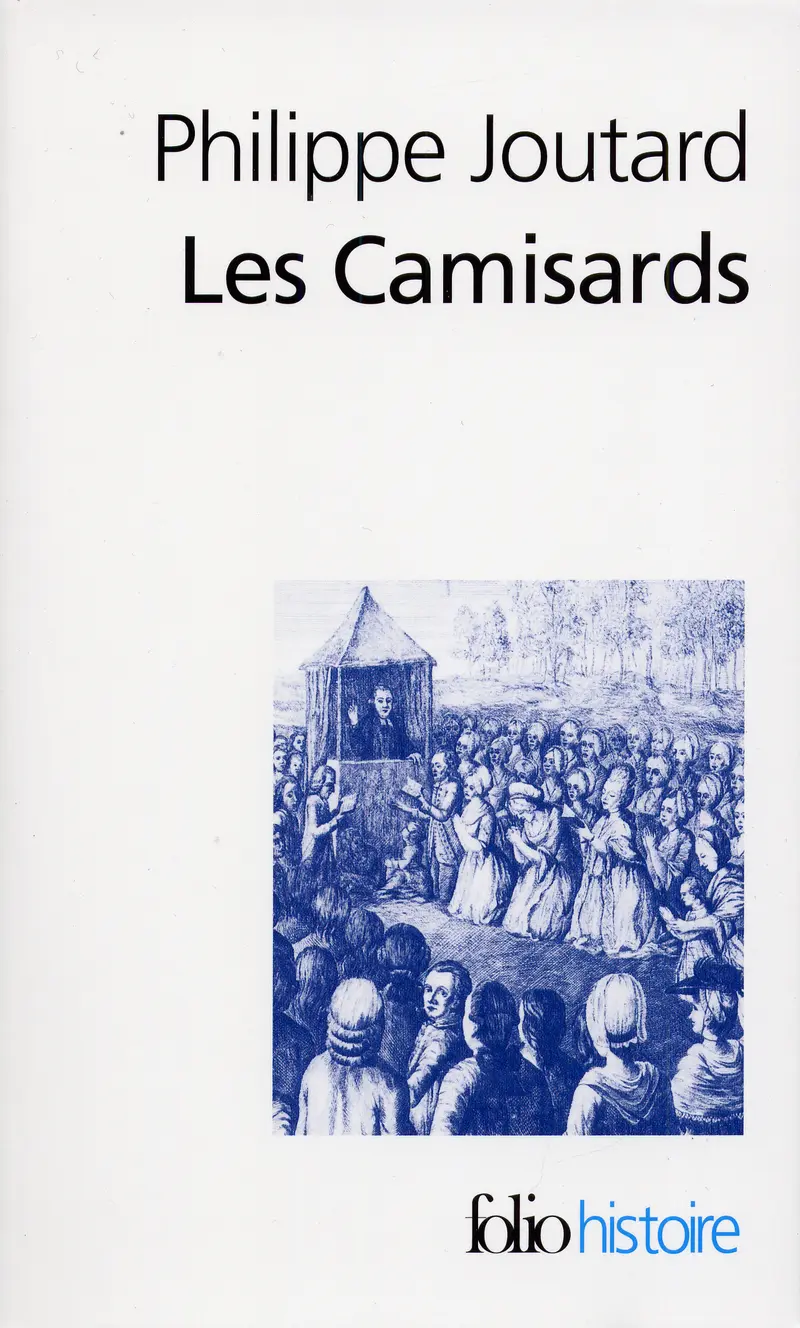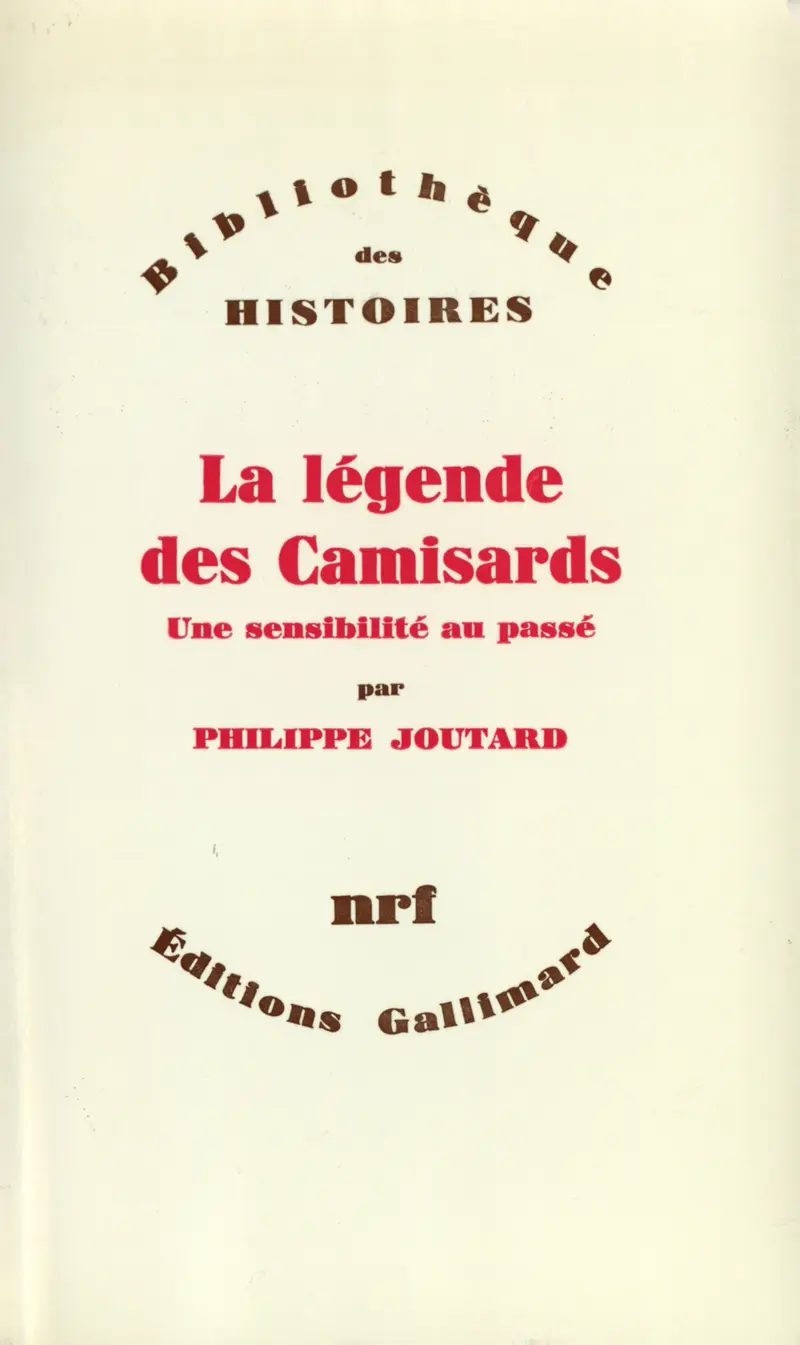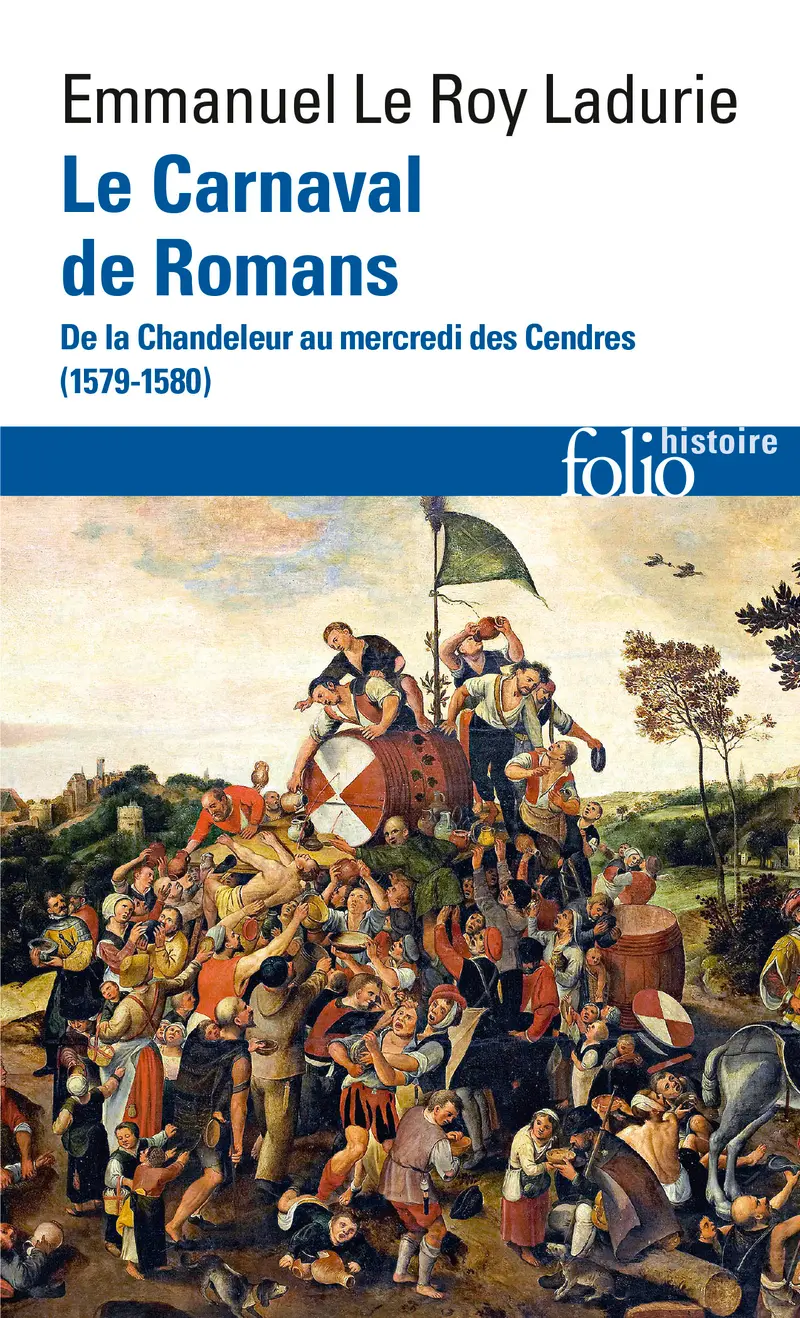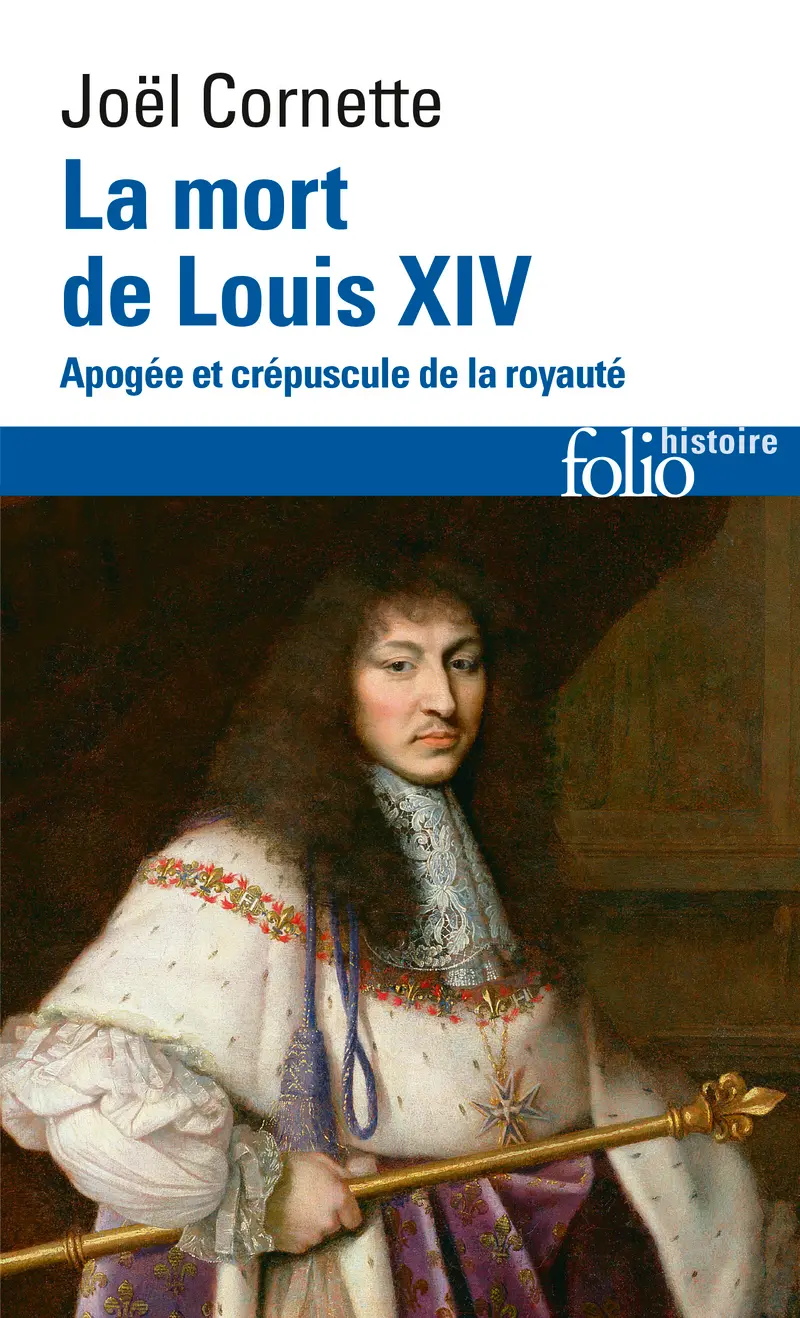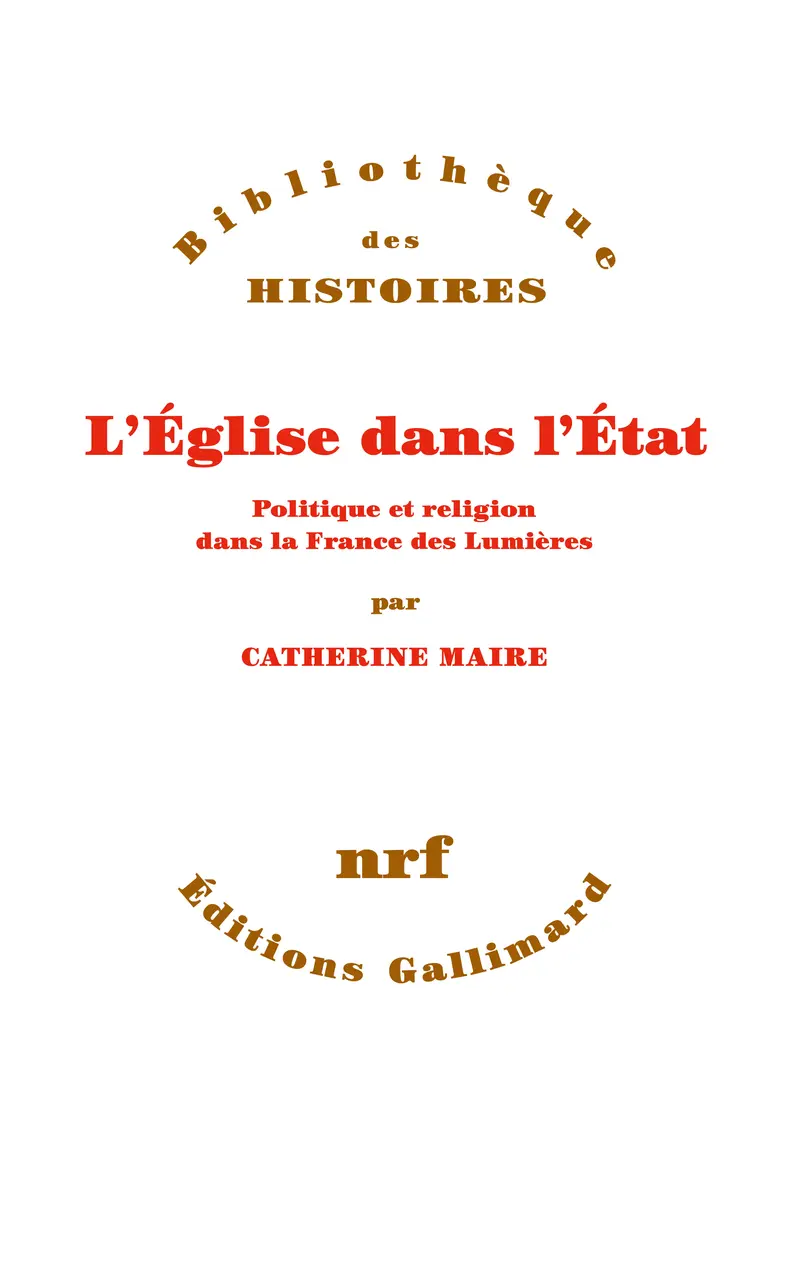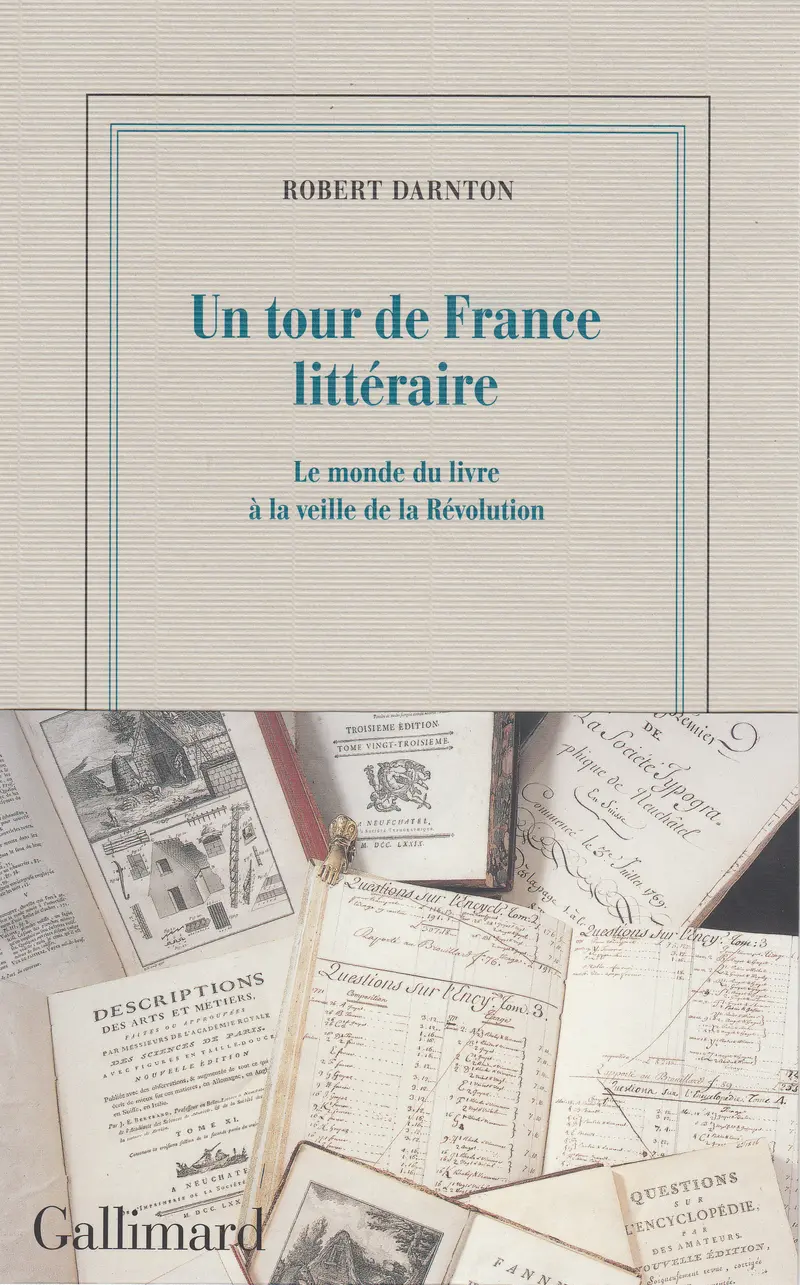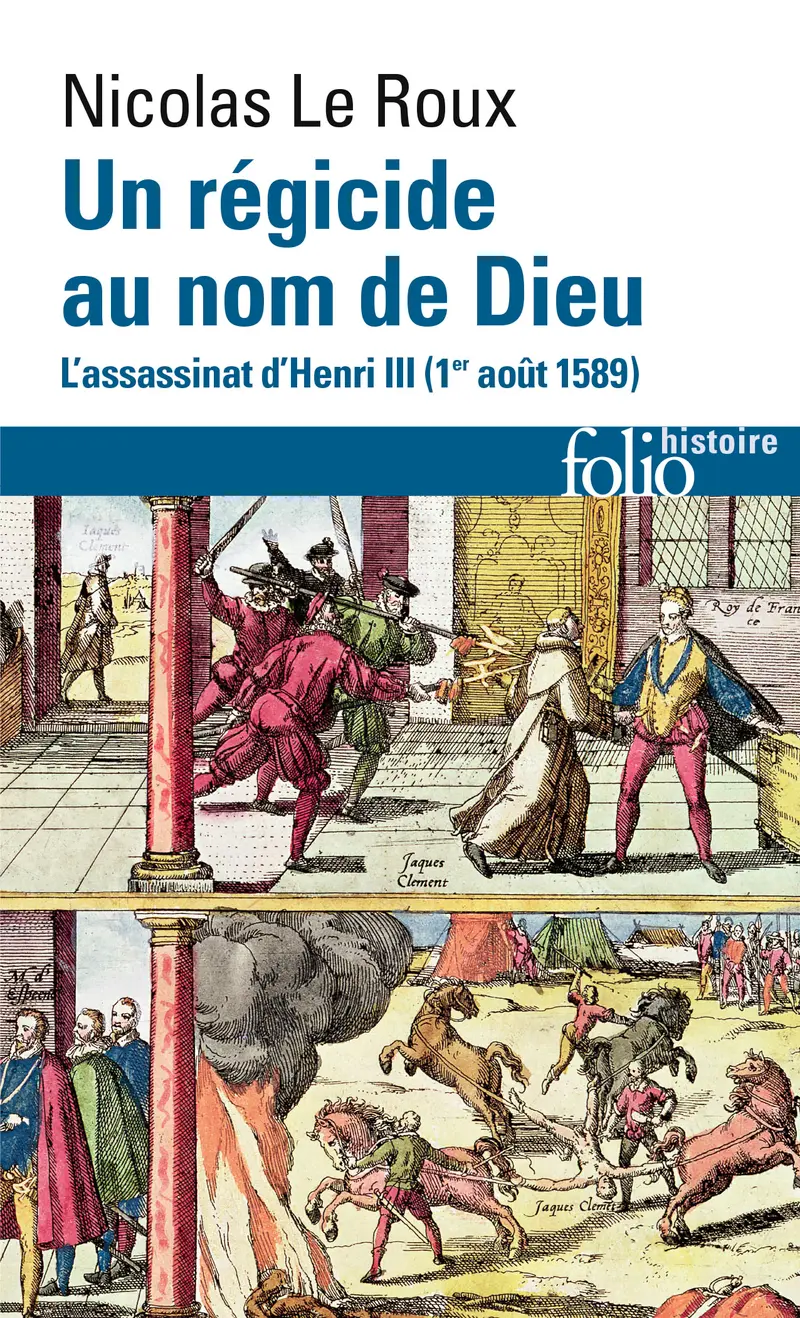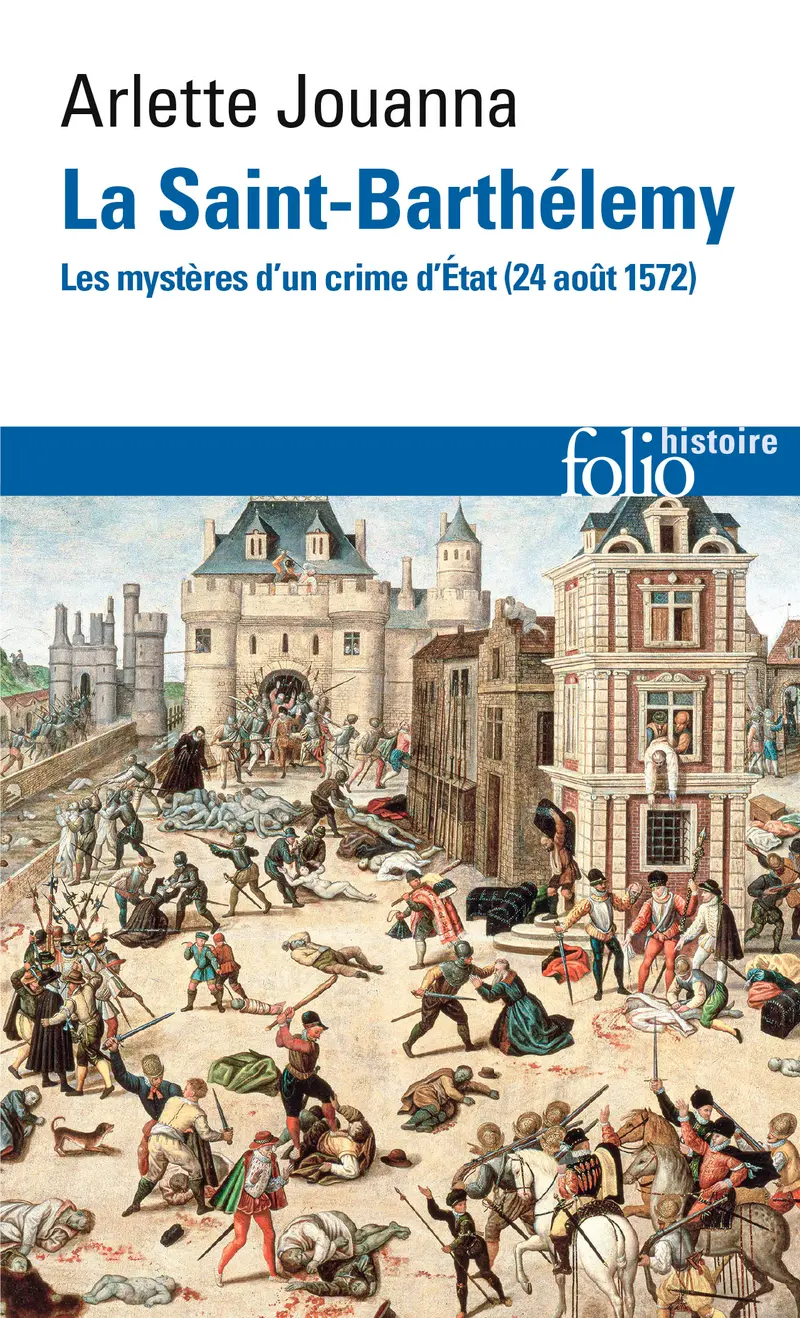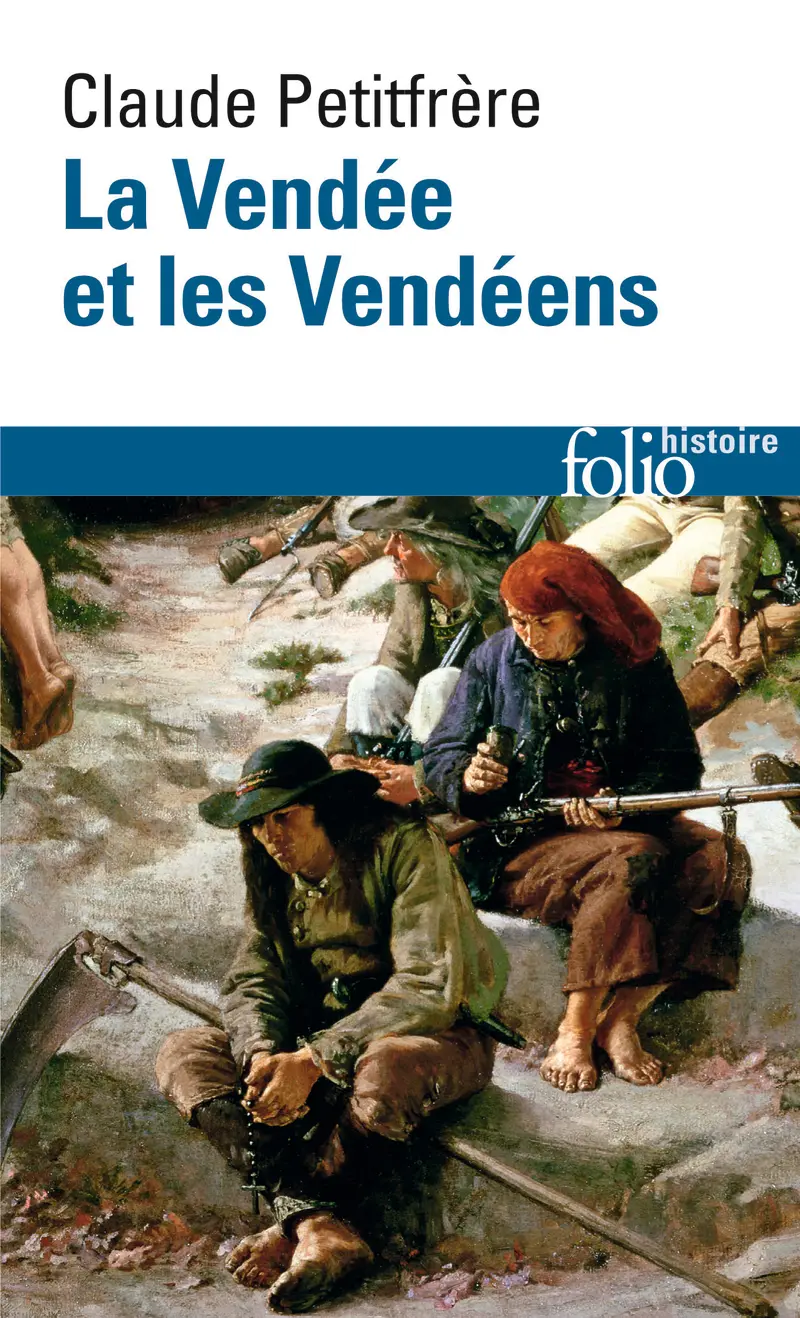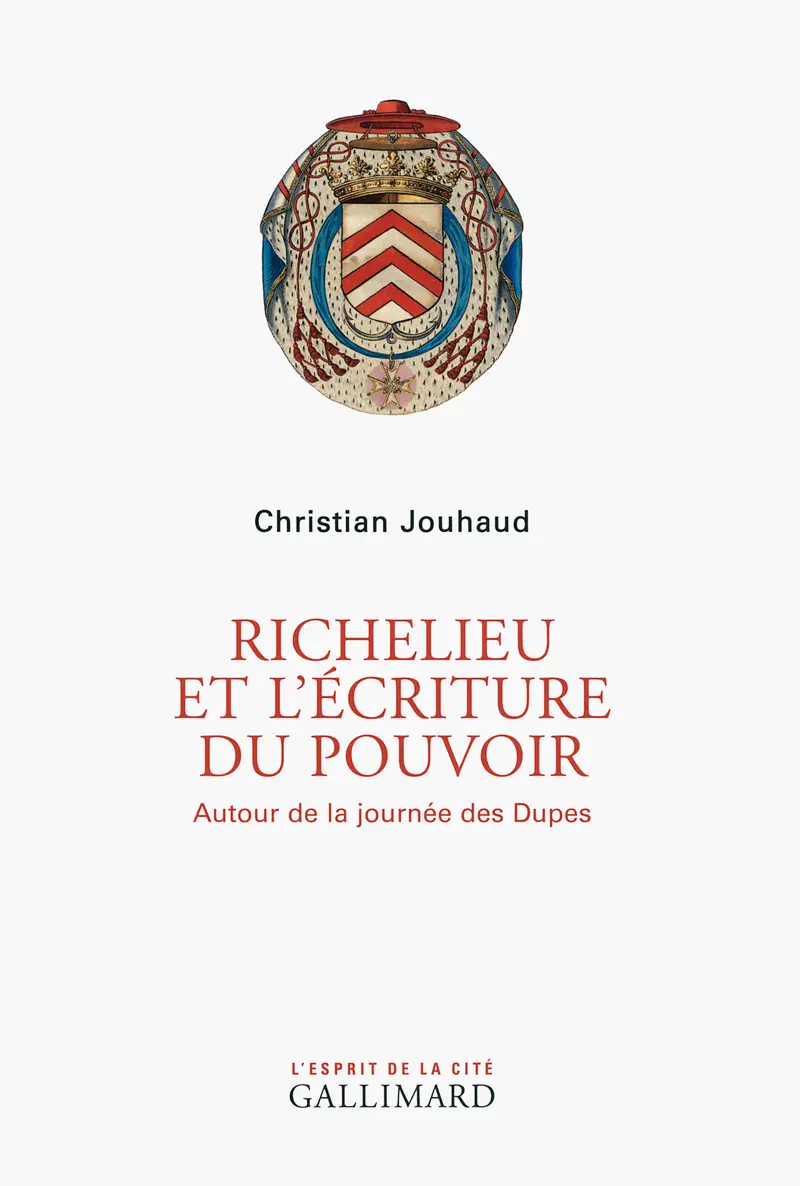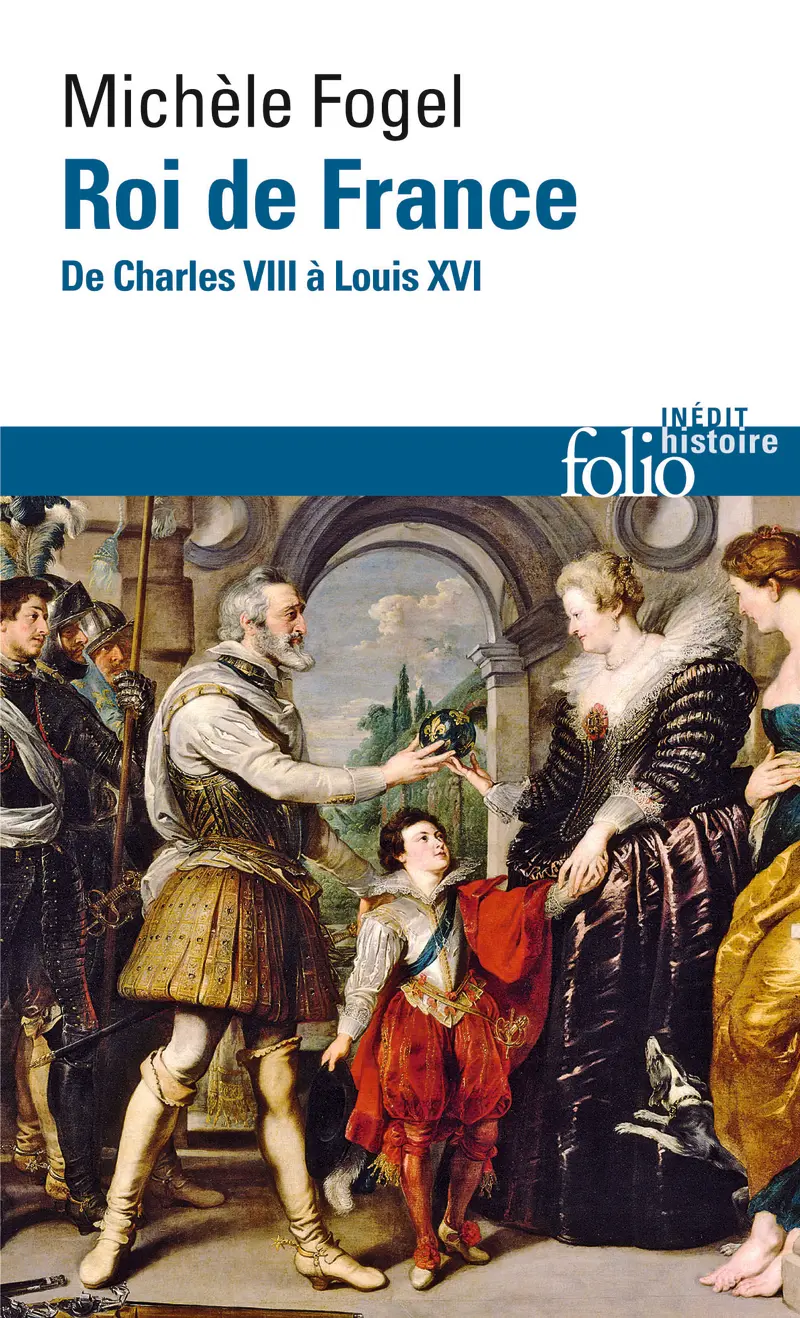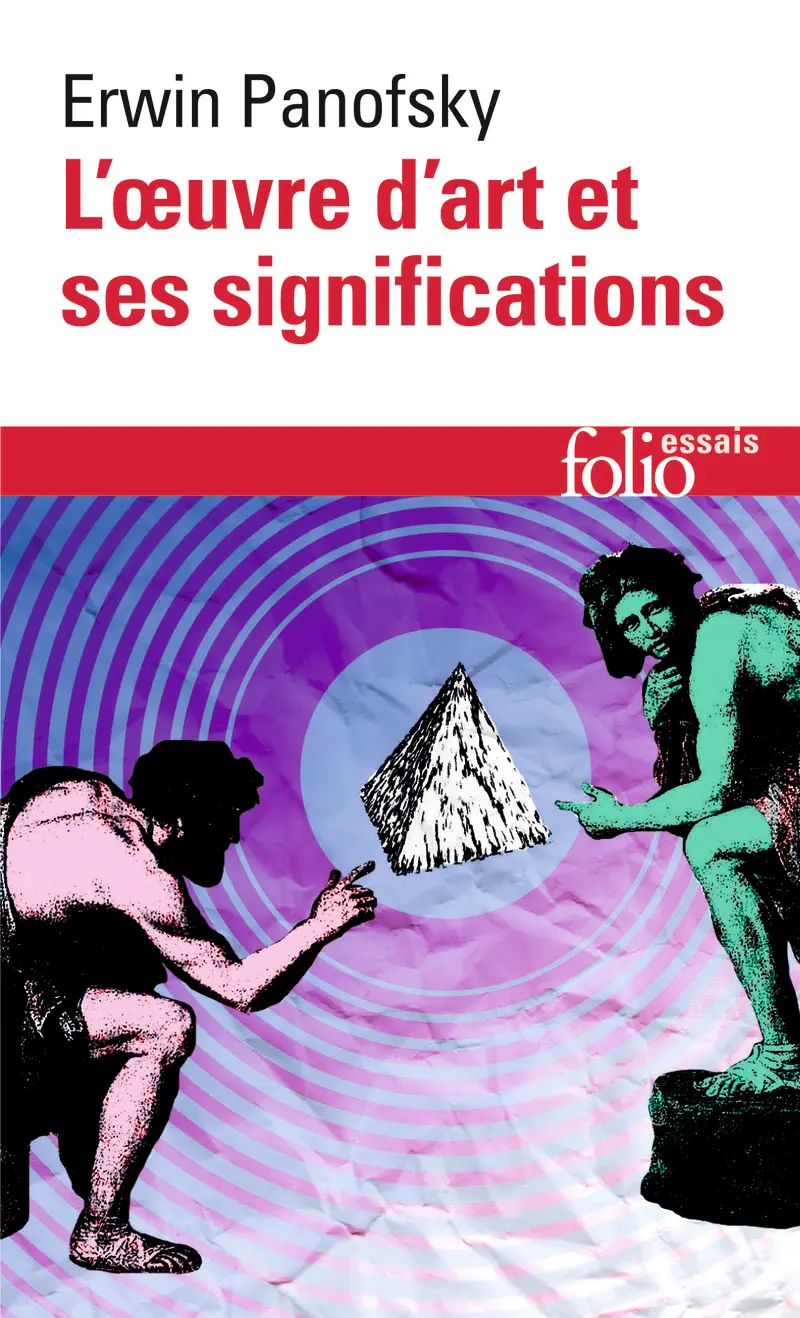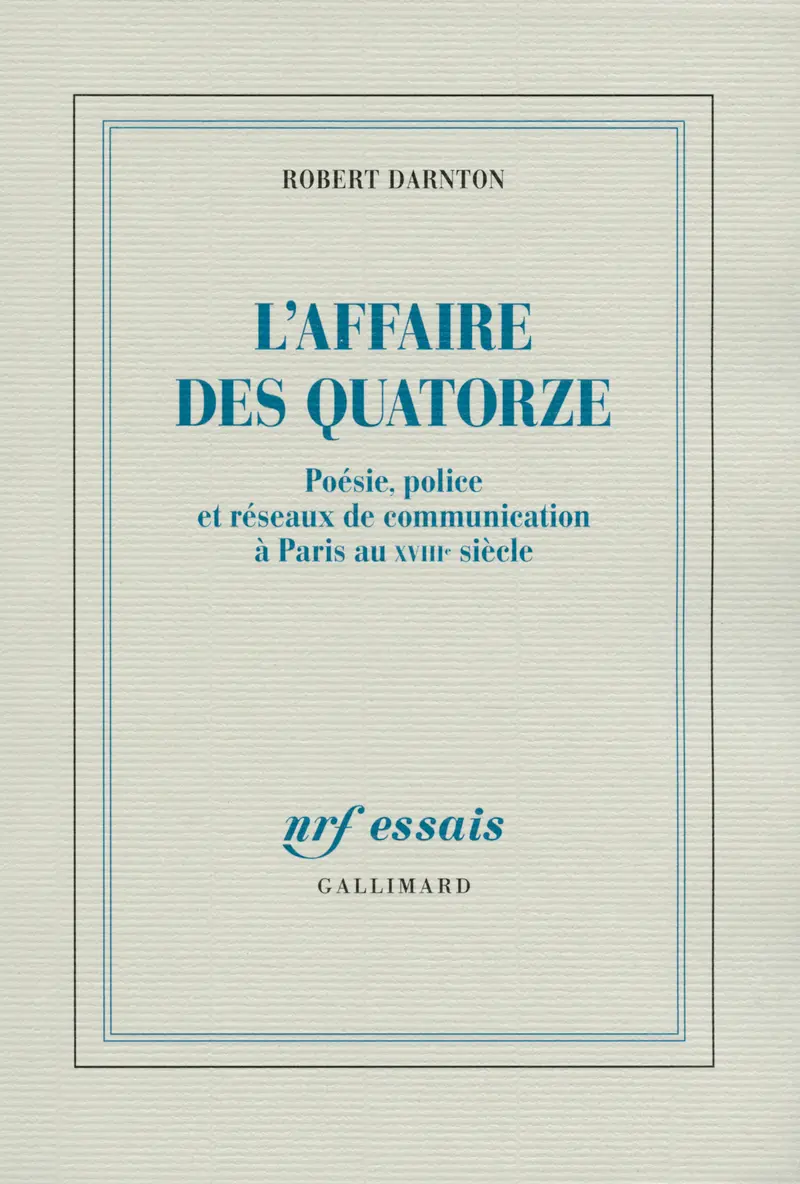La Révocation de l'édit de Nantes ou Les faiblesses d'un État
Première édition
Parution
Le mercredi 17 octobre 1685 est un jour parfaitement ordinaire. Louis XIV, qui réside à Fontainebleau, chasse le matin, assiste le soir à une comédie, et dans l’intervalle signe l’édit révoquant l’édit de Nantes, régissant depuis 1598 les rapports entre catholiques et protestants.
Très vite apparurent les conséquences désastreuses, tant intérieures qu’internationales, de cette volonté d’éradiquer la religion réformée. Contemporains puis historiens se sont interrogés sur les circonstances et les responsabilités de la décision.
Le parti ici pris par Philippe Joutard est celui du temps long : l’importance de l’édit de Fontainebleau tient autant dans les violences de sa première application que dans sa longévité active. Comment expliquer l’incapacité de «révoquer la Révocation» en plein siècle des Lumières, avec des dirigeants souvent indifférents en matière religieuse? Cette permanence, malgré les preuves de son inefficacité, crée une véritable «culture de la Révocation» qui est facteur d’intolérance et marque durablement l’histoire de notre pays. Au-delà de l'émancipation civile des protestants par la Révolution, les résonances de l’événement, dont la mémoire était encore vivante au XIXᵉ siècle, alimenteront le combat républicain pour la laïcité.
Très vite apparurent les conséquences désastreuses, tant intérieures qu’internationales, de cette volonté d’éradiquer la religion réformée. Contemporains puis historiens se sont interrogés sur les circonstances et les responsabilités de la décision.
Le parti ici pris par Philippe Joutard est celui du temps long : l’importance de l’édit de Fontainebleau tient autant dans les violences de sa première application que dans sa longévité active. Comment expliquer l’incapacité de «révoquer la Révocation» en plein siècle des Lumières, avec des dirigeants souvent indifférents en matière religieuse? Cette permanence, malgré les preuves de son inefficacité, crée une véritable «culture de la Révocation» qui est facteur d’intolérance et marque durablement l’histoire de notre pays. Au-delà de l'émancipation civile des protestants par la Révolution, les résonances de l’événement, dont la mémoire était encore vivante au XIXᵉ siècle, alimenteront le combat républicain pour la laïcité.