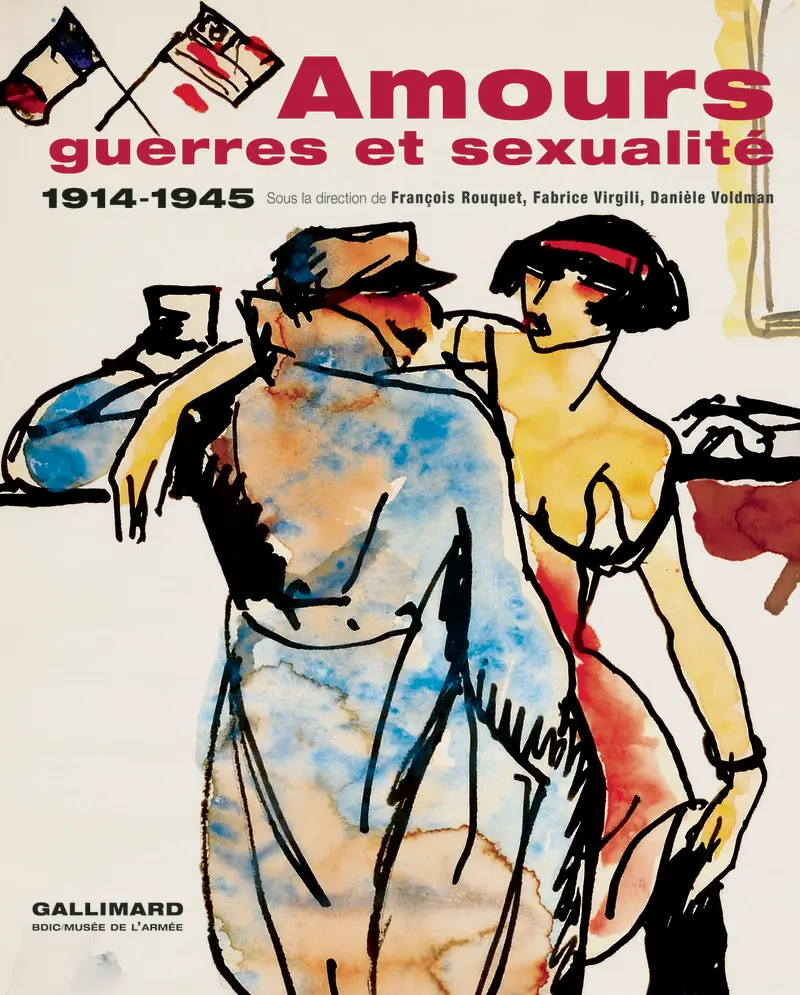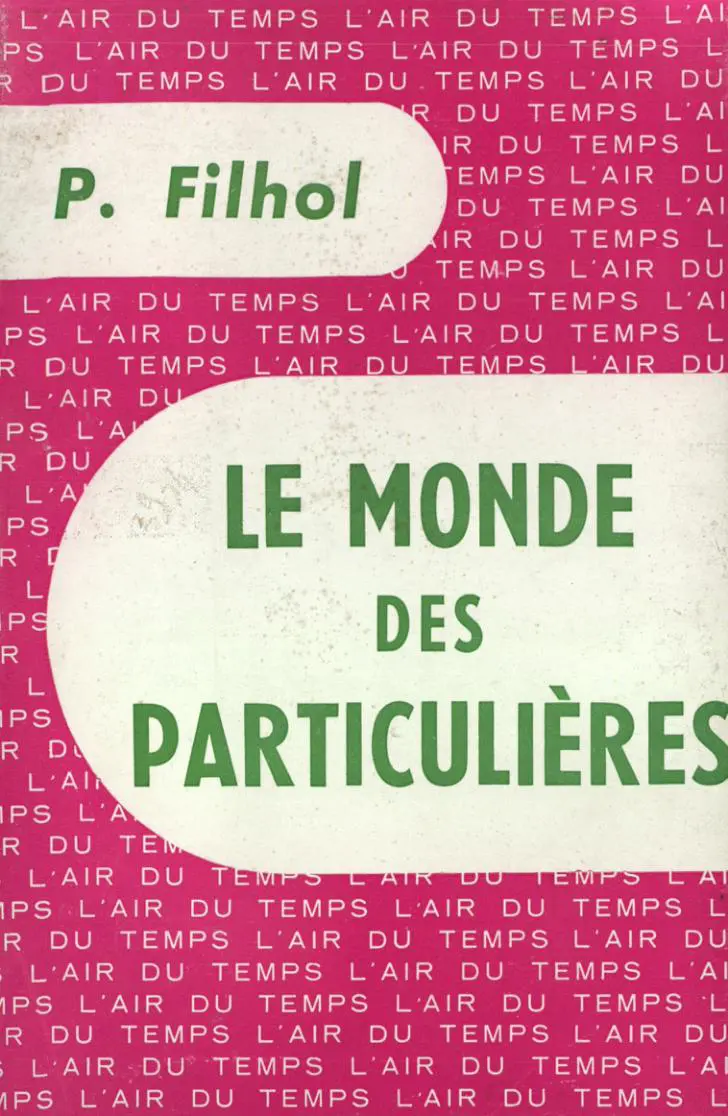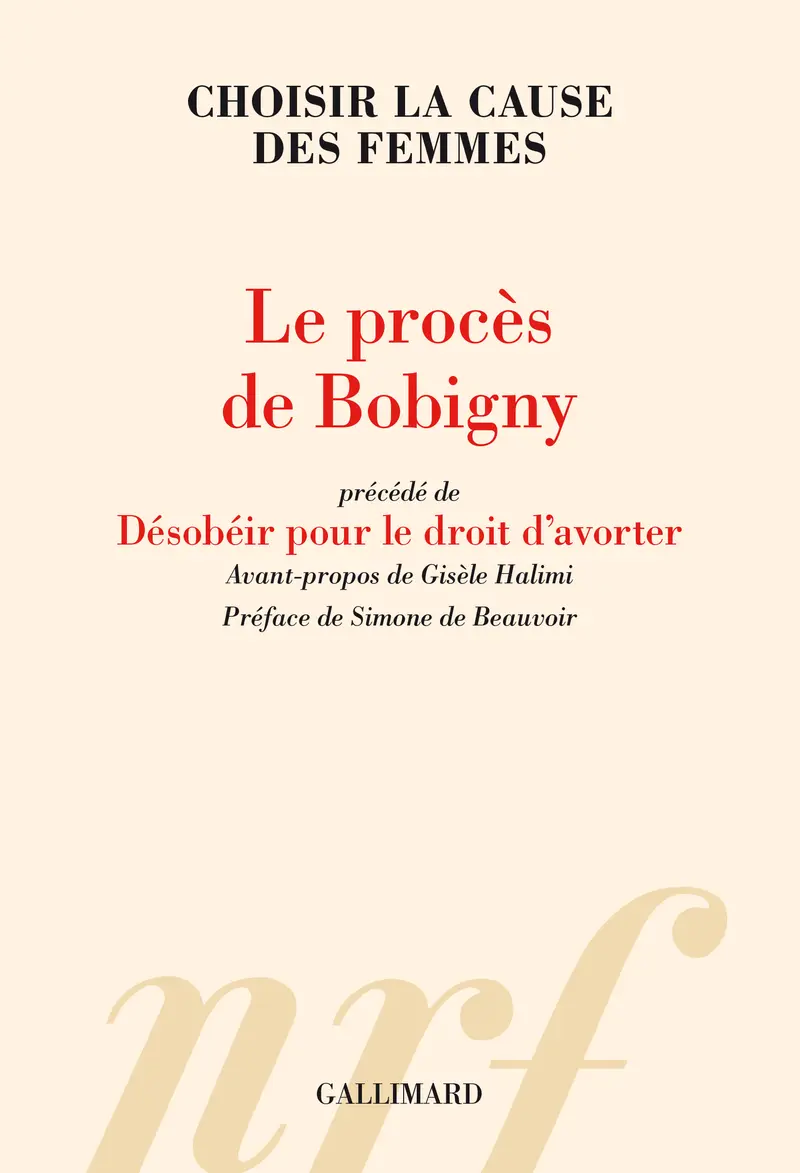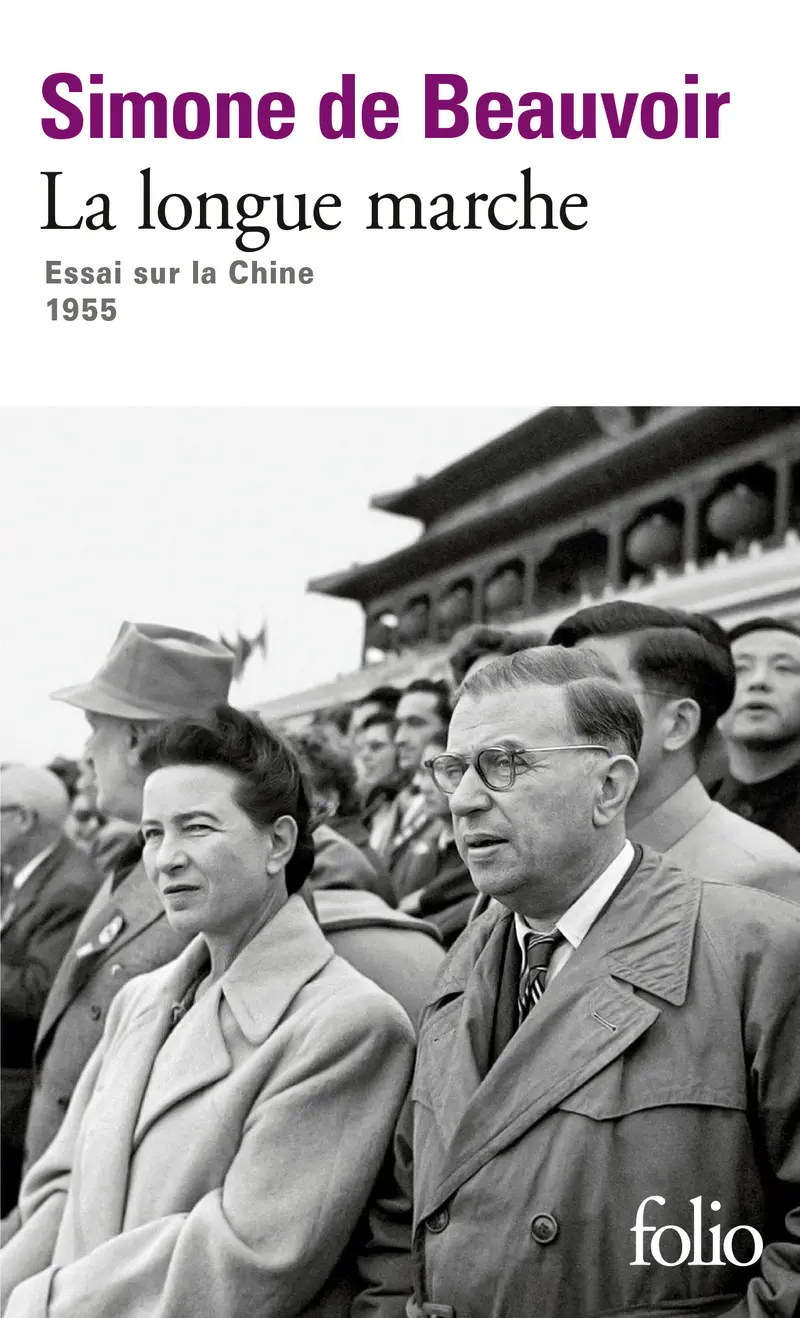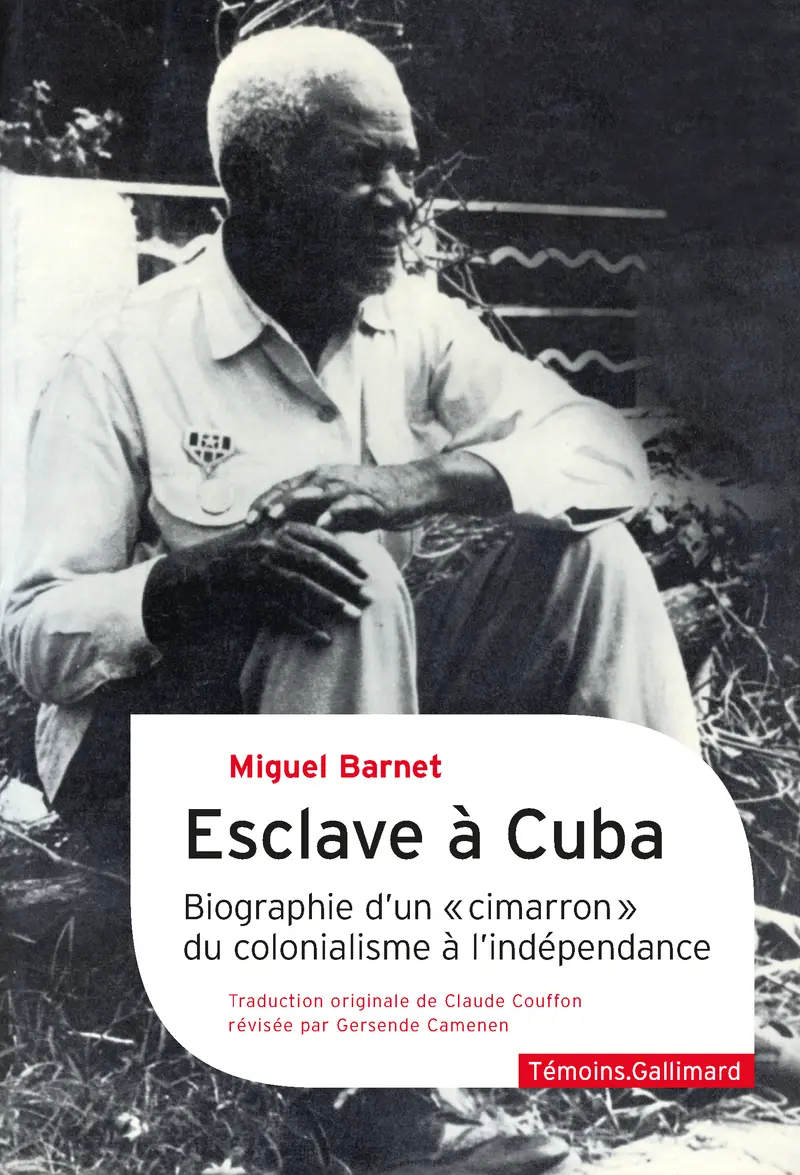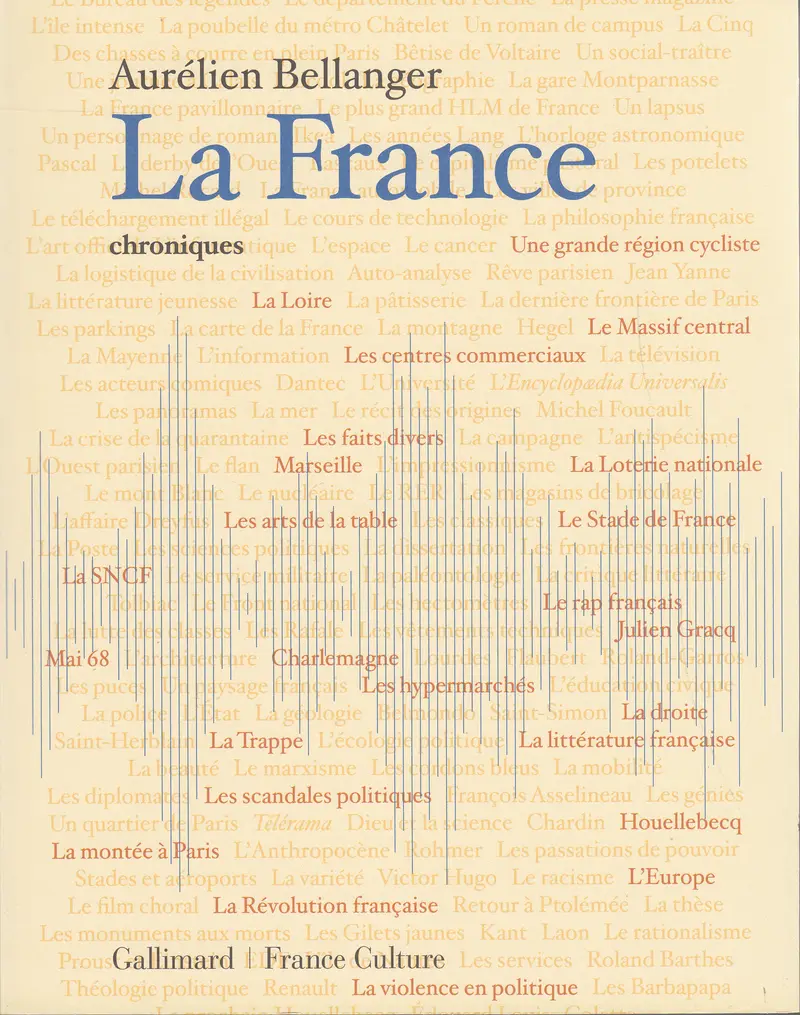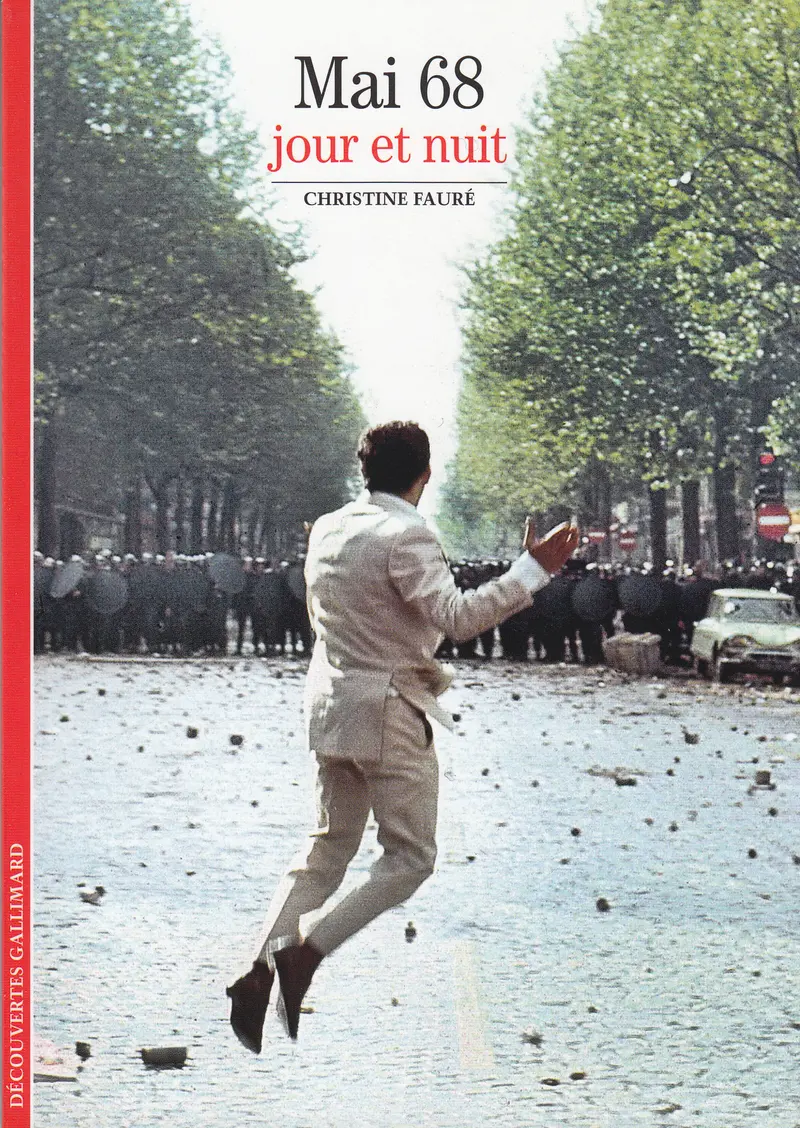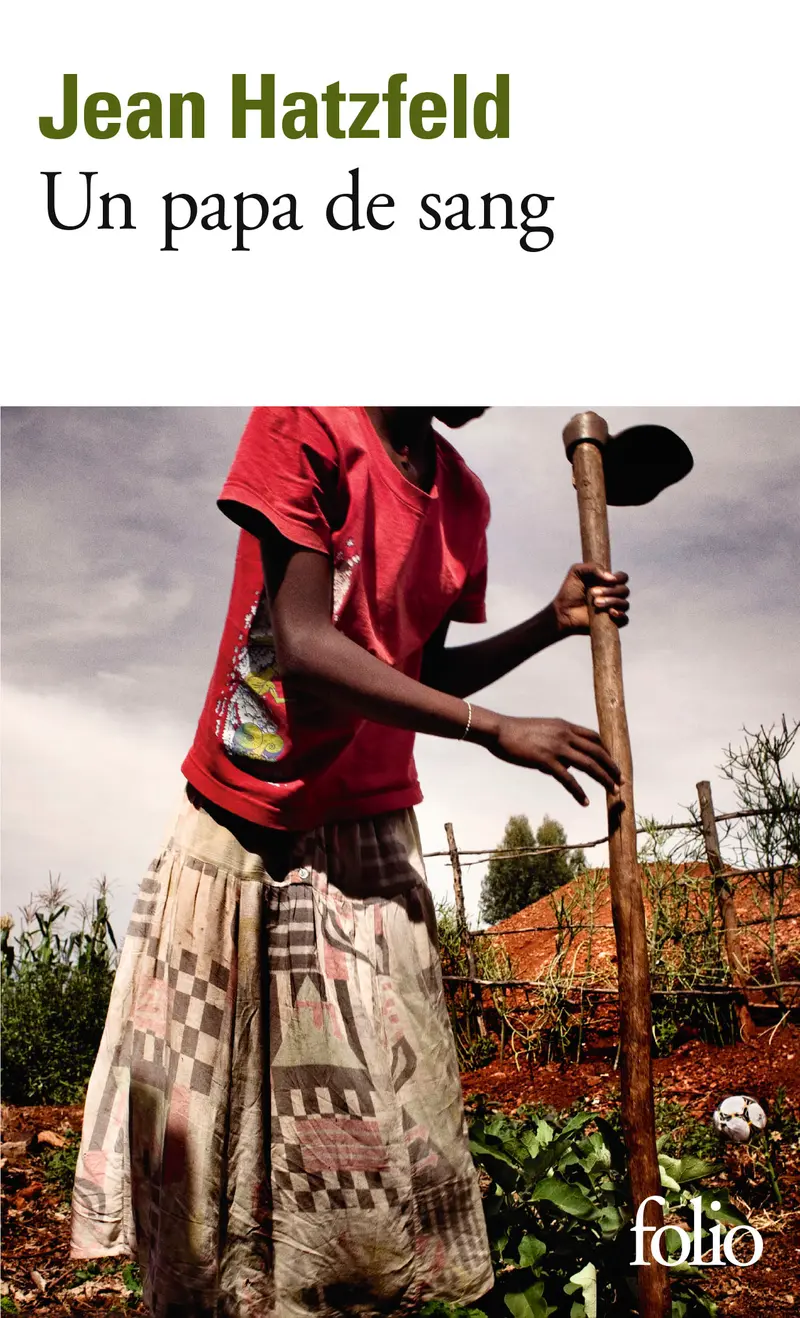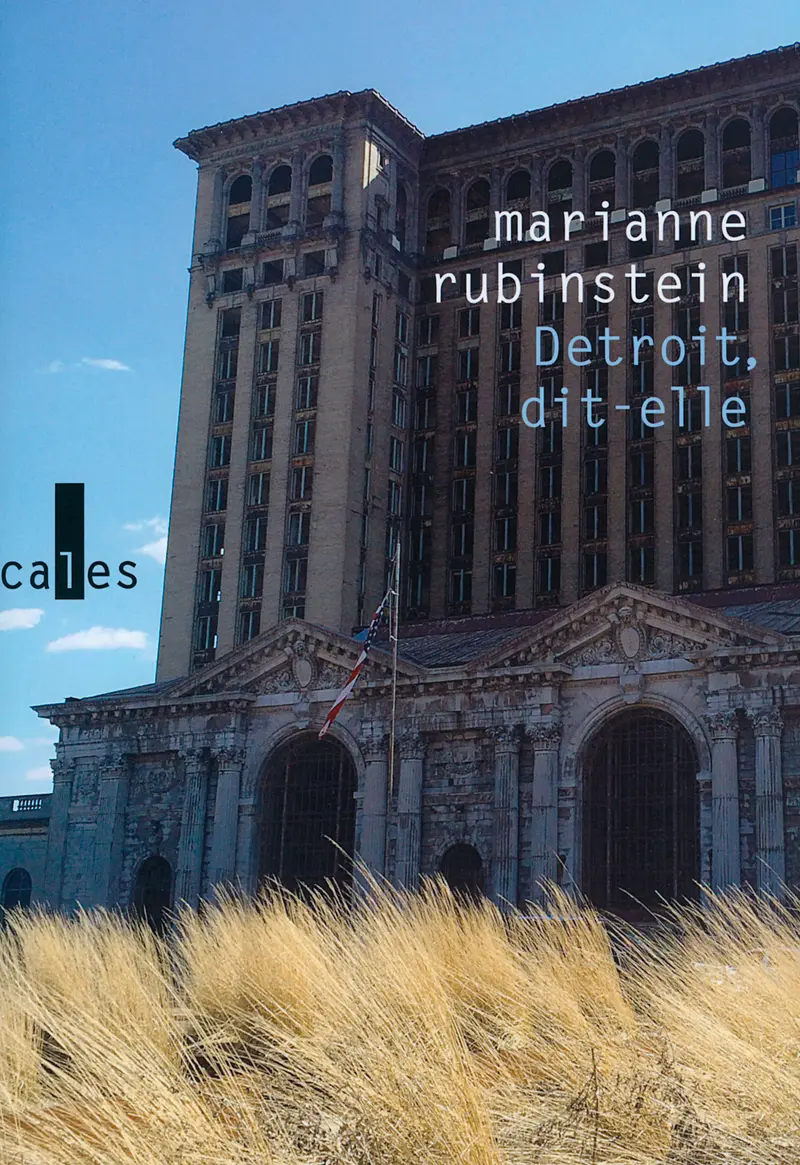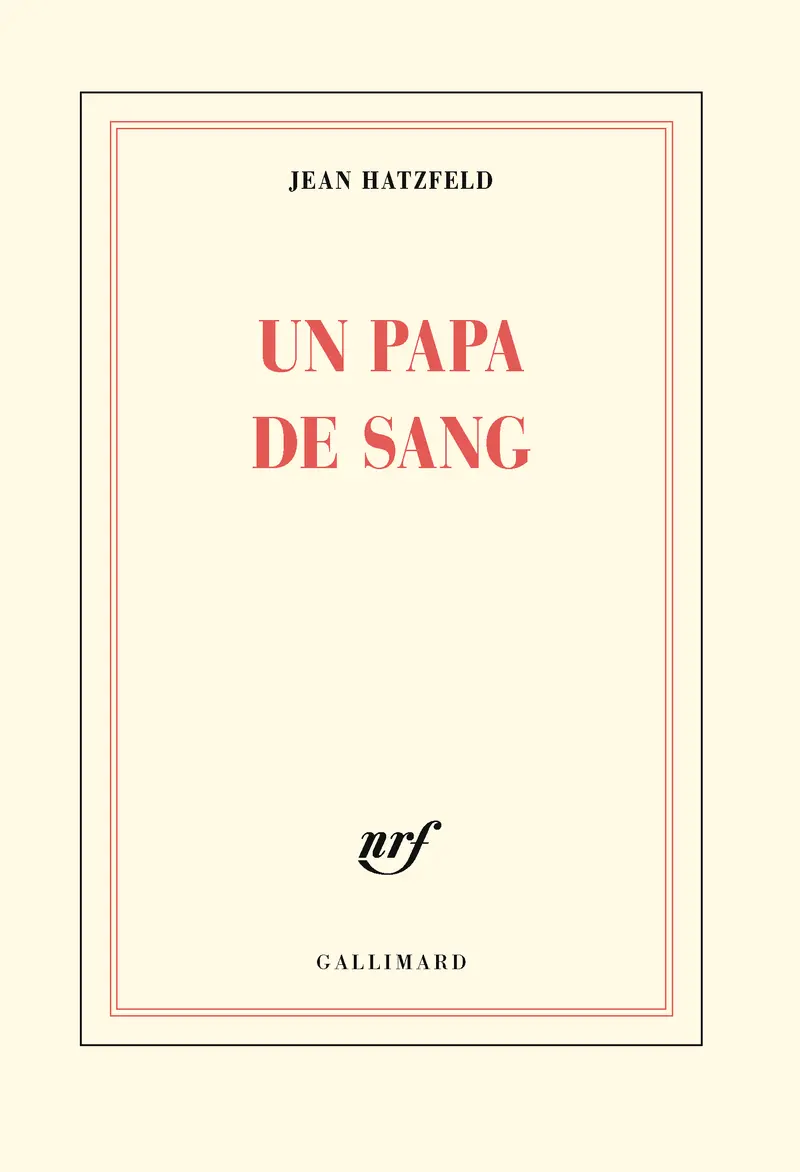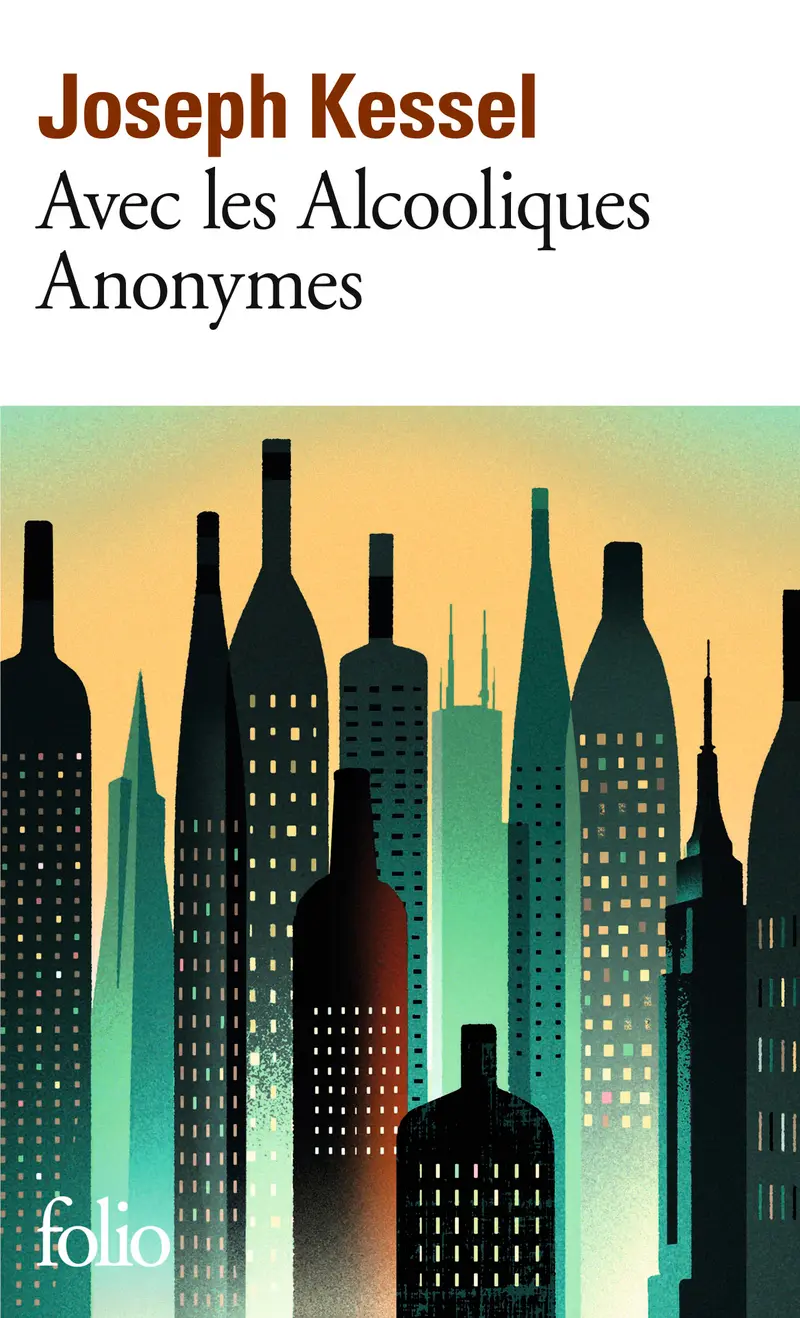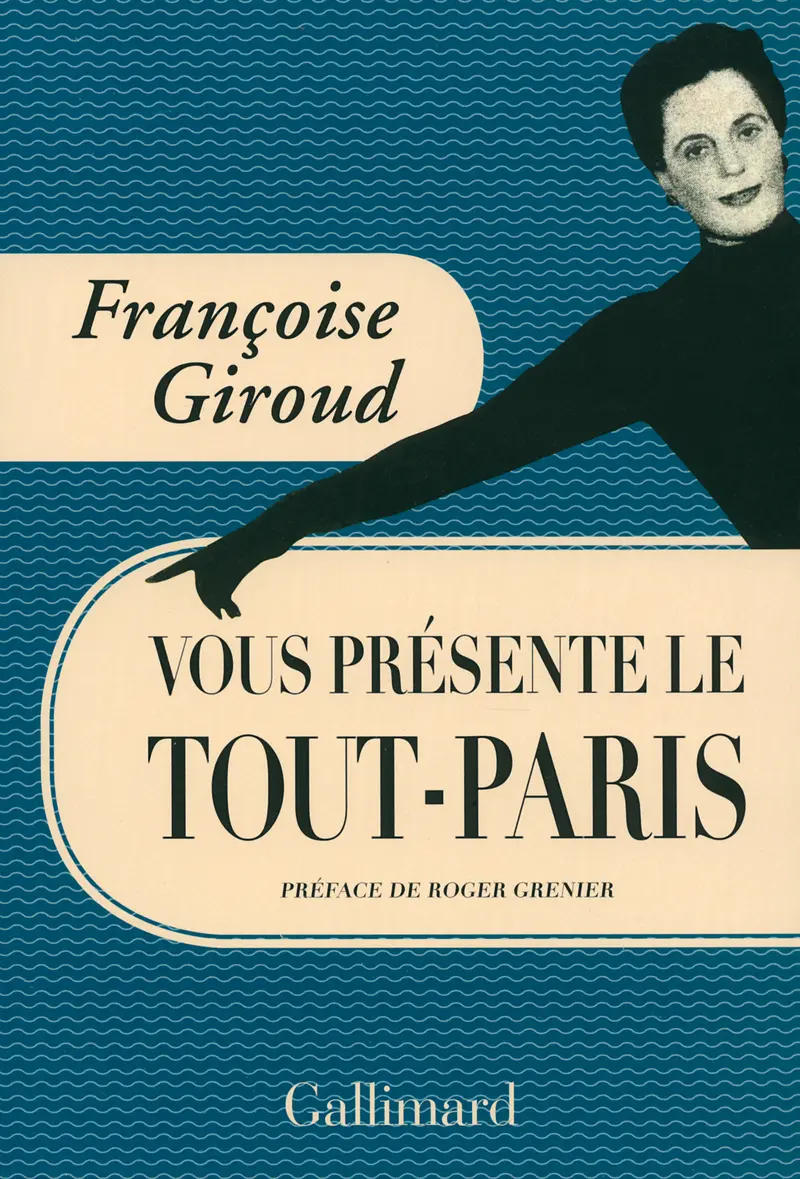Collectif
Les Gays savoirs
Ouvrage collectif de Leopoldo Alas, Yann Beauvais, Jean-François Cottier, Éric Dahan, Thierry Éloi, Mario Fortunato, Christoph Geiser, Piero Gelli, Emma Healey, Bas Heijne, Sébastien Hubier, Tom Kalin, Éric de Kuyper, Bruce Labruce, Pierre Maréchaux, Adam Mars-Jones, Eduardo Mendicutti, Detlev Meyer, Gilles Siouffi, Walter Siti, Andrea Weiss et de Mario Wirz. Trad. de différentes langues par Gustavo González-Zafra, Antonella de Sarno et Jacqueline Sichler. Édition publiée sous la direction de Patrick Mauriès
Parution
Venus d'Espagne, de Grande-Bretagne, d'Italie, des Pays-Bas, de Belgique et d'Allemagne, vingt-trois écrivains, cinéastes et historiens se sont retrouvés, deux jours de juin 1997, à l'initiative du Centre Georges Pompidou et des Éditions du Promeneur.
Au même moment, plusieurs milliers de personnes défilaient à Paris à l'occasion d'une spectaculaire Europride, rappelant à l'ordre de leur désir. Les réunissaient, de même que les artistes rassemblés, une «différence sexuelle», l'appartenance à une «minorité»,le souci,le besoin de la défendre et l'affirmation réitérée, toujours nécessaire, de droits toujours disputés.
Cela suffit-il pour autant à définir une «identité» ? Et que serait, positivement, cette identité ? Comment varie-t-elle d'un pays, d'une tradition, d'une psychologie, d'une Église d'Europe à une autre ? Comment un écrivain, un artiste, un sujet se débrouille-t-il de cela ? Accepte-t-il seulement de s'y reconnaître ? Autant que d'affirmer une identité, ne s'agit-il pas, avant tout, lorsqu'on est «minoritaire», de mettre en question le fondement, l'évidence, la légitimité même d'une telle notion ?
Au même moment, plusieurs milliers de personnes défilaient à Paris à l'occasion d'une spectaculaire Europride, rappelant à l'ordre de leur désir. Les réunissaient, de même que les artistes rassemblés, une «différence sexuelle», l'appartenance à une «minorité»,le souci,le besoin de la défendre et l'affirmation réitérée, toujours nécessaire, de droits toujours disputés.
Cela suffit-il pour autant à définir une «identité» ? Et que serait, positivement, cette identité ? Comment varie-t-elle d'un pays, d'une tradition, d'une psychologie, d'une Église d'Europe à une autre ? Comment un écrivain, un artiste, un sujet se débrouille-t-il de cela ? Accepte-t-il seulement de s'y reconnaître ? Autant que d'affirmer une identité, ne s'agit-il pas, avant tout, lorsqu'on est «minoritaire», de mettre en question le fondement, l'évidence, la légitimité même d'une telle notion ?