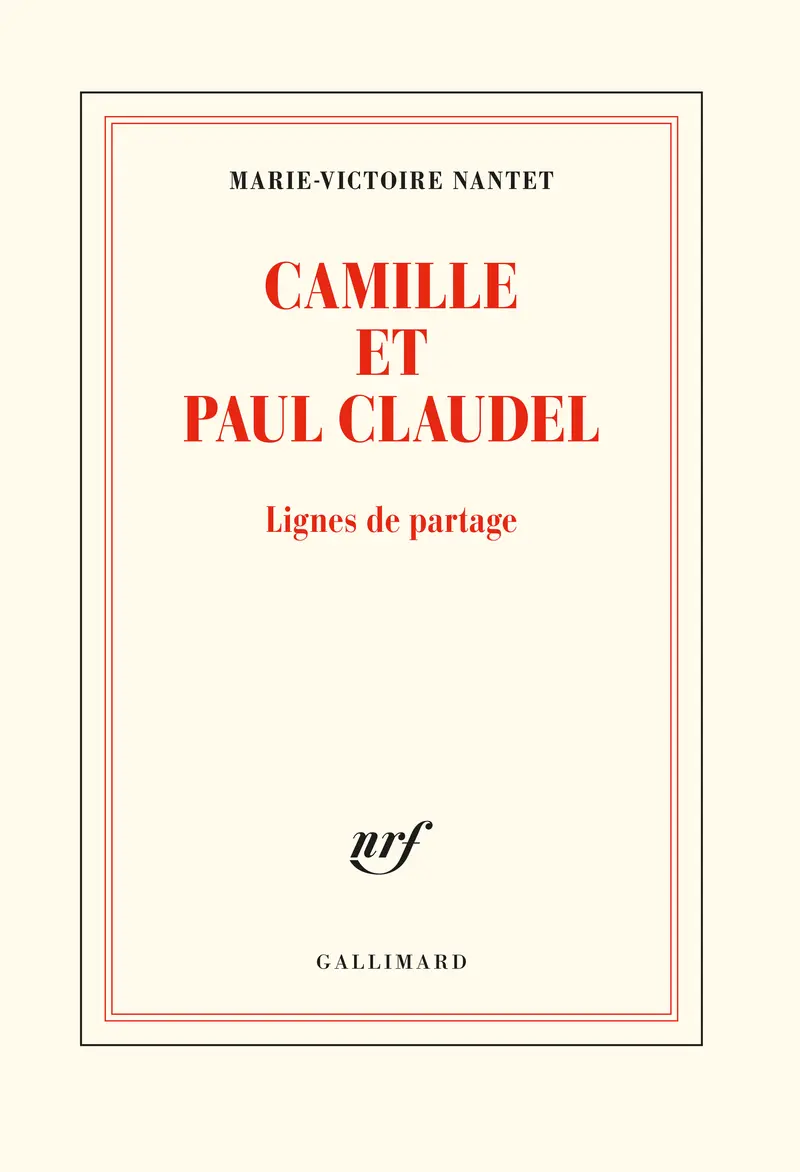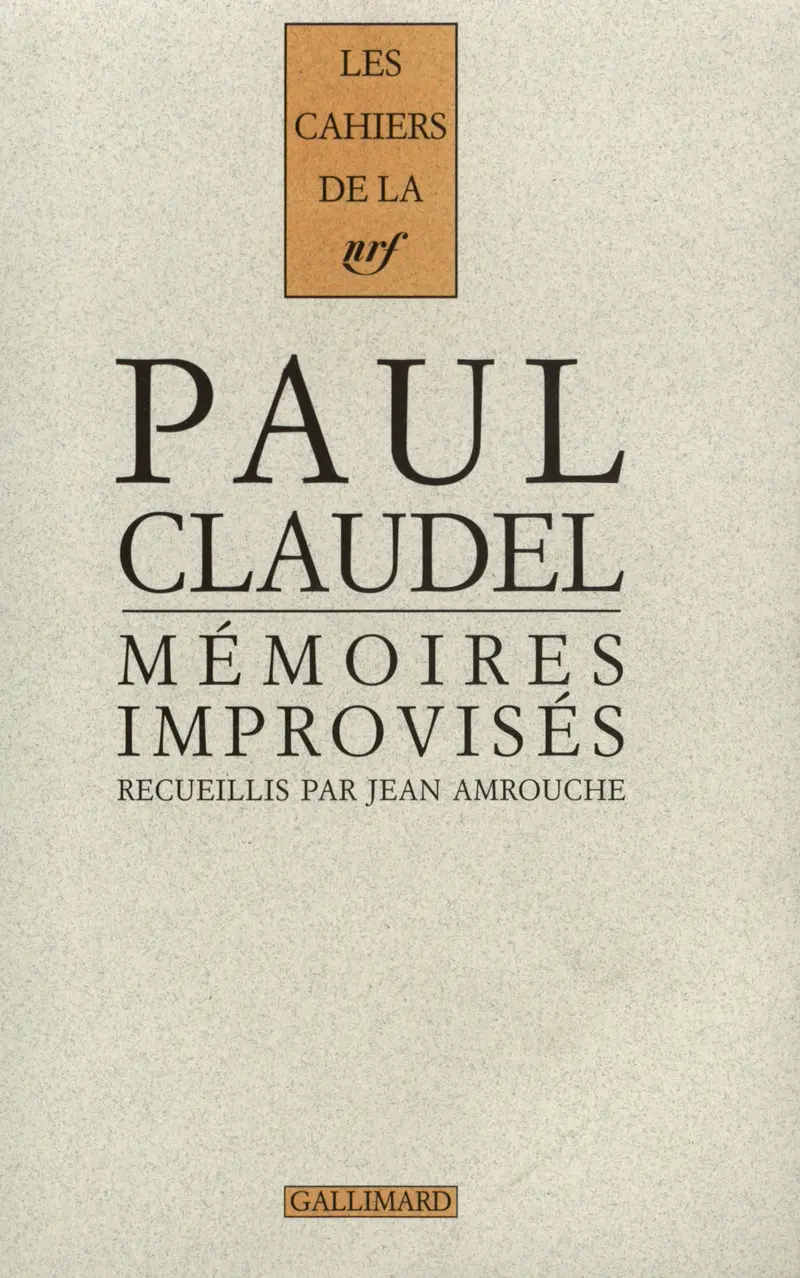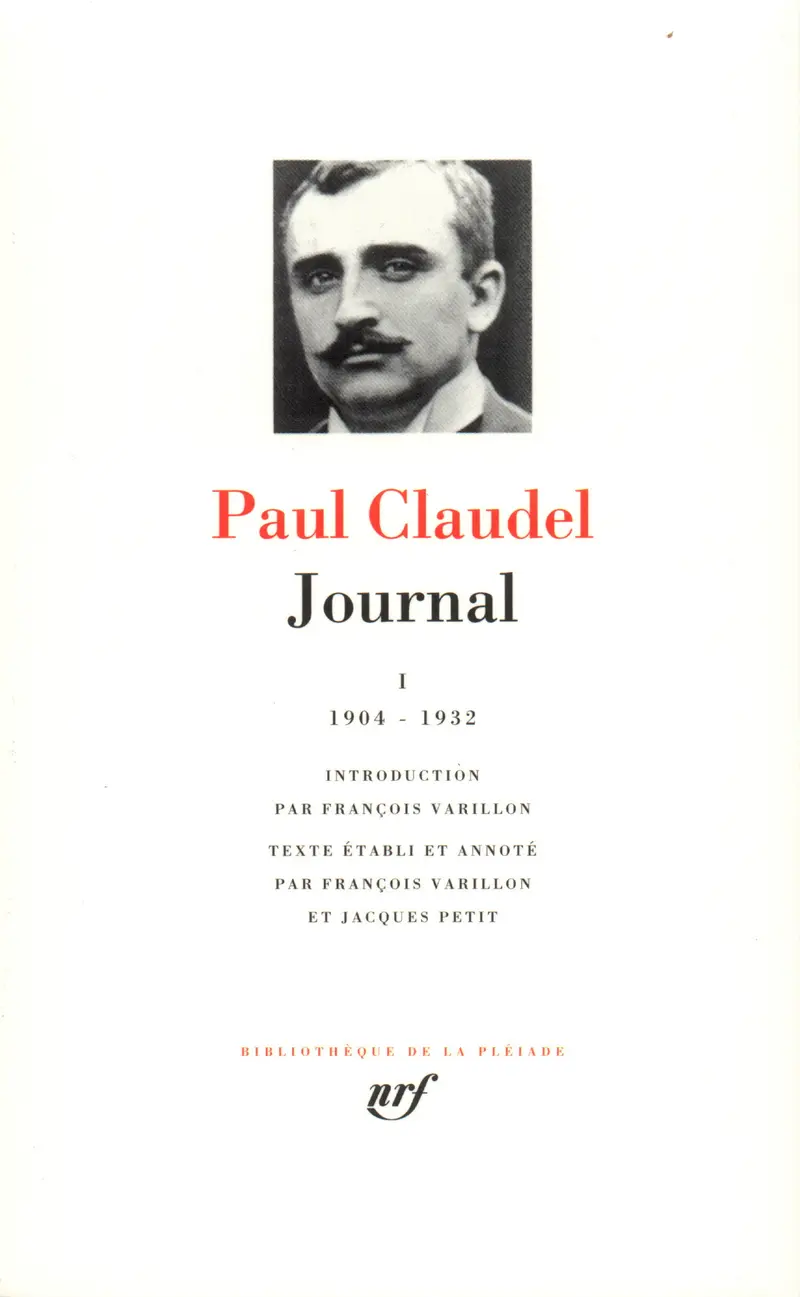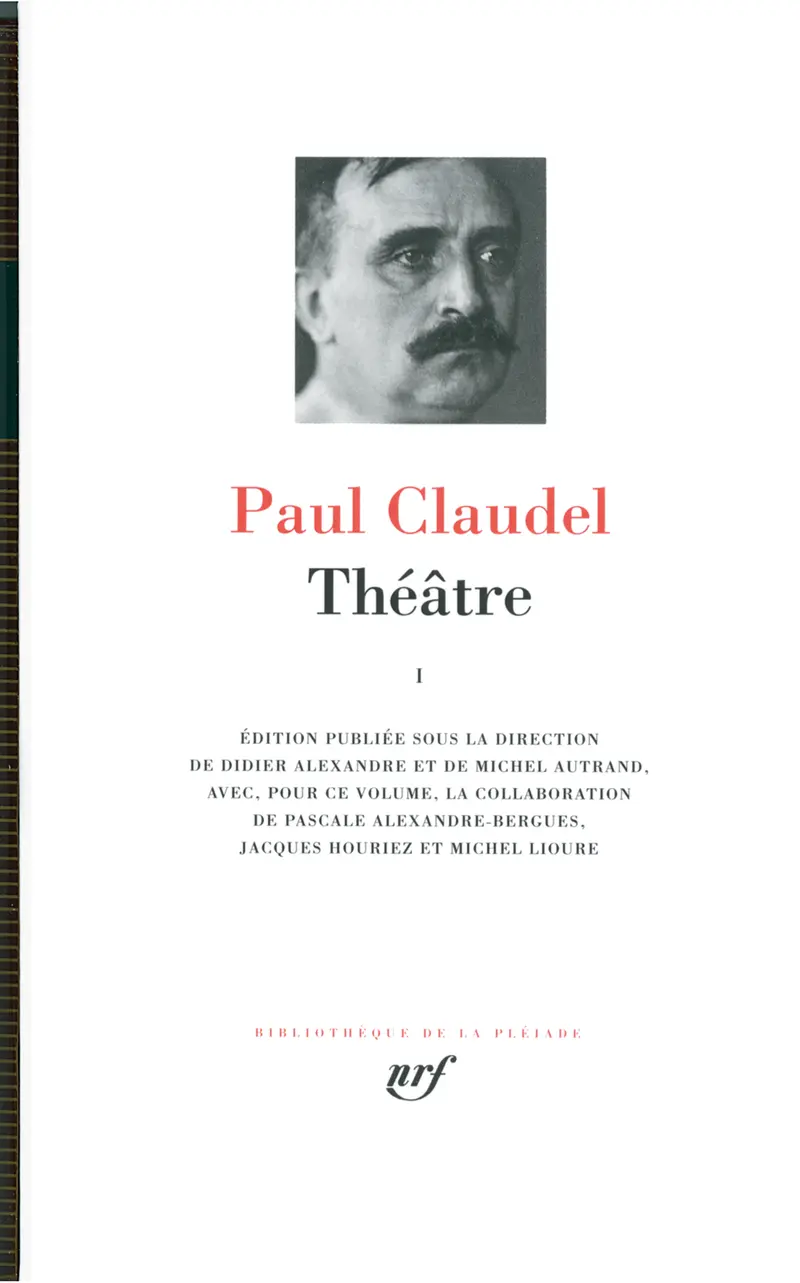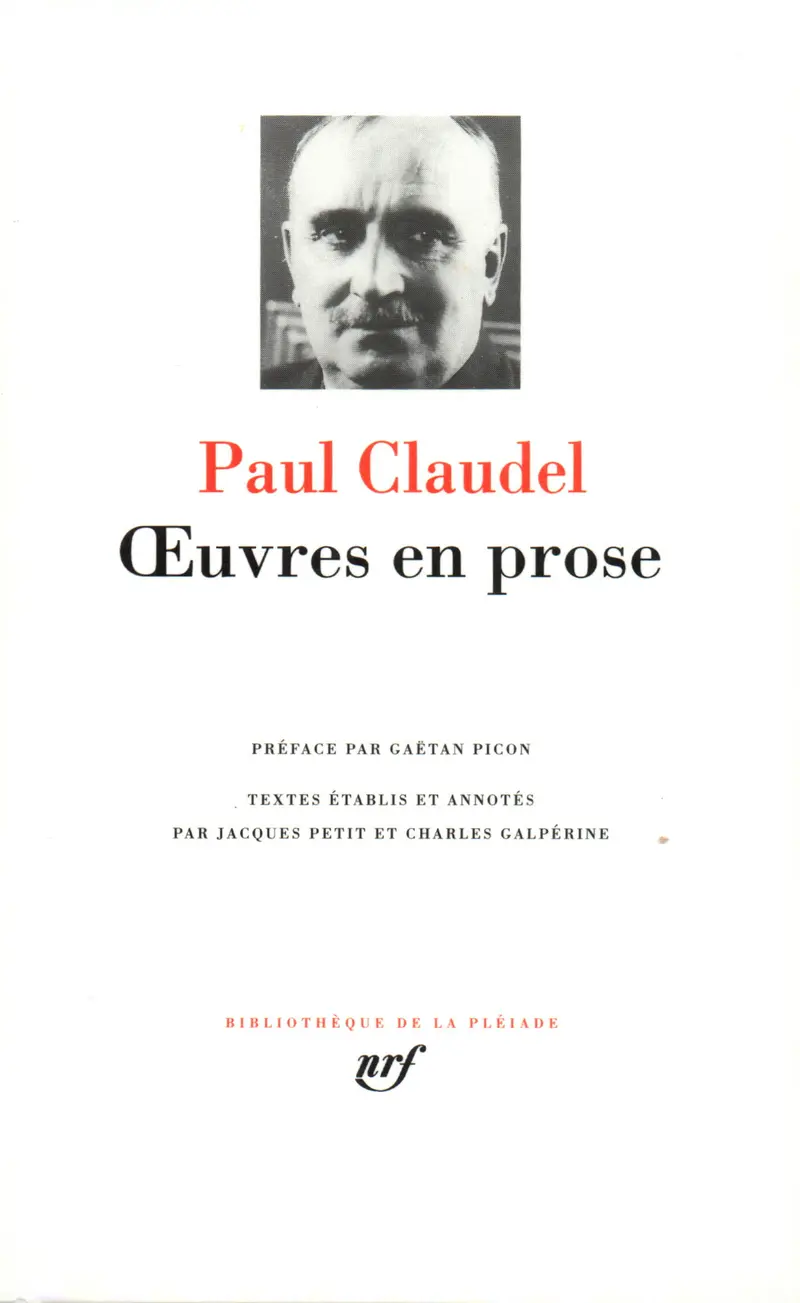Paul Claudel (1868-1955)
Paul Claudel, qui mena de front une carrière diplomatique et littéraire, fut l'un des collaborateurs de la première heure de La Nouvelle Revue française. Avec L'Otage paru en mai 1911, le poète et dramaturge est l'un des trois premiers auteurs des Éditions de la NRF, futures Éditions Gallimard.
« [Paul Claudel] est l'homme moderne, celui qui n'est sûr que de ce qu'il touche, ne s'occupe pas de soi, mais de ce qu'il fait, ne veut pas de rêves, mais des résultats, pour qui rien ne compte que l'œuvre et la plénitude décisive de l'œuvre. » Maurice Blanchot
Paul Claudel, né le 6 août 1868 à Villeneuve-sur-Frère dans l'Aisne, est le fils de Louis-Prosper Claudel, receveur de l'enregistrement, et de la fille d'un médecin, Louise Cerveaux. Enfant, il est scolarisé à Bar-le-Duc, à Nogent-sur-Marne puis à Wassy-sur-Blaise où son père est successivement nommé. Tandis que Louis Claudel reste à Wassy, la famille s'installe à Paris. Camille, la sœur aînée, travaille la sculpture dans l'atelier Colarossi. Paul entre quant à lui en classe de rhétorique au lycée Louis-le-Grand. Après l'obtention du baccalauréat de philosophie, il commence une licence en droit. 1886 est l'année de sa « conversion » : malgré une enfance pieuse, il s'était jusque là détourné de la religion.
Le jeune homme découvre à cette époque Rimbaud à travers les Illuminations et Une saison en enfer. Il écrit ses premiers poèmes en 1887 et fréquente les mardis de Mallarmé. Son premier drame, Tête d'or, paraît en 1889. La Ville, La Jeune fille Violaine et L'Échange sont composés respectivement en 1890, 1892 et 1894.
Entre temps, Claudel poursuit ses études à l'Institut des Sciences politiques. Reçu au concours des Affaires étrangères, il est attaché au ministère avant d'être promu vice-consul aux États-Unis en 1893. Il est ensuite nommé en Chine, où il réside de 1895 à 1900. Partageant son temps entre ses activités diplomatiques et l'écriture, il travaille à diverses compositions : Vers l'exil, Le Repos du septième jour, Connaissance de l'Est dont la première partie est publiée au Mercure de France en 1900.
Après un congé d'un an passé en France et marqué par une tentative de vie monastique, Claudel se rend pour la seconde fois en Chine en 1901. Il rencontre pendant la traversée Rosalie Vetch, qui deviendra le modèle d'Ysé dans Le Partage de midi. Au cours de ce second séjour, il compose notamment Connaissance du Temps (L'Art poétique, publié en 1907), la première Ode Les Muses et les derniers poèmes de Connaissance de l'Est.
Avant un nouveau départ pour la Chine, il épouse en mars 1906 Reine Sainte-Marie Perrin qui lui donnera cinq enfants. L'Otage, Les Cinq grandes Odes et les premiers poèmes de Corona Benignitatis Anni Dei occupent alors l'écrivain. Il sera l'un des collaborateurs de la première heure de la toute jeune Nouvelle Revue française : L'Hymne au Saint Sacrement paraît dans la seconde livraison en mars 1909. Le comptoir d'édition bientôt associé à la revue deviendra l'éditeur en titre de Paul Claudel (dont les œuvres étaient jusqu'alors publiées au Mercure de France). C'est d'ailleurs lui qui en suggéra l'idée à André Gide. Ainsi, L'Otage est le premier livre publié sous la couverture blanche en 1911. Claudel reprend en août 1910 La Jeune fille Violaine qui devient L'Annonce faite à Marie et achève La Cantate à trois voix en 1912. Sa famille est durement éprouvée en 1913 par la mort de Louis Claudel et l'internement de Camille.
En poste à Hambourg depuis octobre, le diplomate quitte l'Allemagne à la déclaration de la guerre en 1914. Alors qu'il séjourne à Rome puis au Brésil où il est nommé en 1917, il écrit Feuilles de Saints. Après la guerre, Claudel est envoyé à Copenhague en 1919 (L'Ode jubilatoire), au Japon en 1921 (Le Soulier de Satin, L'Oiseau noir dans le soleil levant) puis à Washington en qualité d'ambassadeur à partir de 1927. Bruxelles est le dernier poste de Claudel qui prend sa retraite en 1935.
Durant les années d'occupation, l'écrivain s'installe à Brangues, propriété iséroise acquise en 1927 et où ont été écrites en grande partie les Conversations dans le Loir-et-Cher. Il travaille à Paul Claudel interroge l'Apocalypse et Paul Claudel interroge le Cantique des cantiques. De fait, il consacrera, jusqu'à sa mort, la plus grande partie de son activité littéraire à ses commentaires bibliques. Claudel est élu à l'Académie française en 1946. Il s'éteint le 23 février 1955 à Paris, six jour après la première de L'Annonce faite à Marie à la Comédie-Française.
Paul Claudel dramaturge
Sont indiqués, pour chaque pièce, la date et le lieu de la première représentation, et, pour certaines d'entre elles, les reprises importantes.
Les premières créations
- Tête d'or : création par le Groupe Art et Action en 1924.
- La Ville : création en néerlandais salle Patria à Bruxelle en 1955.
- La Jeune fille Violaine : céation salle Iéna en 1944.
- L'Échange : création au Théâtre du Vieux Colombier dans une mise en scène de Jacques Copeau en 1914.
- Le Repos du septième jour : création au Théâtre de l'Œuvre en 1965.
- L'Orestie (Agamemnon, Les Choéphores, Les Euménides) d'Eschyle, traduction de Paul Claudel : présentation à l'Opéra de Berlin en 1963. Les Choéphores a été préalablement créée au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles en 1935.
- Le Partage de midi : création par le Groupe Art et Action en 1921.
- L'Annonce faite à Marie : création au Théâtre de l'Œuvre dans une mise en scène de Lugné-Poe en 1912.
- L'Otage : création au Théâtre Scala à Londres en 1913. La pièce est reprise l'année suivante dans une mise en scène de Lugné-Poe au Théâtre de l'Œuvre.
- Protéé : création en néerlandais par des étudiants de Groningen sur une musique de Darius Milhaud en 1929.
- Le Pain dur : création en tournée en Suisse et au Canada par Ludmilla Pitoëff entre 1941 et 1943.
- Le Père humilié : création au Schauspielhaus de Dresde en 1928.
- La Nuit de Noël 1914 : création à l'Œuvre sociale du chantier en 1917.
- L'Ours et la lune : création à Alger en 1948.
- L'Homme et son désir : création au Théâtre des Champs-Élysées sur une musique de Darius Milhaud en 1921.
- La Femme et son ombre : création au Théâtre impérial de Tokyo en 1923. Repris en 1948 par les ballets de Roland Petit au Théâtre Marigny.
- Le Soulier de satin : création à la Comédie-Française dans une mise en scène de Jean-Louis Barrault en 1943.
- Sous le rempart d'Athènes : création au Palais de l'Élysée dans une mise en scène de Louis Jouvet en 1927.
- Le Livre de Christophe Colomb : opéra créé au Staatsoper Unter den Liden à Berlin sur une partition de Darius Milhaud en 1930. Repris sous forme dramatique avec la nouvelle musique de scène de Darius Milhaud, par la Compagnie Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault en 1953.
- Le Festin de la sagesse : création à Rome en 1950.
- Jeanne d'Arc au bûcher : création en langue allemande à Bâle en 1938. Repris au Théâtre National Populaire de Chaillot en 1942.
- L'Histoire de Tobie et de Sara : création à Roubaix par la troupe des Francs-Alleux en février puis au festival d'Avignon en septembre 1947.
Lettre de Paul Claudel à Jean-Louis Barrault, 25 août 1954
Cher Jean-Louis,
Quelle tournée triomphale et quelle fierté pour le vieux bonhomme de voir son nom ainsi associé à votre bulletin de victoire ! Mes ennemis m'ont représenté longtemps comme l'auteur difficile, abscons, inactuel, par excellence. Or il arrive que je suis le seul qui sur un plan élevé ait écrit des drames vraiment populaires, chez tous les peuples de toutes les langues ! Il est vrai que la Providence avait mis sur mon chemin Jean-Louis Barrault. Le jour où je vous ai rencontré a été un heureux jour ! Espérons qu'il sera suivi de beaucoup d'autres.
Vous comprenez combien l'initiative du cardinal de Rio pour son Congrès eucharistique me fait plaisir. Je ne vois pas quel auteur italien pourrait me faire concurrence, et la sympathie du Pape qu'il m'a montrée au jubilé de 1950 où il s'en est fallu de peu que L'Annonce ne soit représentée au Vatican (par la troupe Hébertot !) est un gros atout pour moi. Cette Annonce tout de même, il faudra que vous vous résigniez à vous en occuper !
Je vais donc, moi, m'occuper de Jean Racine, mon pays ! Ce serait tout de suite si j'avais son théâtre sous la main. Il n'a cessé de grandir à mes yeux, tandis que Shakespeare faiblissait. Il n'y a pas chez icelui un vrai rôle de femme. Cette pièce de Macbteh qu'on vient de jouer à Orange, quelle faiblesse de psychologie dans la peinture du crime et du remords. Tout est sacrifié à un pittoresque naïf. Que de suggestions avortées ! Je ne sais si vous avez lu les critiques terribles d'Ernest Hello. – Et pourtant c'est vraiment un grandissime bonhomme. Il a ce qu'il a laissé à son successeur Balzac, l'entrain ! Je viens de relire Le Lys dans la vallée. C'est plein de choses impayables : « Vous pouvez me poursuivre de vos importunités, Monsieur ! ma tante n'est plus ! » – « Je suis né dans le Lancashire, un pays où les femmes meurent d'amour ! » – Et pourtant le génie éclate à tout bout de champ. Rien que l'entrée en matière...
Jean Racine, c'est autre chose, un cas unique, scandaleux. Un art dépouillé de tout pittoresque, pas d'images, tout ce qu'on appelle conventions mondaines passionnément incorporées, et c'est Britannicus, le type du drame parfait – Phèdre, la passion même dans une fournaise d'art et de poésie... [...]
Amitiés à Madeleine, à vous, et à tous mes braves camarades de la galère capitane.
Paul Claudel
Extrait de Paul Claudel et Jean-Louis Barrault, Correspondance 1939-1954, Gallimard, 1974. Repris dans « Les Cahiers de la NRF » en 2010.