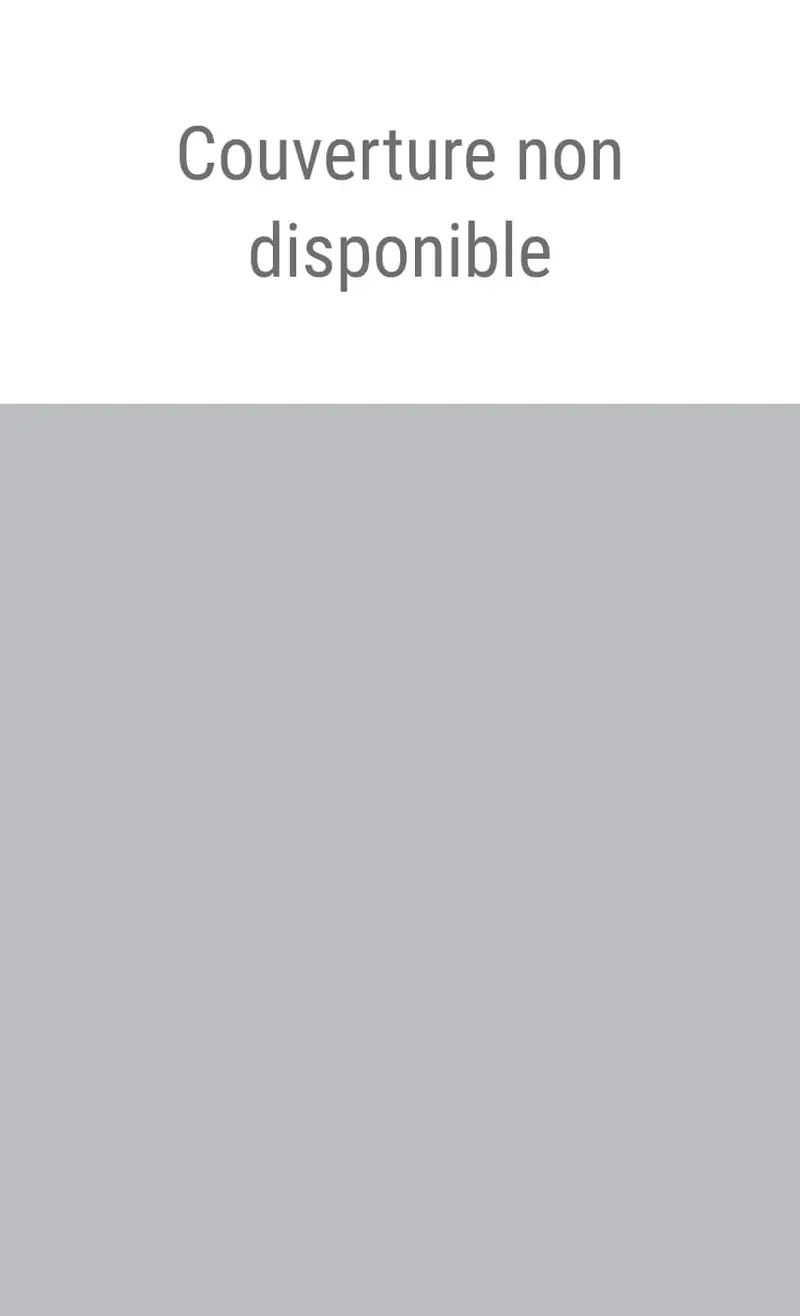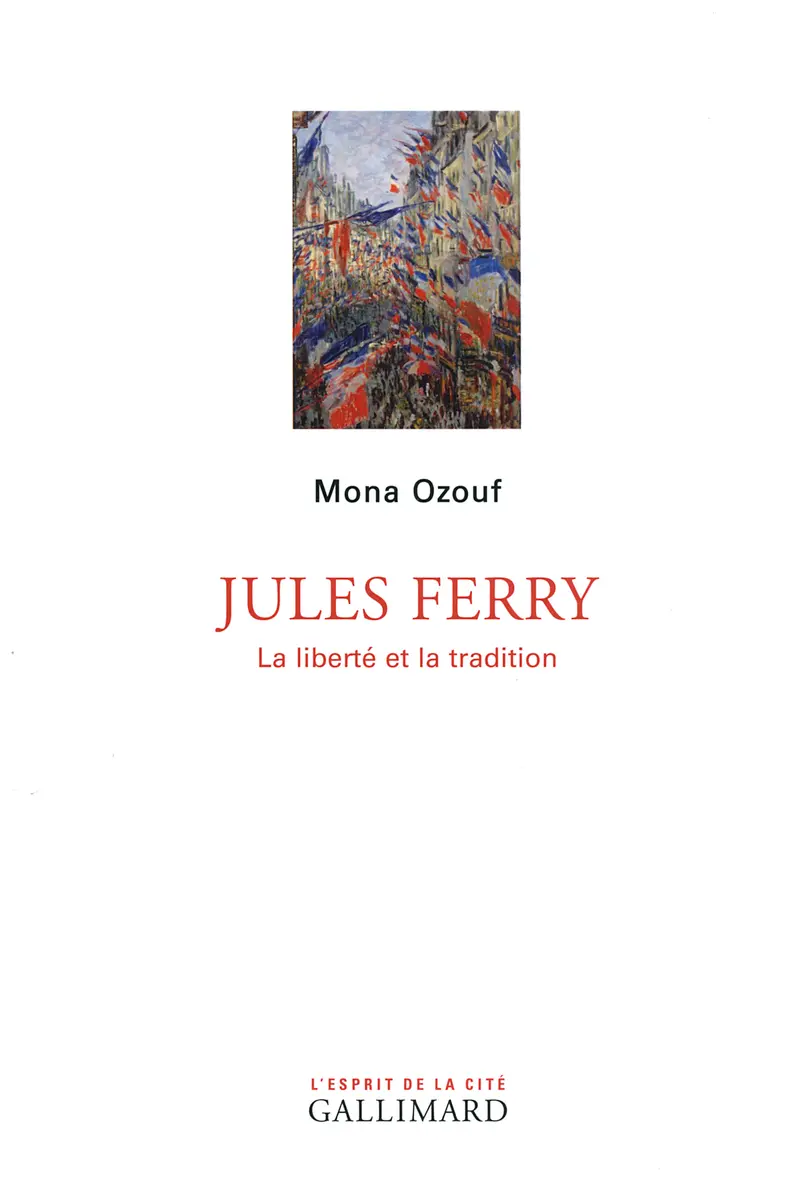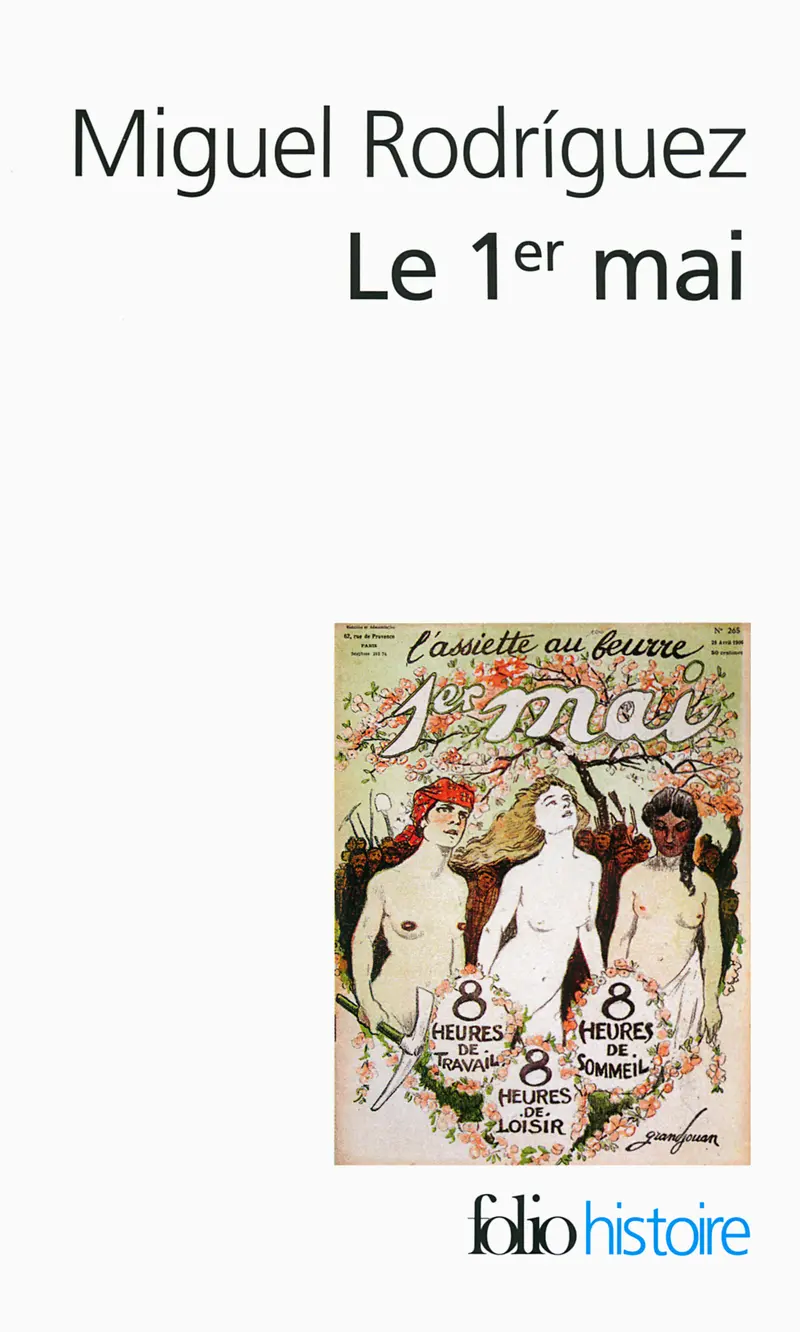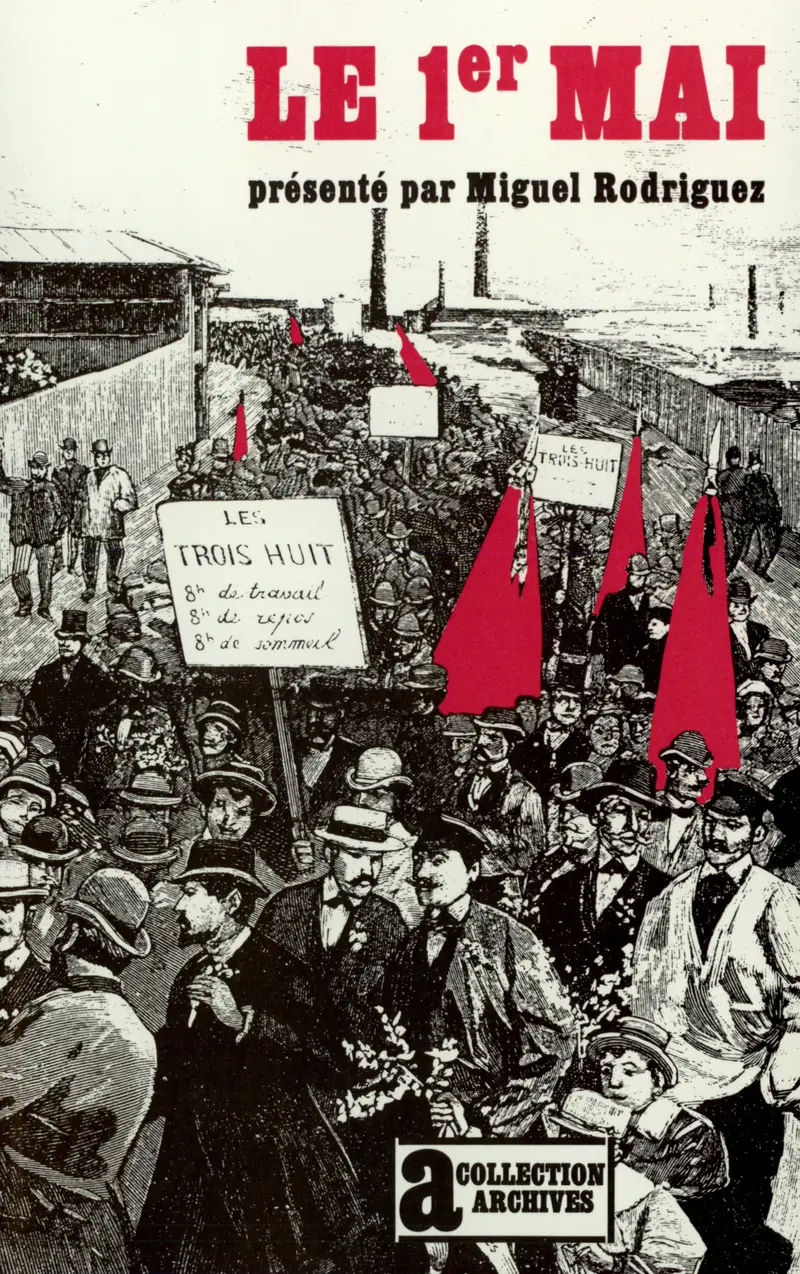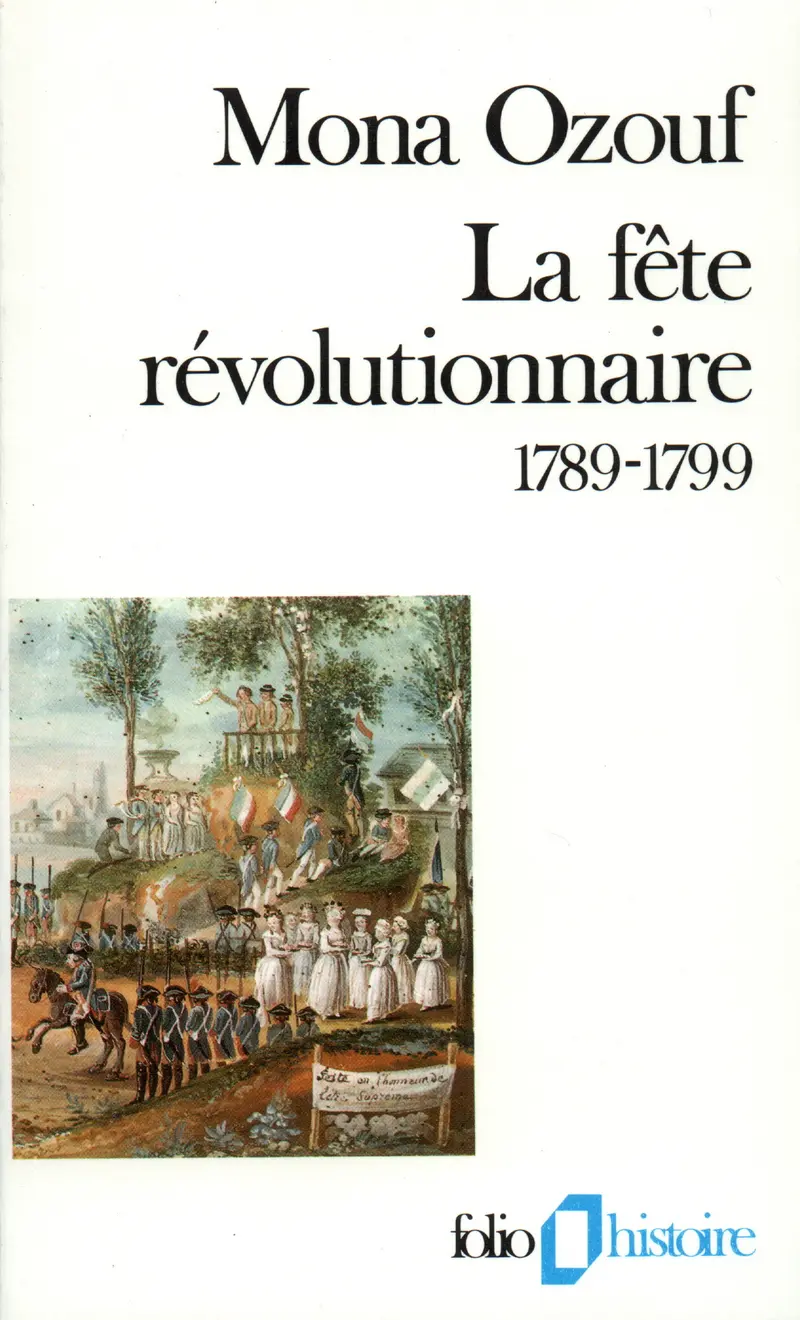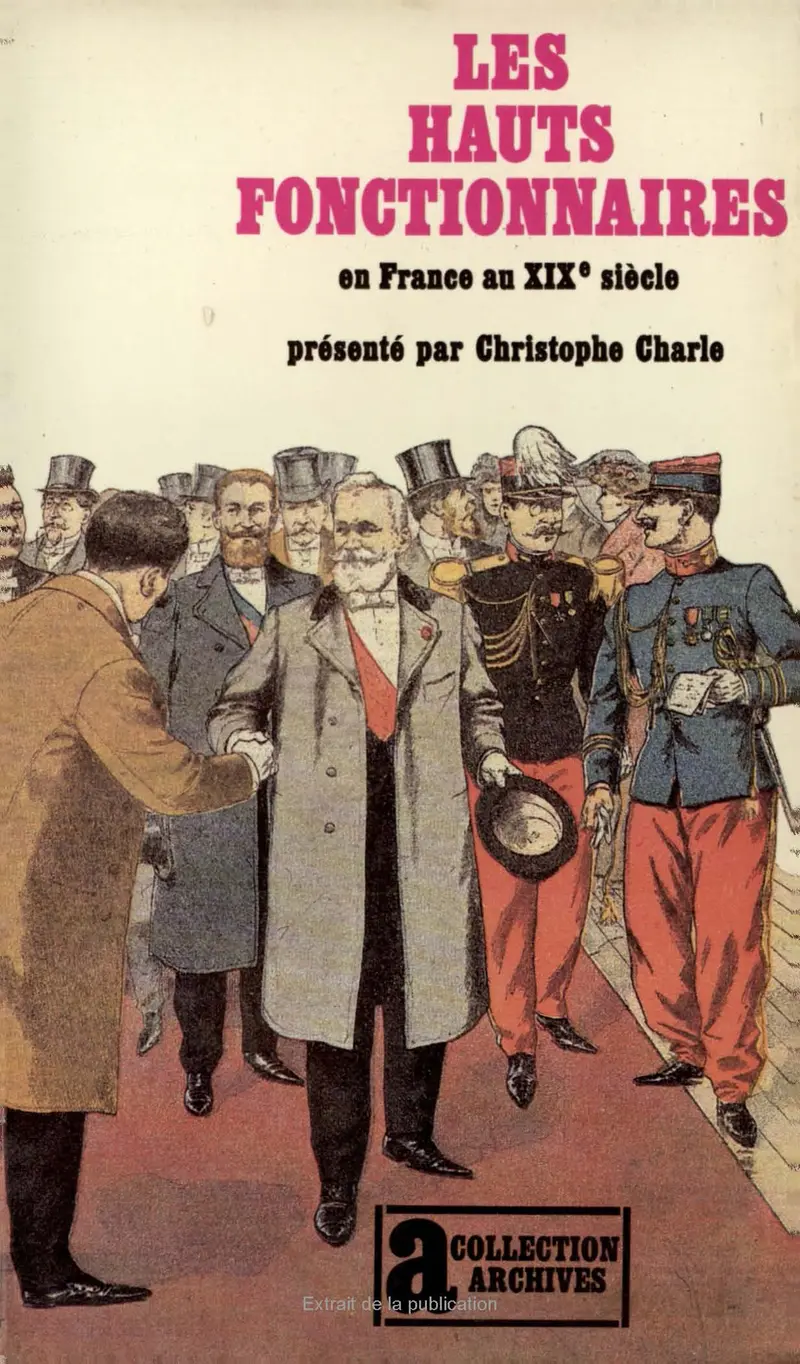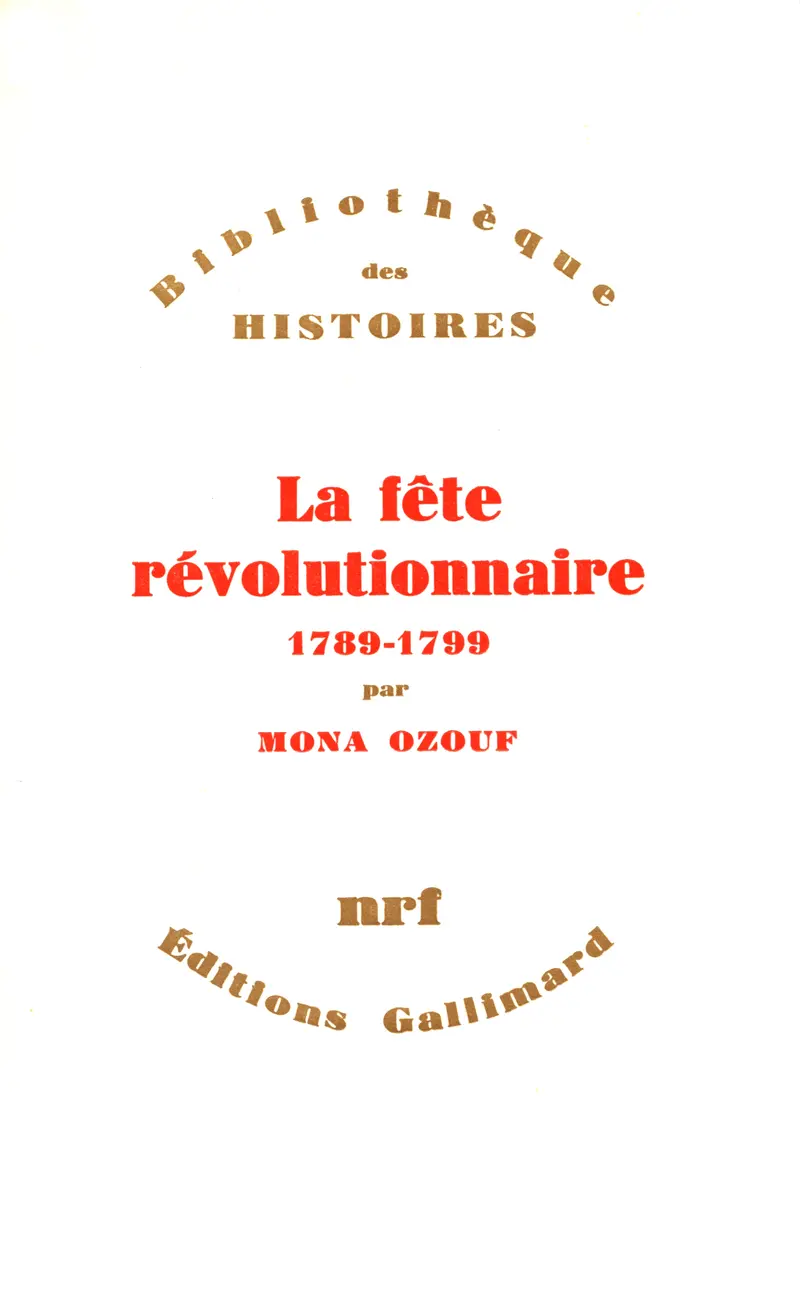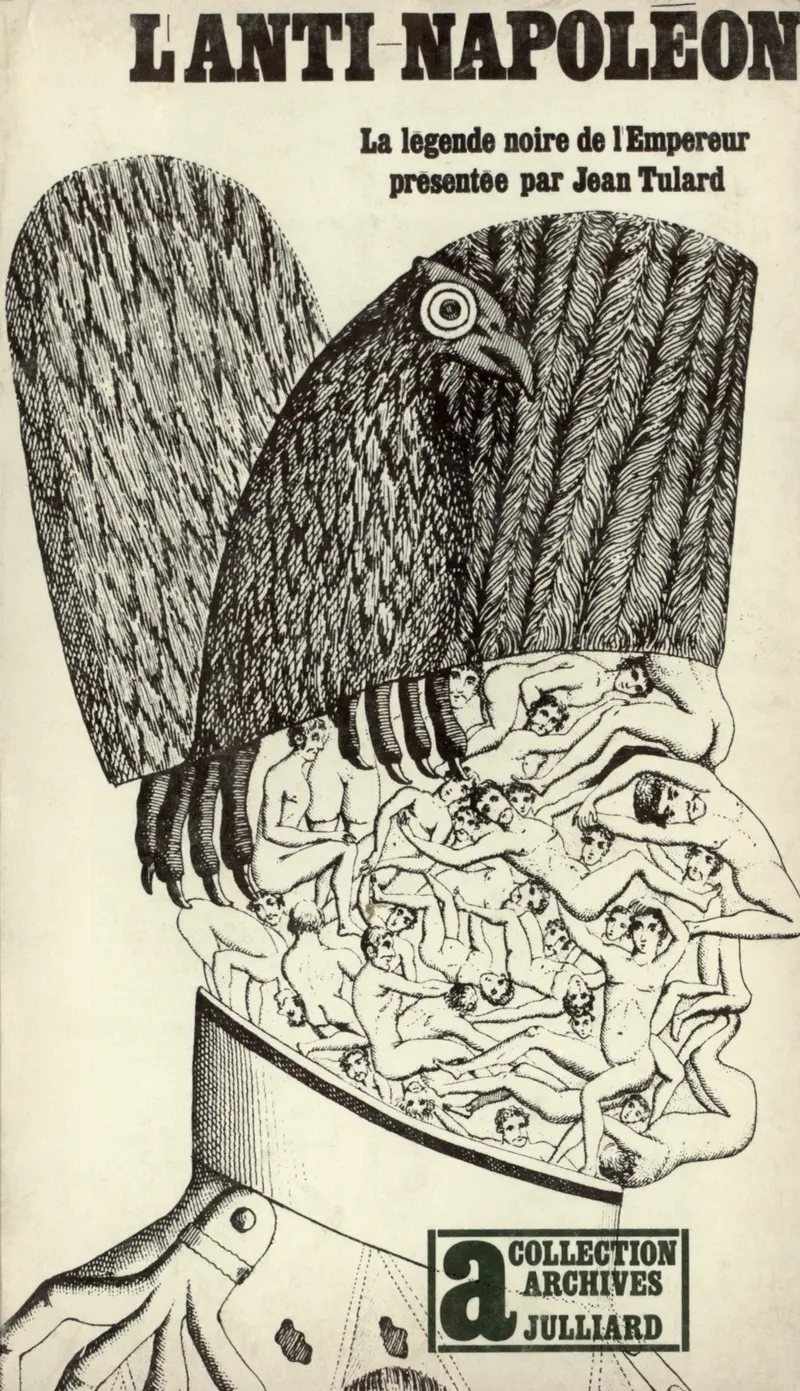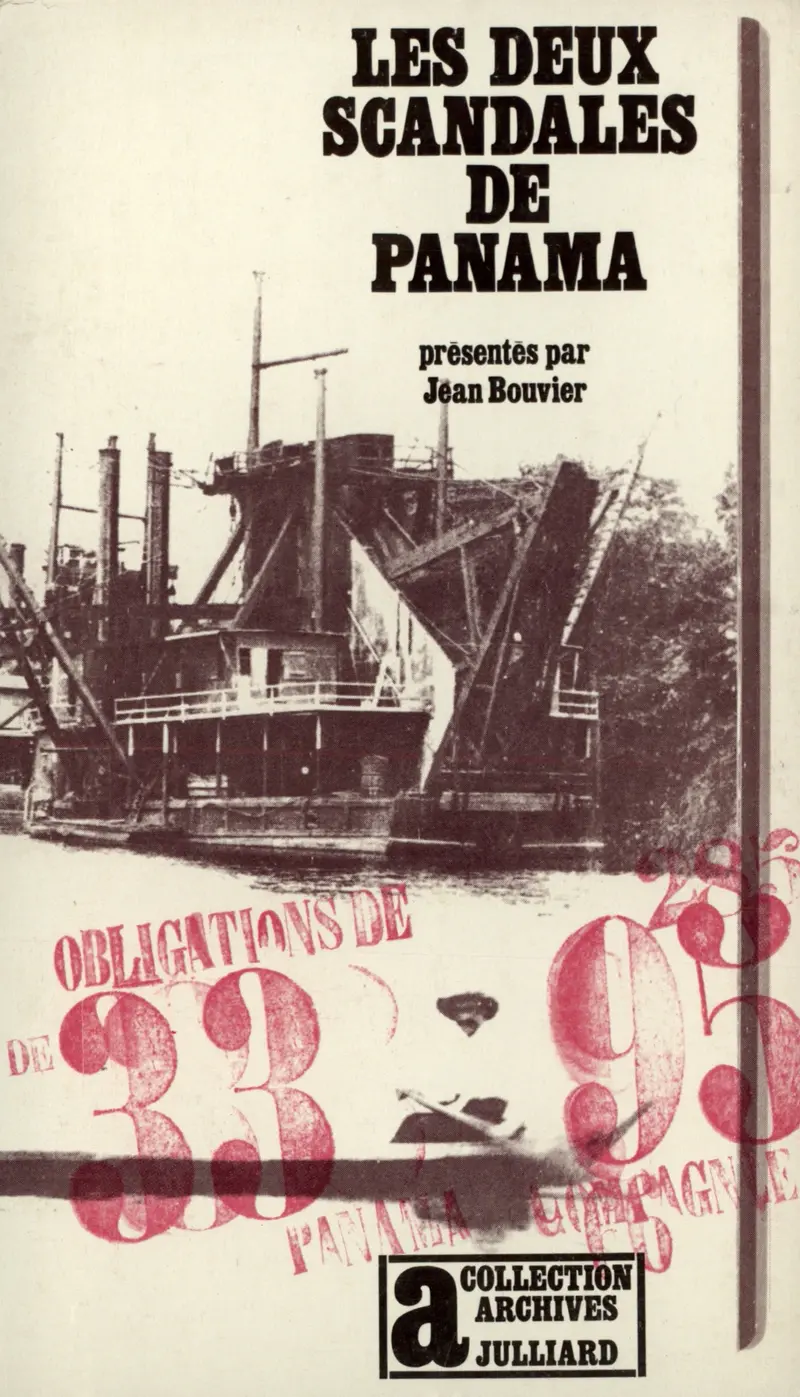Rouvier et les Finances
Collection Sous la Troisième
Gallimard
Parution
À chaque fois que se produit un incident financier ou que se pose en cette vaste matière un problème important, nos contemporains se croient favorisés de difficultés spéciales et s'en consolent en songeant qu'ils jouent un rôle flatteur de victimes privilégiées. Il leur faut déchanter. L'histoire financière est plus fertile que toute autre en recommencements.
Les quarante premières années de la République ont développé une courbe financière dont nous repassons aujourd'hui assez exactement le début.
D'abord la liquidation de la guerre de 1870. Ici apparaît une divergence notable avec le présent, et qui n'est point seulement dans les ordres de grandeur. La France fut un débiteur correct et consciencieux : elle a employé toute son énergie et toute son ingéniosité à se libérer, et non, comme l'Allemagne, à éluder ses obligations. Ce faisant, elle connut et résolut notamment ces problèmes de transfert qui ont tant préoccupé en ces dernières années l'opinion internationale.
Autre variante : nous ignorâmes voici soixante ans la crise financière et la crise monétaire, mais, nos affaires rétablies, l'analogie redevient frappante.
Environ les années 1880, les finances sont prospères et le trésor garni. On croit, à cette vue, qu'a sonné l'heure de la facilité. Sous la pression de besoins diversement vérifiés, les dépenses publiques augmentent rapidement, tandis qu'on vote des dégrèvements d'impôts. La voie du déficit est ouverte, où nous pousse de surcroît le plan Freycinet, qui correspondait à une grande idée, mais comportait le grave défaut d'un contrôle insuffisant dans l'exécution et d'un appel exagéré au crédit.
Des années passent, et pour concourir à l'équilibre du budget au moins autant que par souci d'une bonne gestion financière, s'ouvre l'ère des conversions. Ici, ainsi qu'il sera expliqué au cours de cette étude, nous devons nous garder de trop promptes assimilations. Le problème qui nous est posé est infiniment plus compliqué que celui que résolurent nos pères.
Enfin la bataille autour de l'Impôt sur le revenu nous montre la politique dominant la finance, et réussissant à transformer en arme de partisans une formule fiscale hautement défendable, jadis suggérée dans le calme le plus complet.
Ces divers événements et enseignements sont ici groupés autour d'une figure centrale, celle de Rouvier. Ce n'est pas à tort, croyons-nous. Rouvier a été pendant des années le grand financier de la République. Il a marqué de son empreinte jusqu'à l'œuvre de ses successeurs.
Cette étude n'est pas que financière : elle empiète à dessein sur l'histoire politique, d'abord parce que la politique commande les bonnes finances, ensuite parce que Rouvier incarne admirablement une génération qui géra d'une certaine manière la fortune française précisément parce que sa position politique et son tempérament naturel lui traçaient cette ligne de conduite.
Moyennant quoi on verra que si la «Troisième» commit des erreurs dans l'administration de ses revenus, elle ne le fit jamais que par passion, cependant qu'au travers des circonstances contraires notre admirable pays travaillait, épargnait,et, soutenant silencieusement la fortune de l'État, réparait, quand il en était besoin, les fautes des gouvernements.
Les quarante premières années de la République ont développé une courbe financière dont nous repassons aujourd'hui assez exactement le début.
D'abord la liquidation de la guerre de 1870. Ici apparaît une divergence notable avec le présent, et qui n'est point seulement dans les ordres de grandeur. La France fut un débiteur correct et consciencieux : elle a employé toute son énergie et toute son ingéniosité à se libérer, et non, comme l'Allemagne, à éluder ses obligations. Ce faisant, elle connut et résolut notamment ces problèmes de transfert qui ont tant préoccupé en ces dernières années l'opinion internationale.
Autre variante : nous ignorâmes voici soixante ans la crise financière et la crise monétaire, mais, nos affaires rétablies, l'analogie redevient frappante.
Environ les années 1880, les finances sont prospères et le trésor garni. On croit, à cette vue, qu'a sonné l'heure de la facilité. Sous la pression de besoins diversement vérifiés, les dépenses publiques augmentent rapidement, tandis qu'on vote des dégrèvements d'impôts. La voie du déficit est ouverte, où nous pousse de surcroît le plan Freycinet, qui correspondait à une grande idée, mais comportait le grave défaut d'un contrôle insuffisant dans l'exécution et d'un appel exagéré au crédit.
Des années passent, et pour concourir à l'équilibre du budget au moins autant que par souci d'une bonne gestion financière, s'ouvre l'ère des conversions. Ici, ainsi qu'il sera expliqué au cours de cette étude, nous devons nous garder de trop promptes assimilations. Le problème qui nous est posé est infiniment plus compliqué que celui que résolurent nos pères.
Enfin la bataille autour de l'Impôt sur le revenu nous montre la politique dominant la finance, et réussissant à transformer en arme de partisans une formule fiscale hautement défendable, jadis suggérée dans le calme le plus complet.
Ces divers événements et enseignements sont ici groupés autour d'une figure centrale, celle de Rouvier. Ce n'est pas à tort, croyons-nous. Rouvier a été pendant des années le grand financier de la République. Il a marqué de son empreinte jusqu'à l'œuvre de ses successeurs.
Cette étude n'est pas que financière : elle empiète à dessein sur l'histoire politique, d'abord parce que la politique commande les bonnes finances, ensuite parce que Rouvier incarne admirablement une génération qui géra d'une certaine manière la fortune française précisément parce que sa position politique et son tempérament naturel lui traçaient cette ligne de conduite.
Moyennant quoi on verra que si la «Troisième» commit des erreurs dans l'administration de ses revenus, elle ne le fit jamais que par passion, cependant qu'au travers des circonstances contraires notre admirable pays travaillait, épargnait,et, soutenant silencieusement la fortune de l'État, réparait, quand il en était besoin, les fautes des gouvernements.