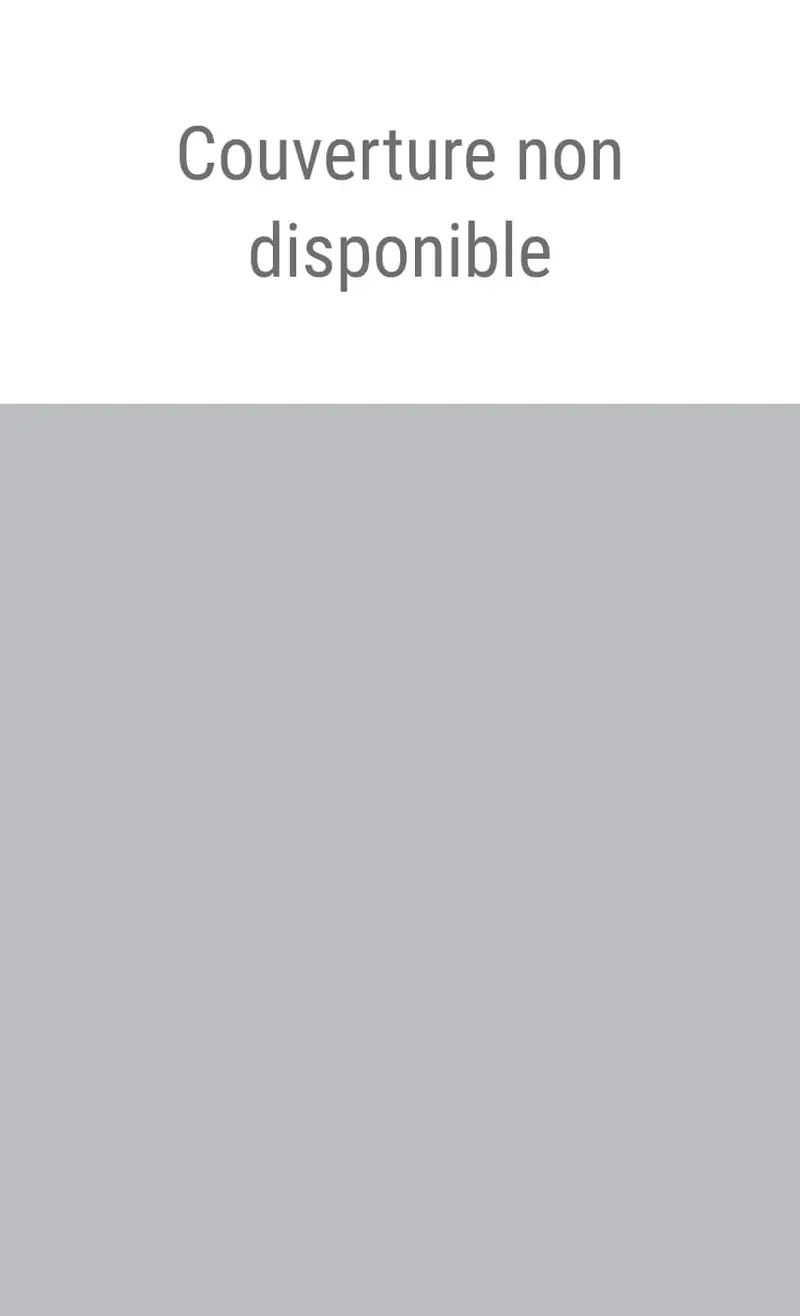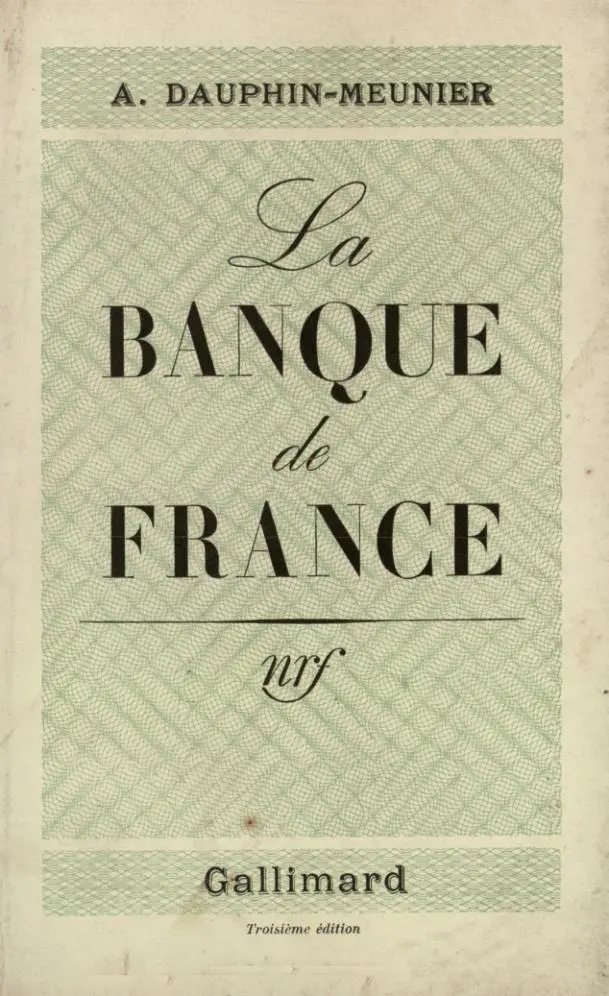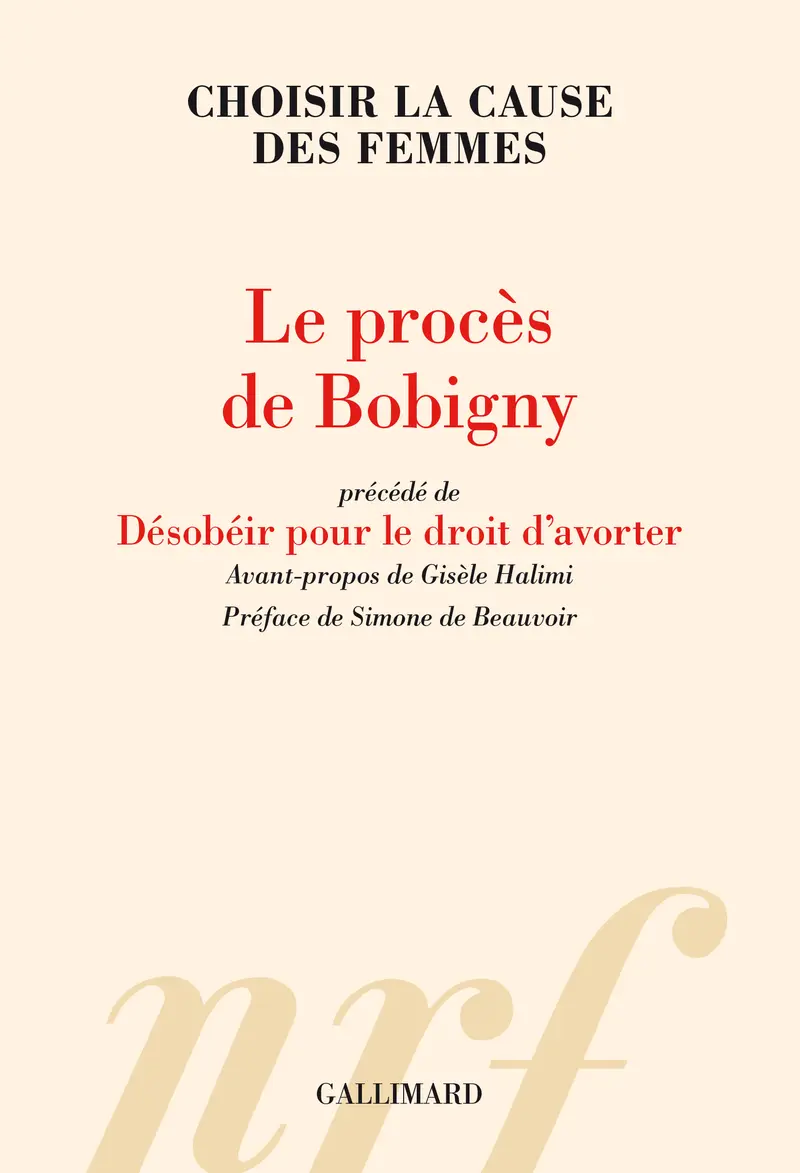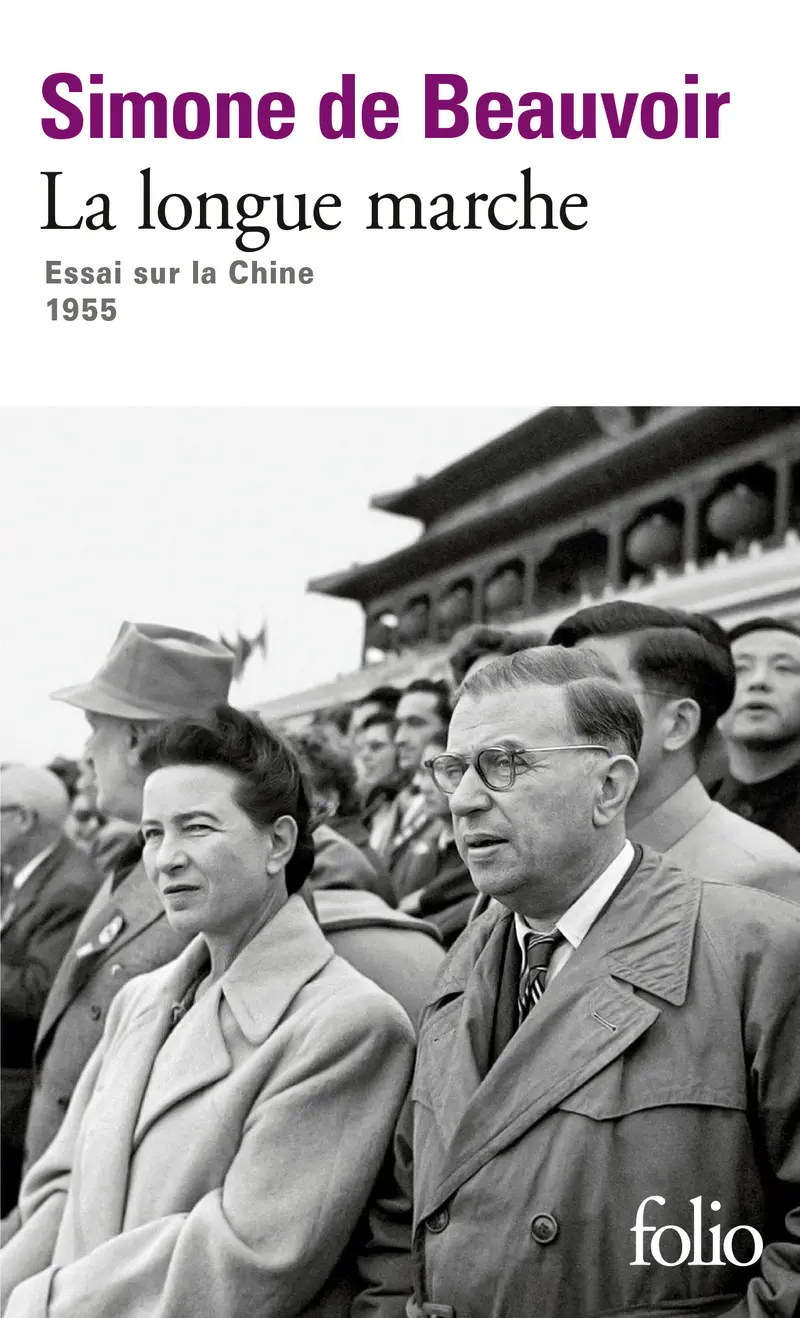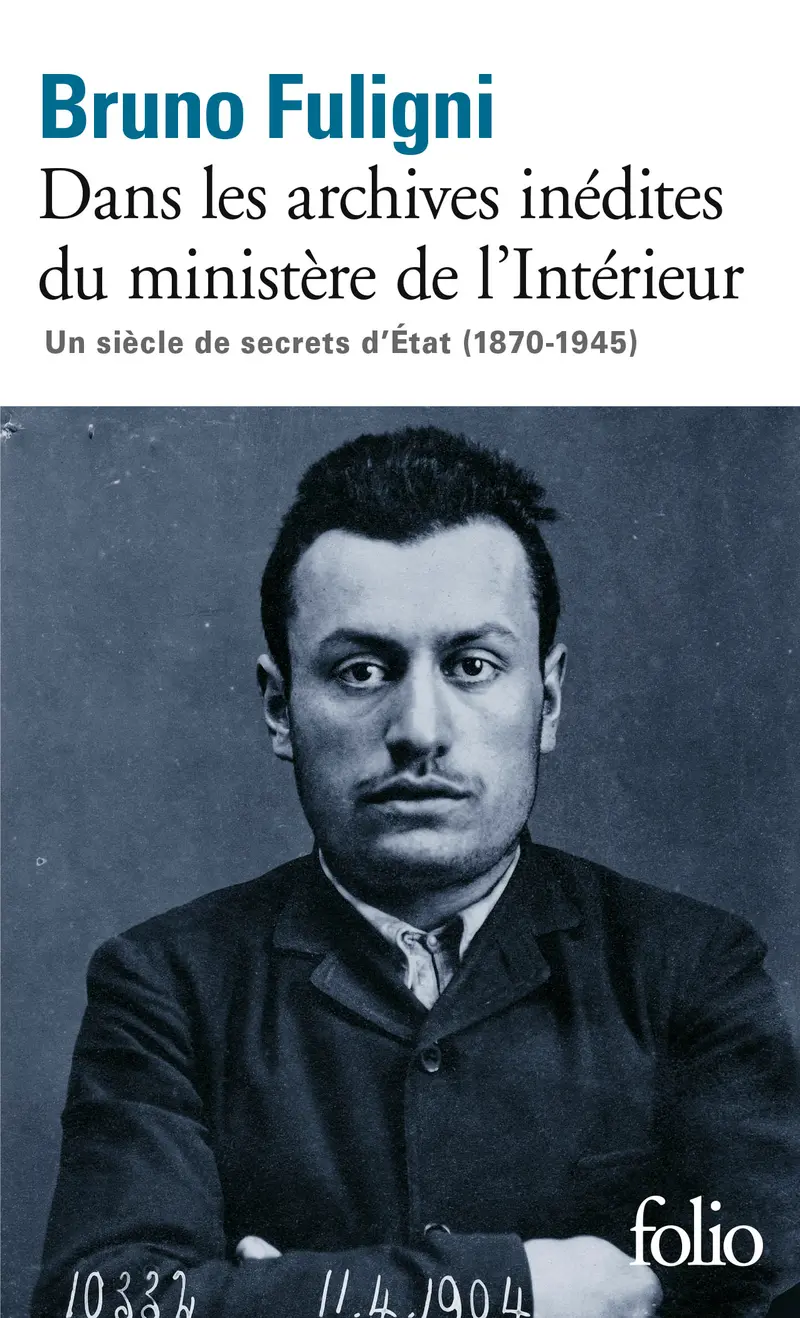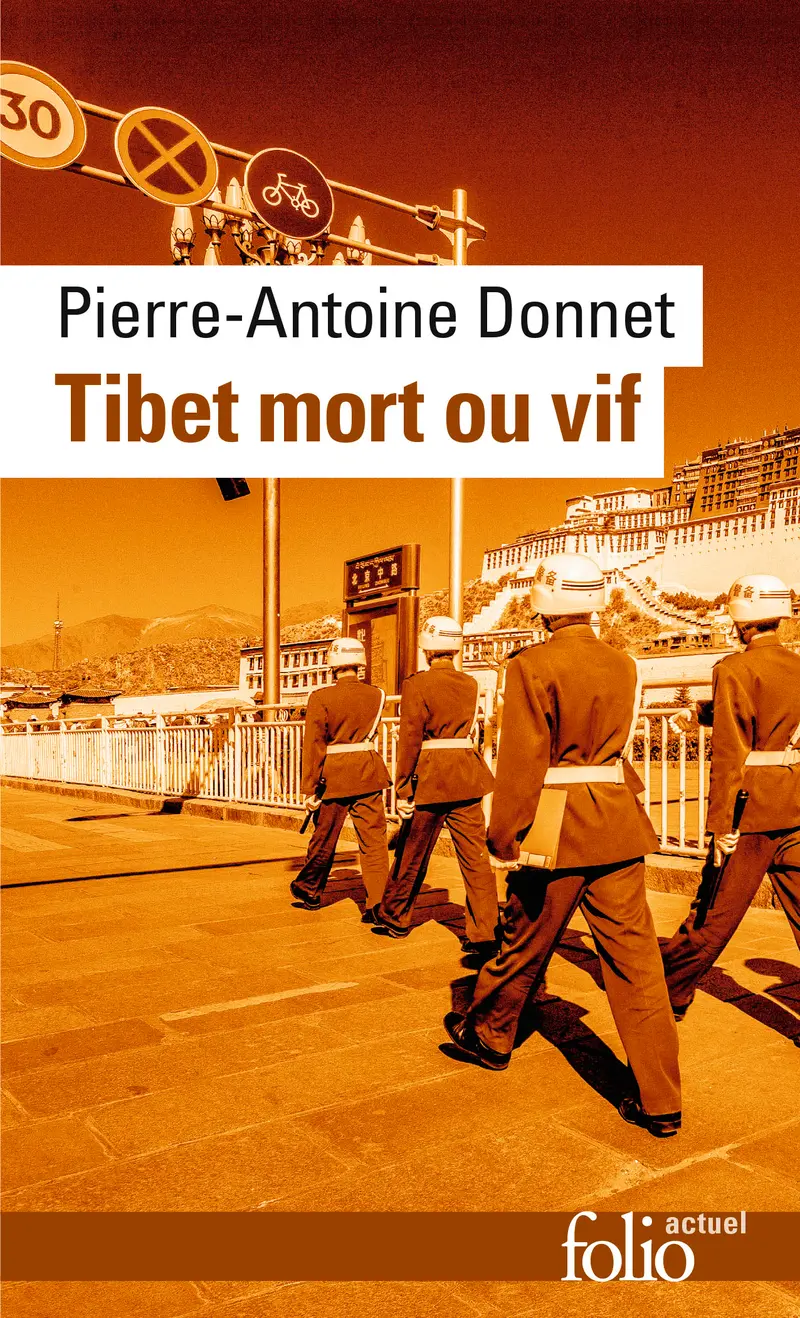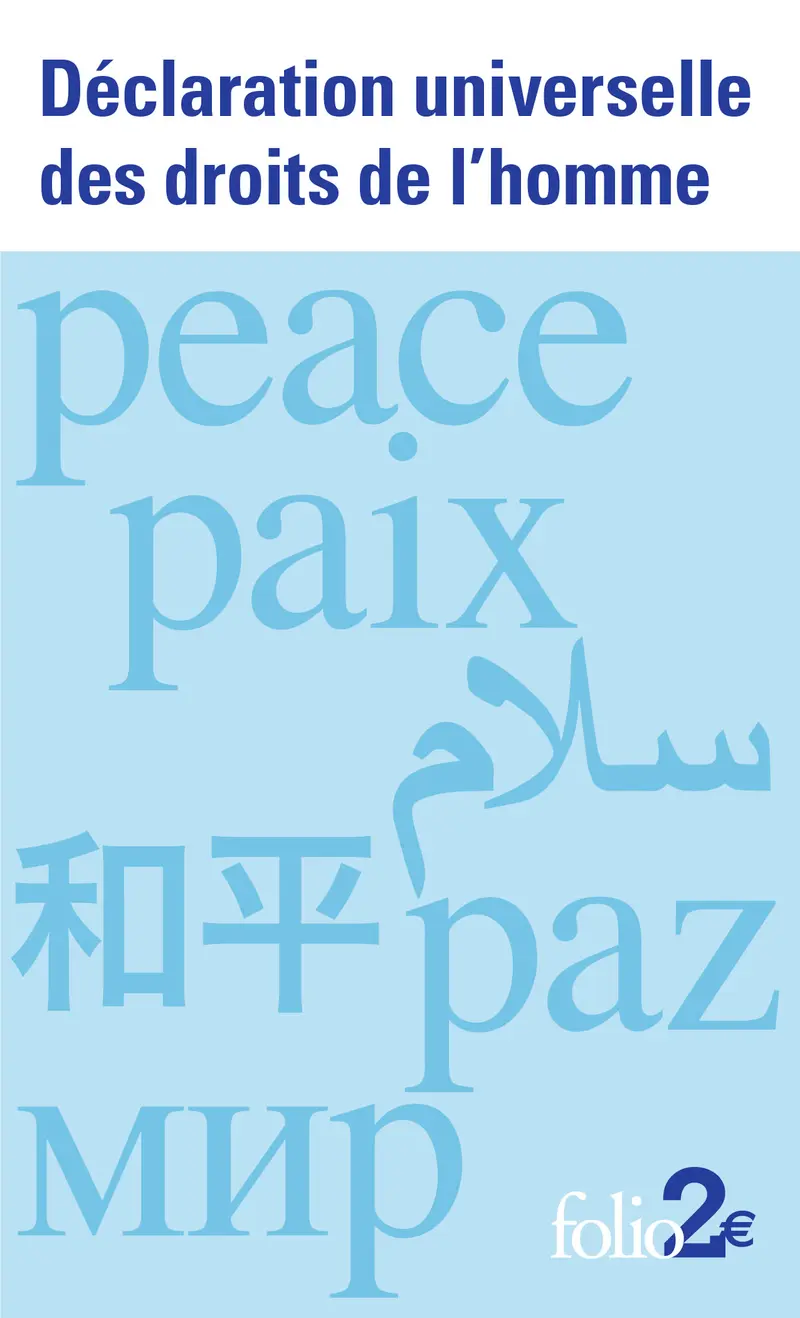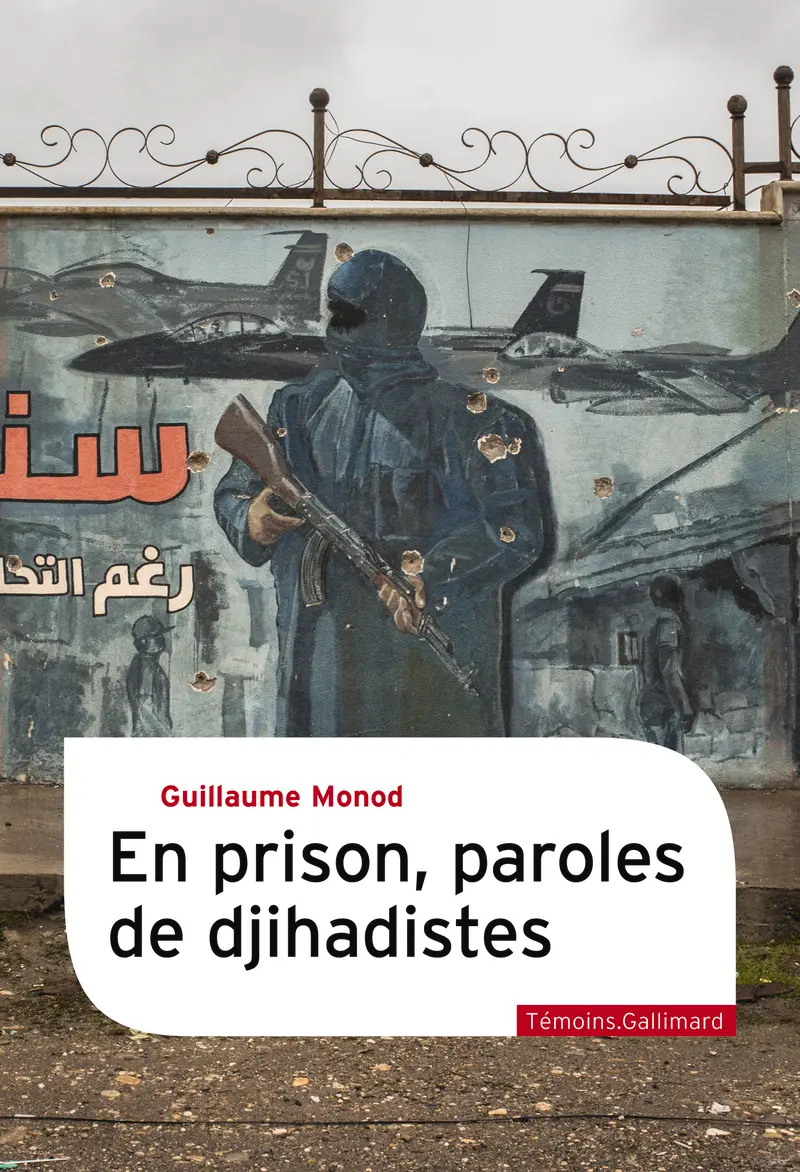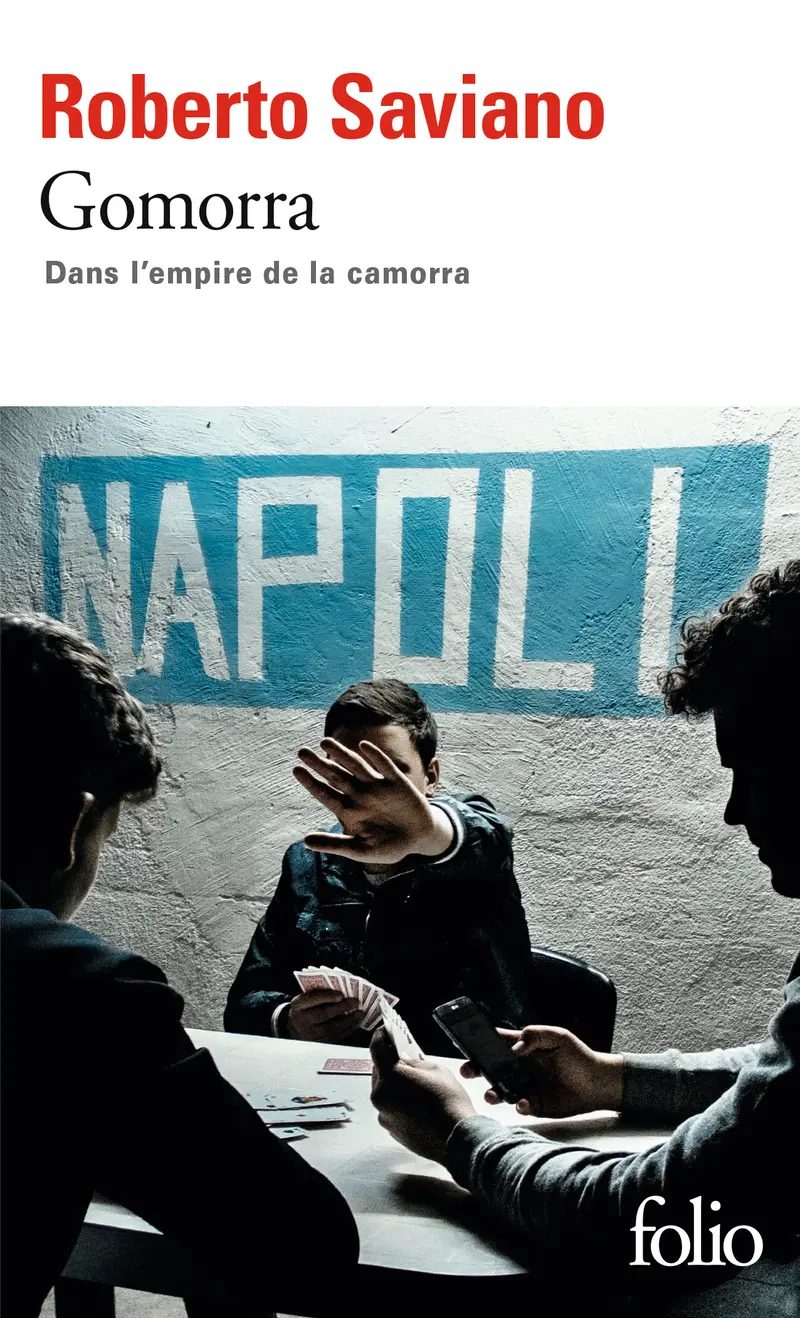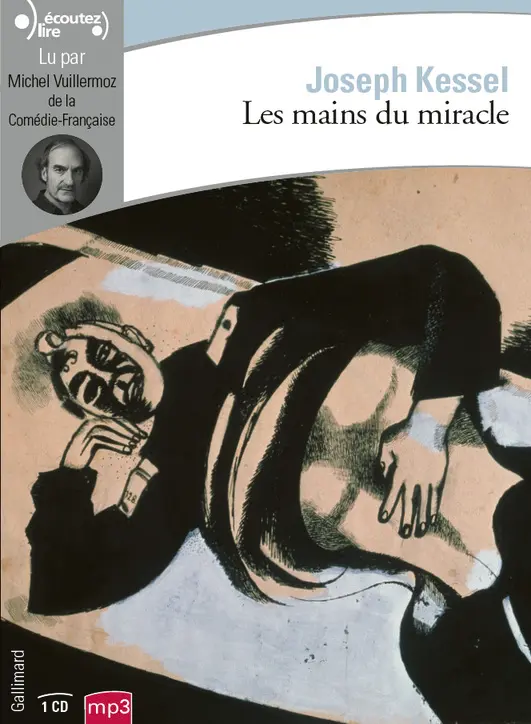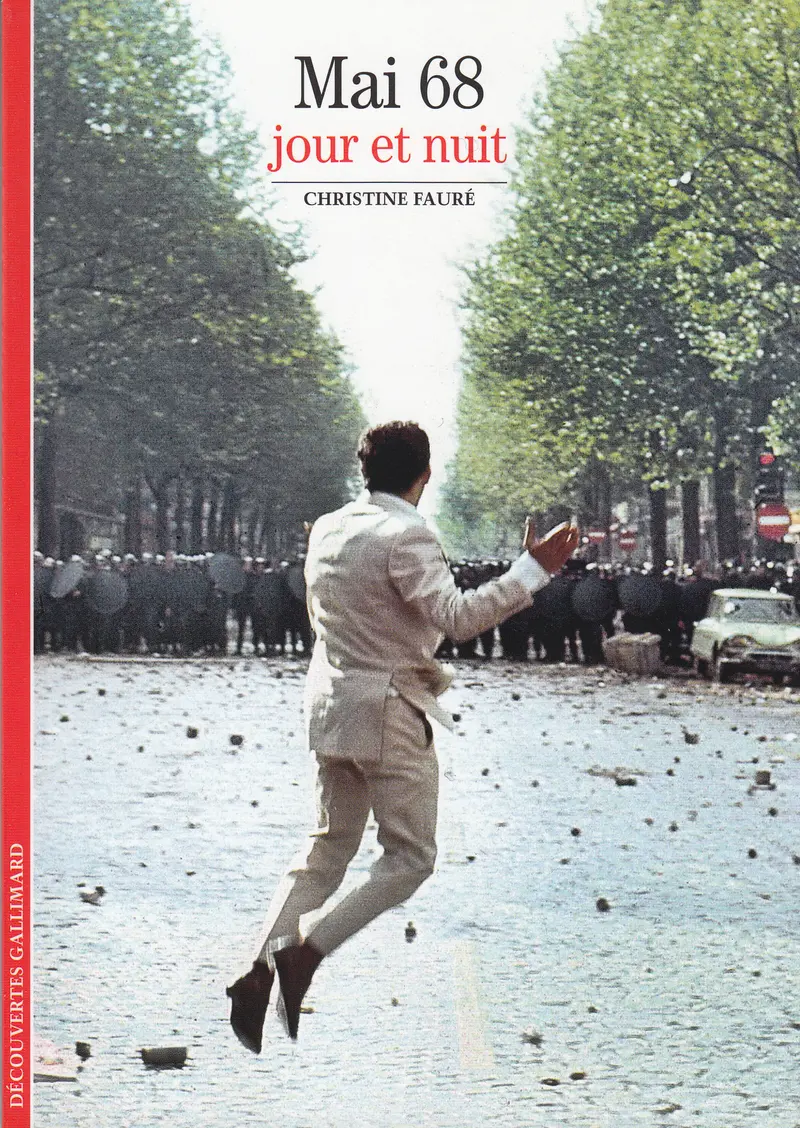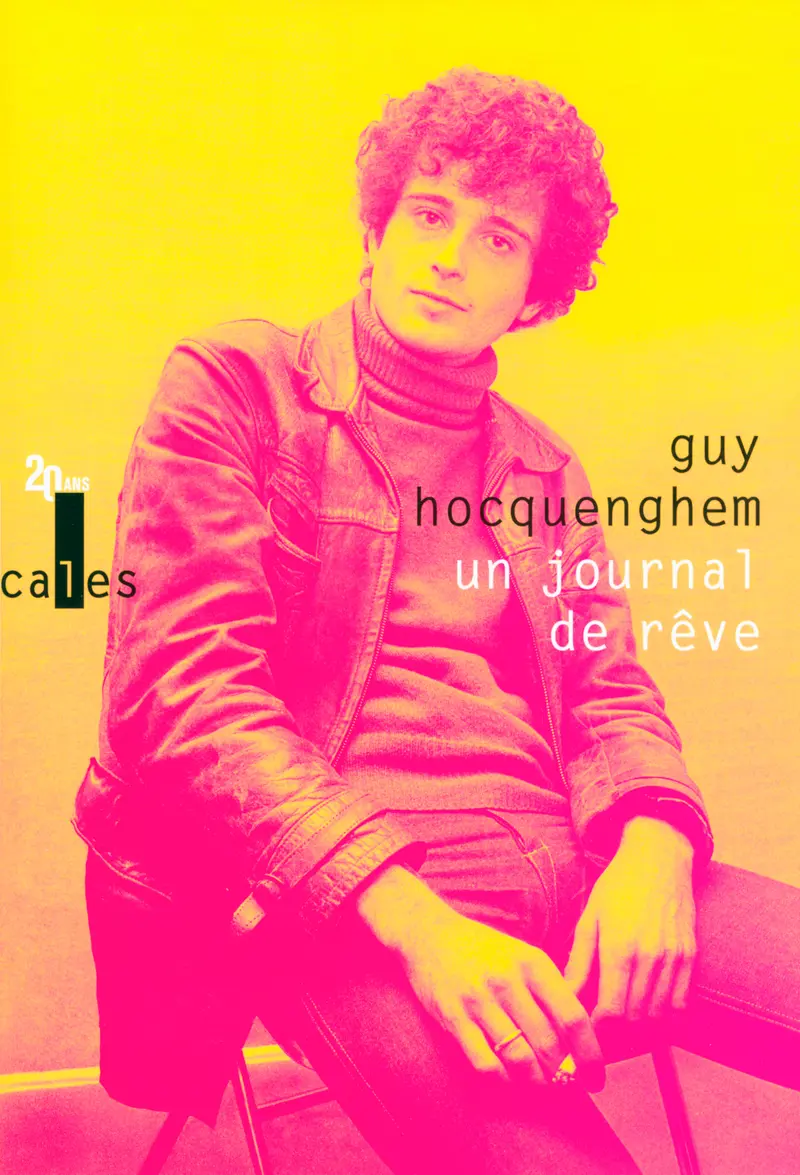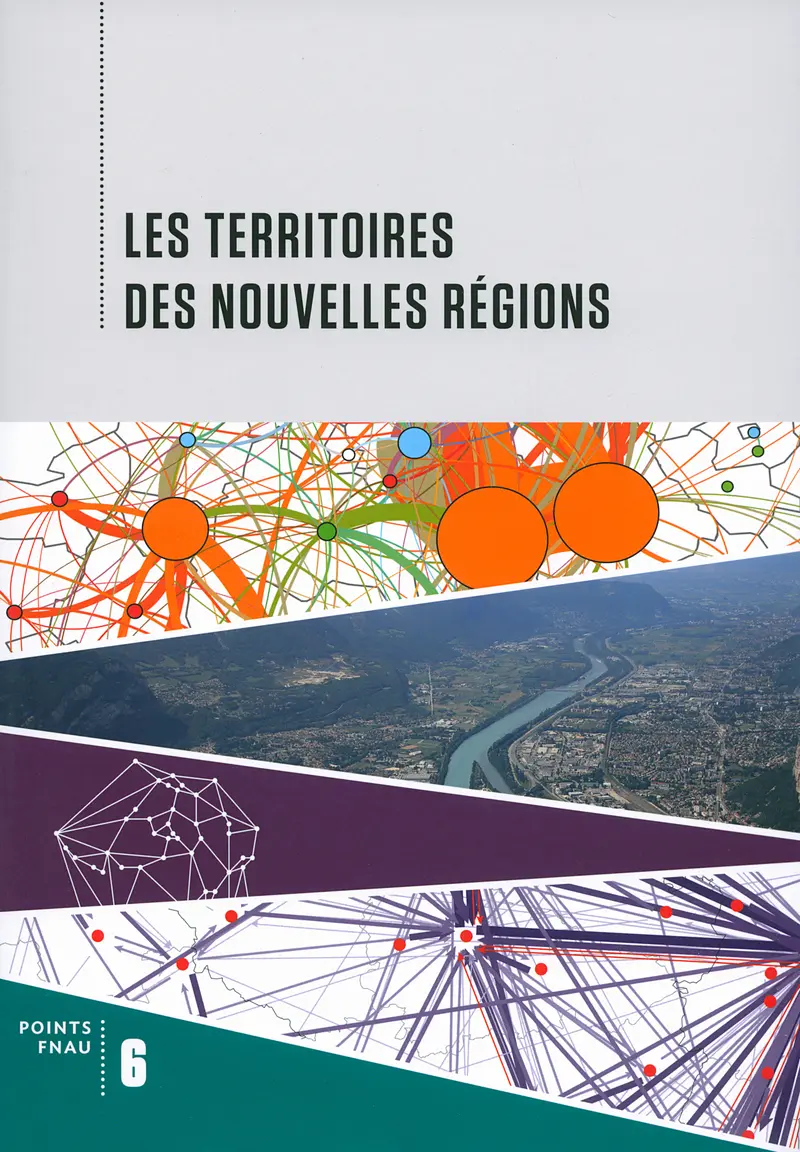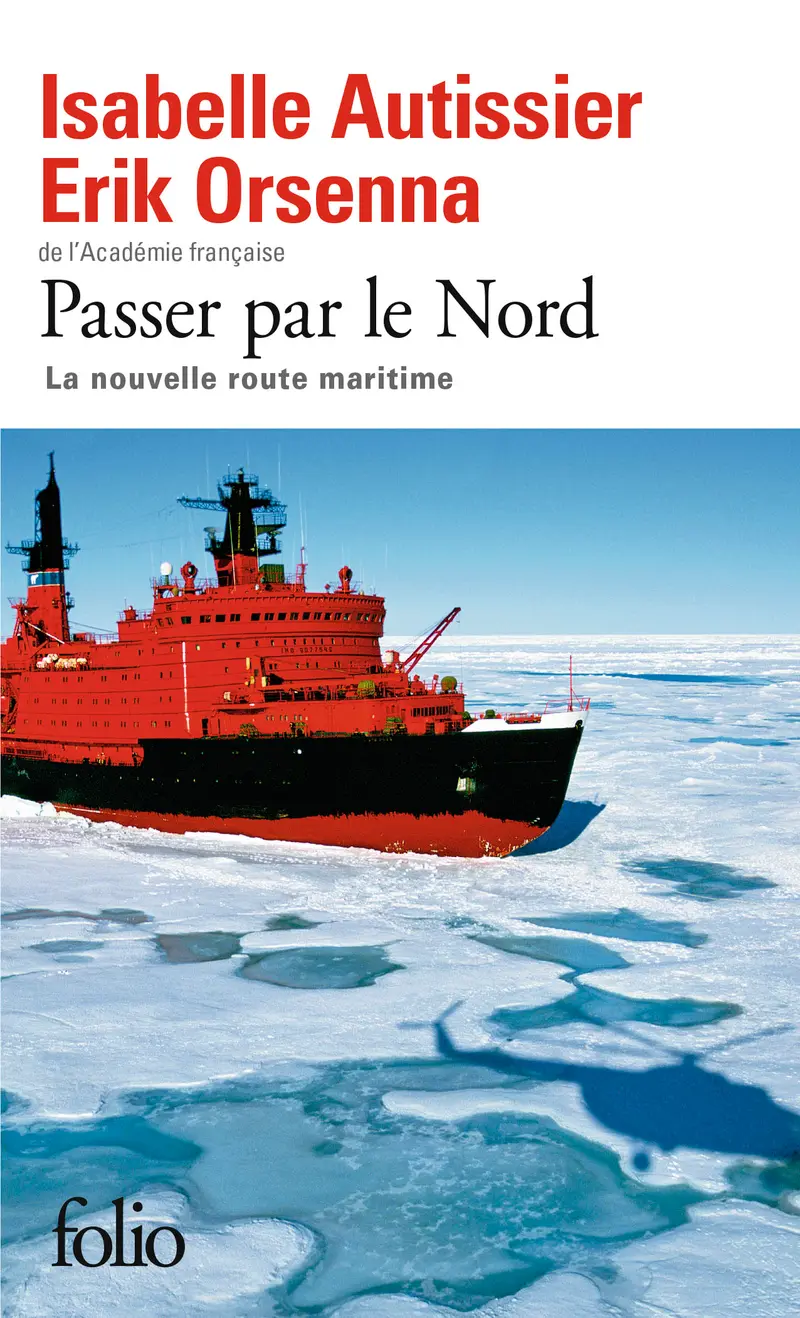La Banque
(1919-1935)
Collection Problèmes et Documents
Gallimard
Parution
La science de la Banque, l'art de la Banque ne sont point à leur terme. Il n'est pas de science et d'art auxquels on puisse ainsi assigner un terme. Mais une certaine conception de la Banque est assurément aujourd'hui révolue.
Pendant des siècles (à Babylone, en Judée, en Grèce), l'activité du banquier a revêtu aux yeux des masses un caractère religieux. C'était du ciel qu'il tenait son pouvoir de transformer le lingot en pièces, l'argent en crédit, de tirer des revenus d'une marchandise stérile. Il semblait avoir fait un pacte avec les dieux ; en vertu de ce pacte, il pouvait déposer ses trésors dans les temples et commercer sur les parvis des sanctuaires.
L'Église chrétienne ne chassa pas les dieux ; elle en fit des démons. La Banque devint infernale, comme ses dieux protecteurs. Seuls, des réprouvés, comme les juifs, pouvaient faire trafic d'argent, prêter à intérêt. Et si par hasard des chrétiens (les moines Templiers) s'avisaient de les imiter, la voix publique d'accord avec la Justice, était unanime à les accuser de diableries. Le plus moderne des rois du Moyen Âge, notre Philippe le Bel, inventeur de la dévaluation et du contrôle des banques, ne parvint à détruire cette foi qu'en paraissant s'y associer.
La fin violente des Templiers marque le terme d'une époque de l'histoire bancaire. Les rois ne brûleront plus les banquiers ; ils les associeront à leur fortune pour construire le monde moderne. Toutes les grandes révolutions seront faites avec le concours des banquiers, qu'il s'agisse de la Réforme et de la Renaissance auxquelles demeureront liés les noms des Fugger et des Médicis, de la République de Cromwell, des révolutions françaises des XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles.
Mais à faire des révolutions dont le peuple n'est que l'instrument, les banquiers ont appris au peuple à connaître ses vrais maîtres. La révolution qui marquera le XXᵉ siècle n'est plus comme les précédentes une entreprise de banquiers ; c'est la révolution des peuples contre la Banque. Et les signes en sont déjà présents.
Par delà les frontières, quels que soient les régimes, les peuples s'insurgent contre la tyrannie de l'argent. Ils veulent non seulement qu'il y ait séparation dans le commandement temporel entre le pouvoir des politiques et le pouvoir des financiers (comme dans le spirituel, ils ont obtenu la séparation des Églises et de l'État). Ils exigent désormais que la Banque soit sujette de la Nation.
La Démocratie Économique n'est pas, comme on le prétend, niveleuse. Elle désire simplement que chaque chose soit à sa place et que chaque homme tienne son rang. Elle ne nie point l'importance des affaires de banque. Au contraire, elle l'a des premières reconnue. Mais il ne lui convient pas que le banquier usurpe dans la conduite des gouvernements la place du maître. Décider de la guerre ou de la paix, diriger les esprits et les consciences, au seul gré des intérêts privés, ne sont pas de son ressort. Le banquier l'a longtemps cru ; il le croit surtout depuis la dernière guerre qui fut par excellence la guerre des banquiers. Les peuples vont lui faire payer cher cette croyance.
Et payer d'autant mieux que, par orgueil et manque de circonspection, dans la crise de 1931, partout le banquier s'est perdu lui-même.
Pendant des siècles (à Babylone, en Judée, en Grèce), l'activité du banquier a revêtu aux yeux des masses un caractère religieux. C'était du ciel qu'il tenait son pouvoir de transformer le lingot en pièces, l'argent en crédit, de tirer des revenus d'une marchandise stérile. Il semblait avoir fait un pacte avec les dieux ; en vertu de ce pacte, il pouvait déposer ses trésors dans les temples et commercer sur les parvis des sanctuaires.
L'Église chrétienne ne chassa pas les dieux ; elle en fit des démons. La Banque devint infernale, comme ses dieux protecteurs. Seuls, des réprouvés, comme les juifs, pouvaient faire trafic d'argent, prêter à intérêt. Et si par hasard des chrétiens (les moines Templiers) s'avisaient de les imiter, la voix publique d'accord avec la Justice, était unanime à les accuser de diableries. Le plus moderne des rois du Moyen Âge, notre Philippe le Bel, inventeur de la dévaluation et du contrôle des banques, ne parvint à détruire cette foi qu'en paraissant s'y associer.
La fin violente des Templiers marque le terme d'une époque de l'histoire bancaire. Les rois ne brûleront plus les banquiers ; ils les associeront à leur fortune pour construire le monde moderne. Toutes les grandes révolutions seront faites avec le concours des banquiers, qu'il s'agisse de la Réforme et de la Renaissance auxquelles demeureront liés les noms des Fugger et des Médicis, de la République de Cromwell, des révolutions françaises des XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles.
Mais à faire des révolutions dont le peuple n'est que l'instrument, les banquiers ont appris au peuple à connaître ses vrais maîtres. La révolution qui marquera le XXᵉ siècle n'est plus comme les précédentes une entreprise de banquiers ; c'est la révolution des peuples contre la Banque. Et les signes en sont déjà présents.
Par delà les frontières, quels que soient les régimes, les peuples s'insurgent contre la tyrannie de l'argent. Ils veulent non seulement qu'il y ait séparation dans le commandement temporel entre le pouvoir des politiques et le pouvoir des financiers (comme dans le spirituel, ils ont obtenu la séparation des Églises et de l'État). Ils exigent désormais que la Banque soit sujette de la Nation.
La Démocratie Économique n'est pas, comme on le prétend, niveleuse. Elle désire simplement que chaque chose soit à sa place et que chaque homme tienne son rang. Elle ne nie point l'importance des affaires de banque. Au contraire, elle l'a des premières reconnue. Mais il ne lui convient pas que le banquier usurpe dans la conduite des gouvernements la place du maître. Décider de la guerre ou de la paix, diriger les esprits et les consciences, au seul gré des intérêts privés, ne sont pas de son ressort. Le banquier l'a longtemps cru ; il le croit surtout depuis la dernière guerre qui fut par excellence la guerre des banquiers. Les peuples vont lui faire payer cher cette croyance.
Et payer d'autant mieux que, par orgueil et manque de circonspection, dans la crise de 1931, partout le banquier s'est perdu lui-même.