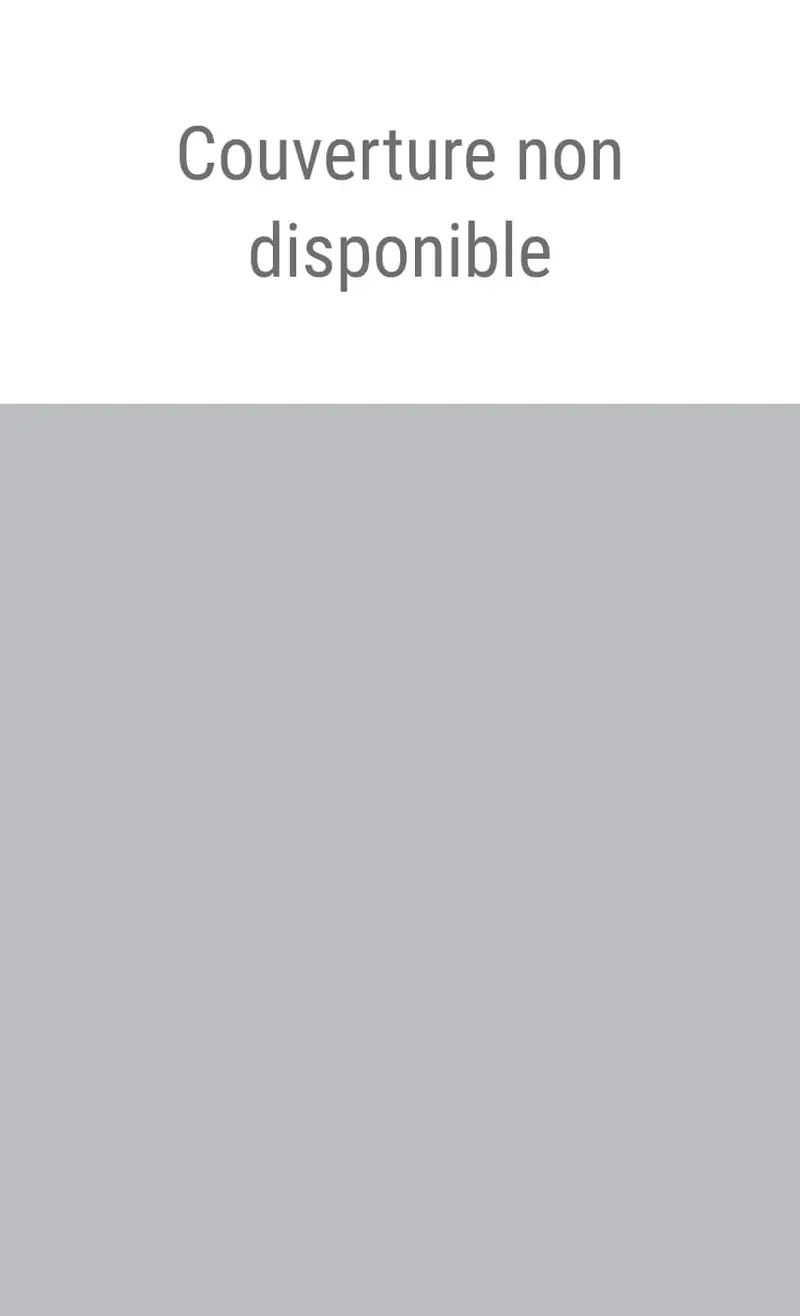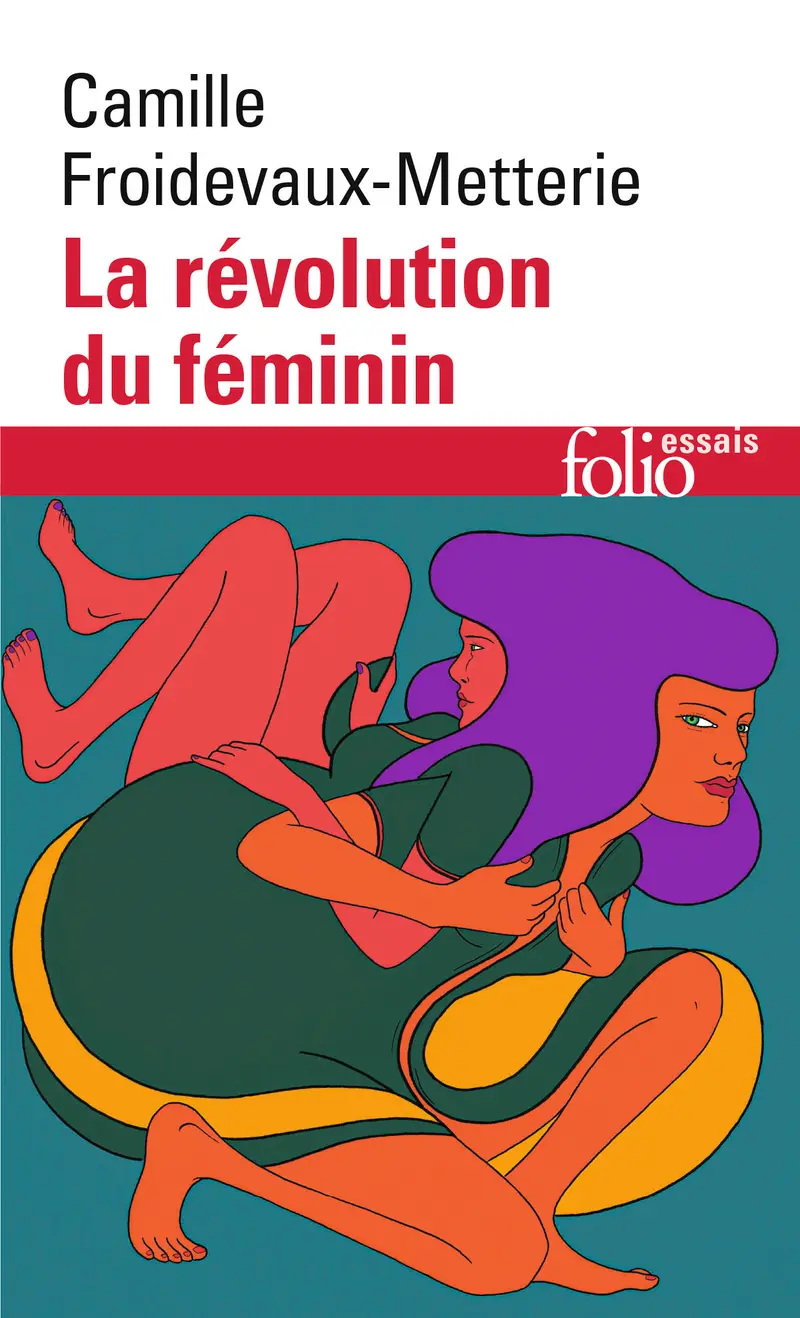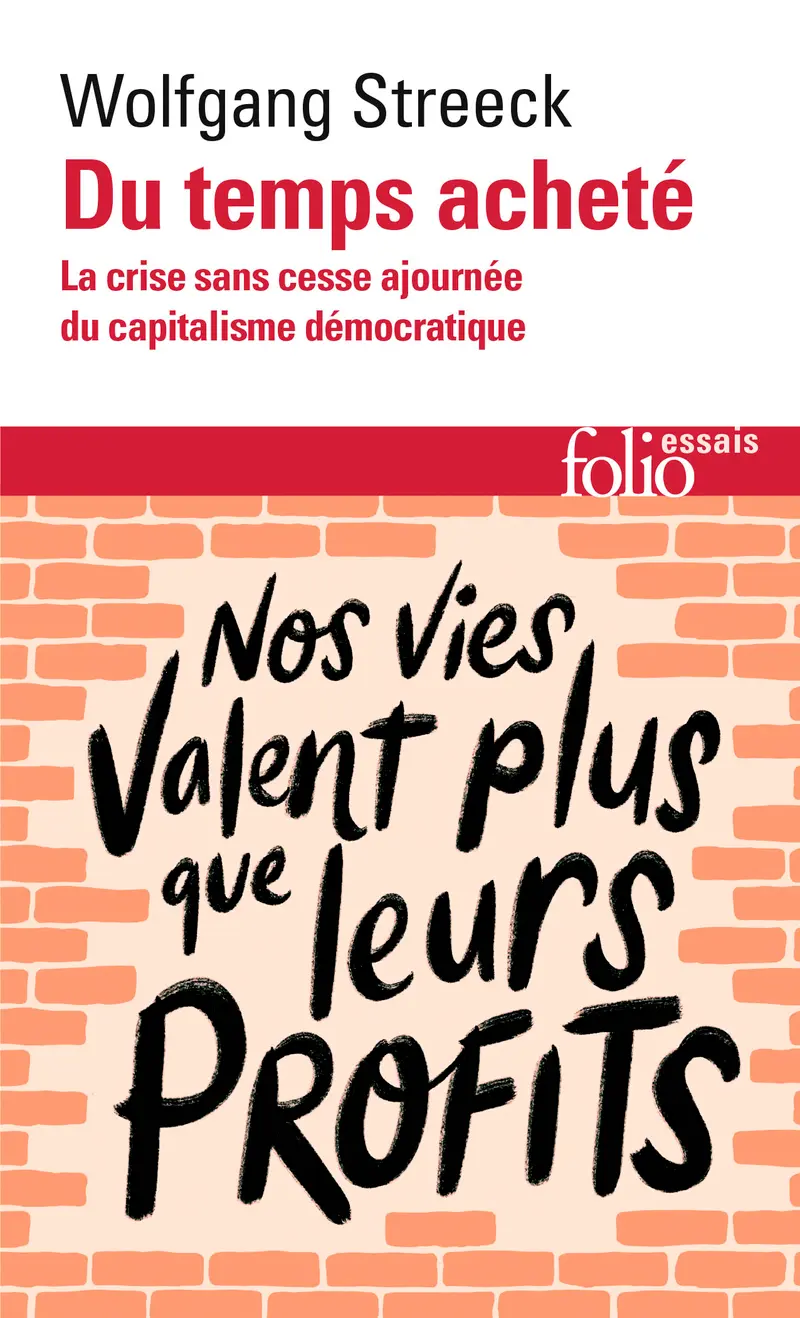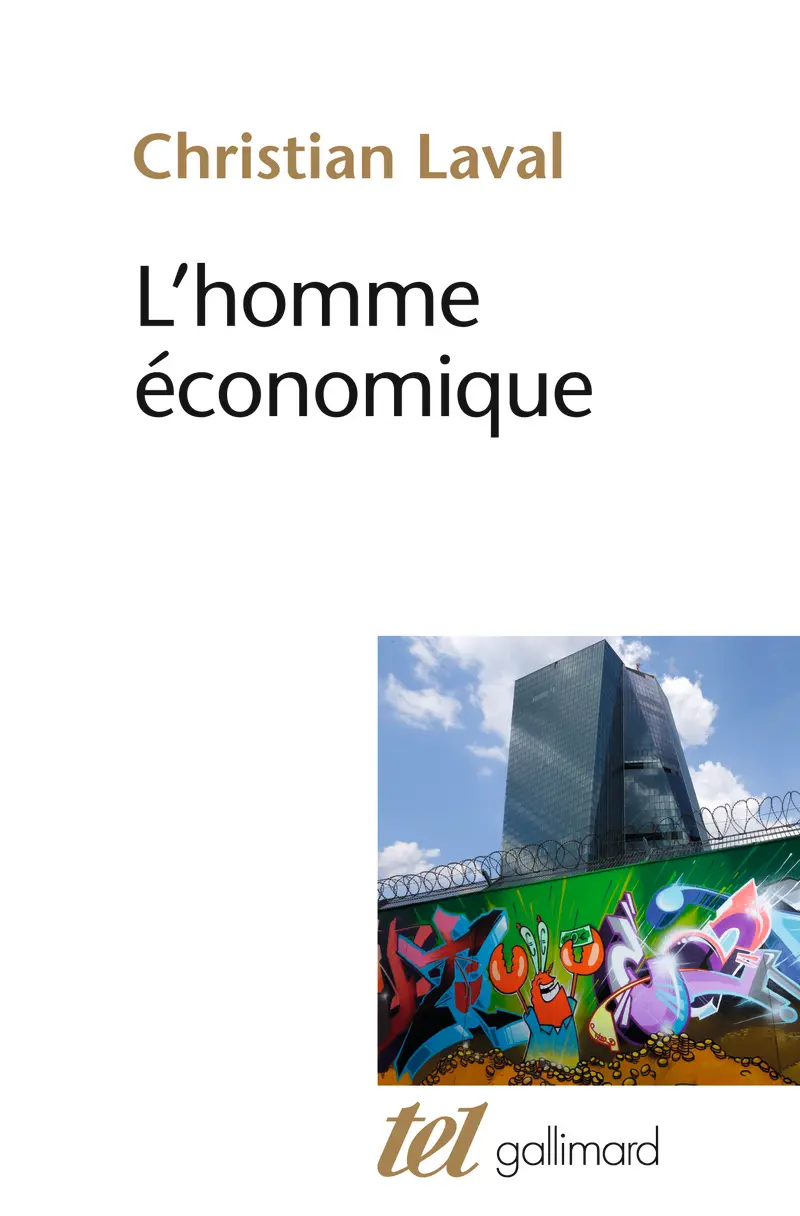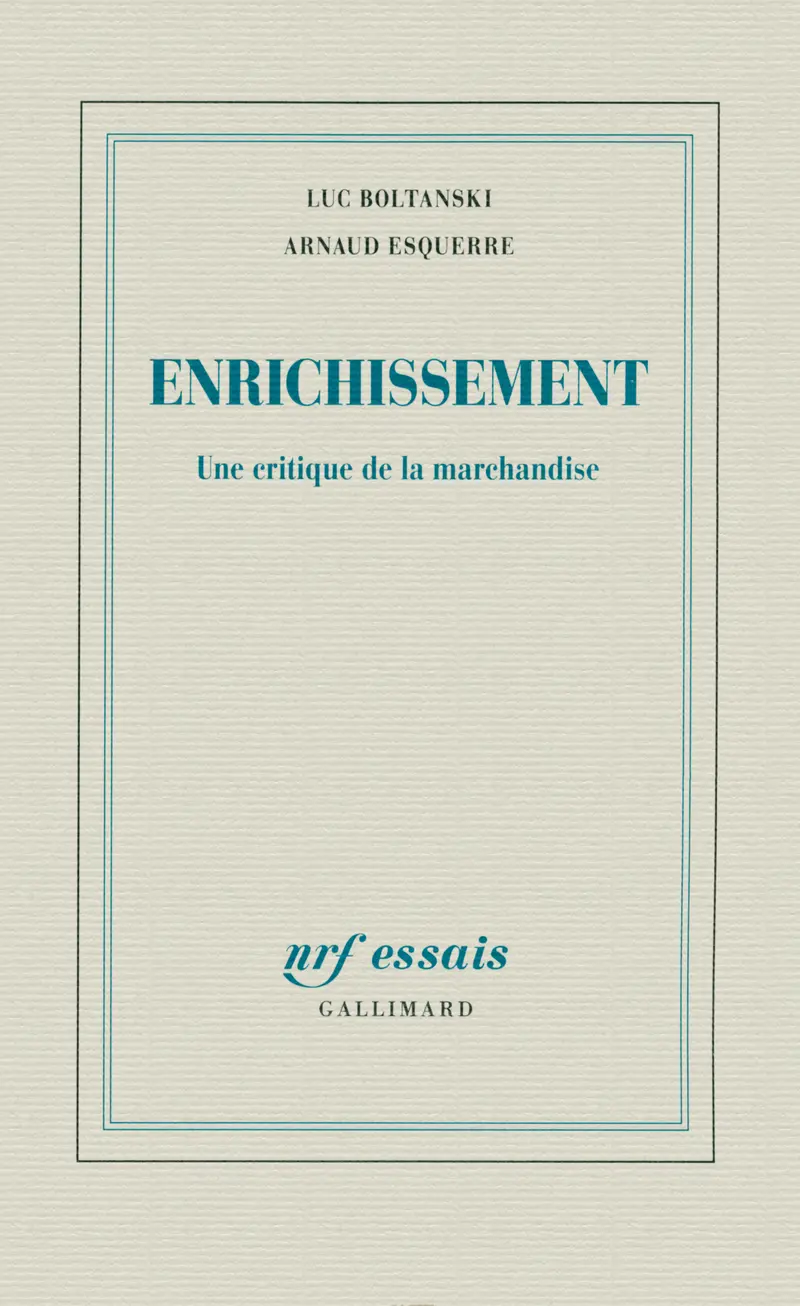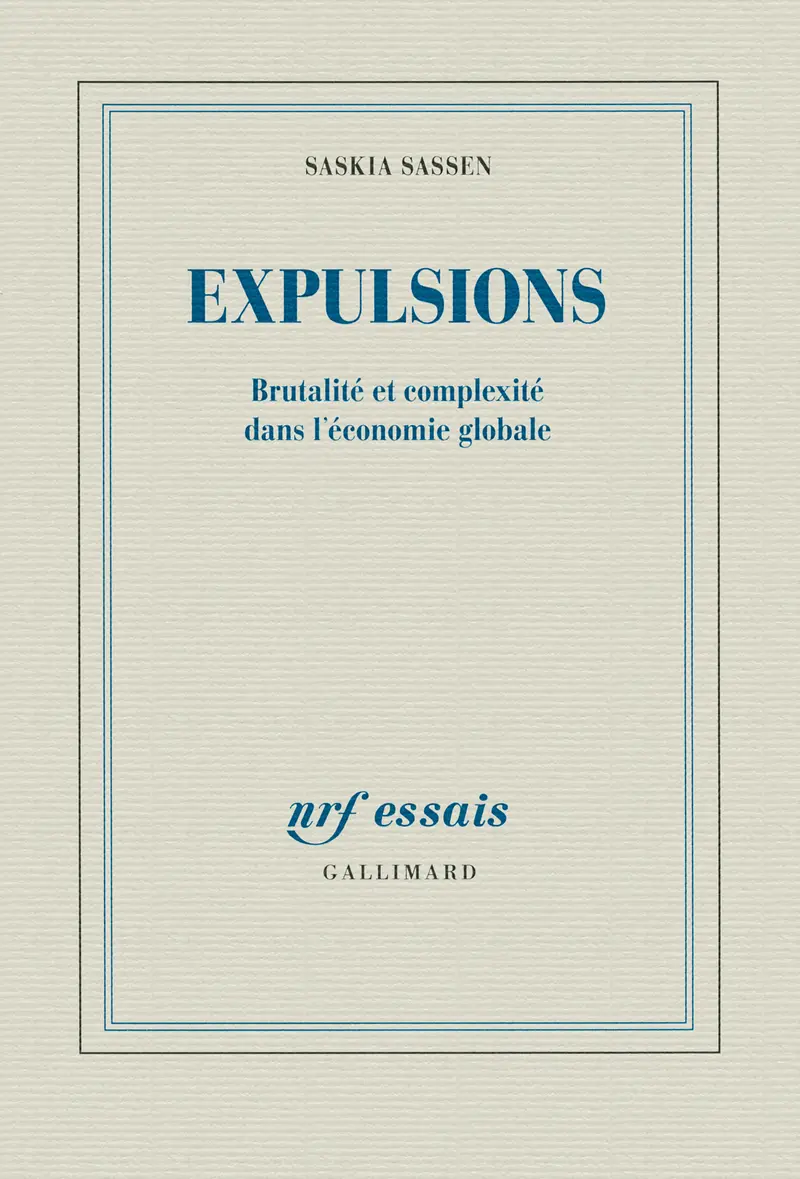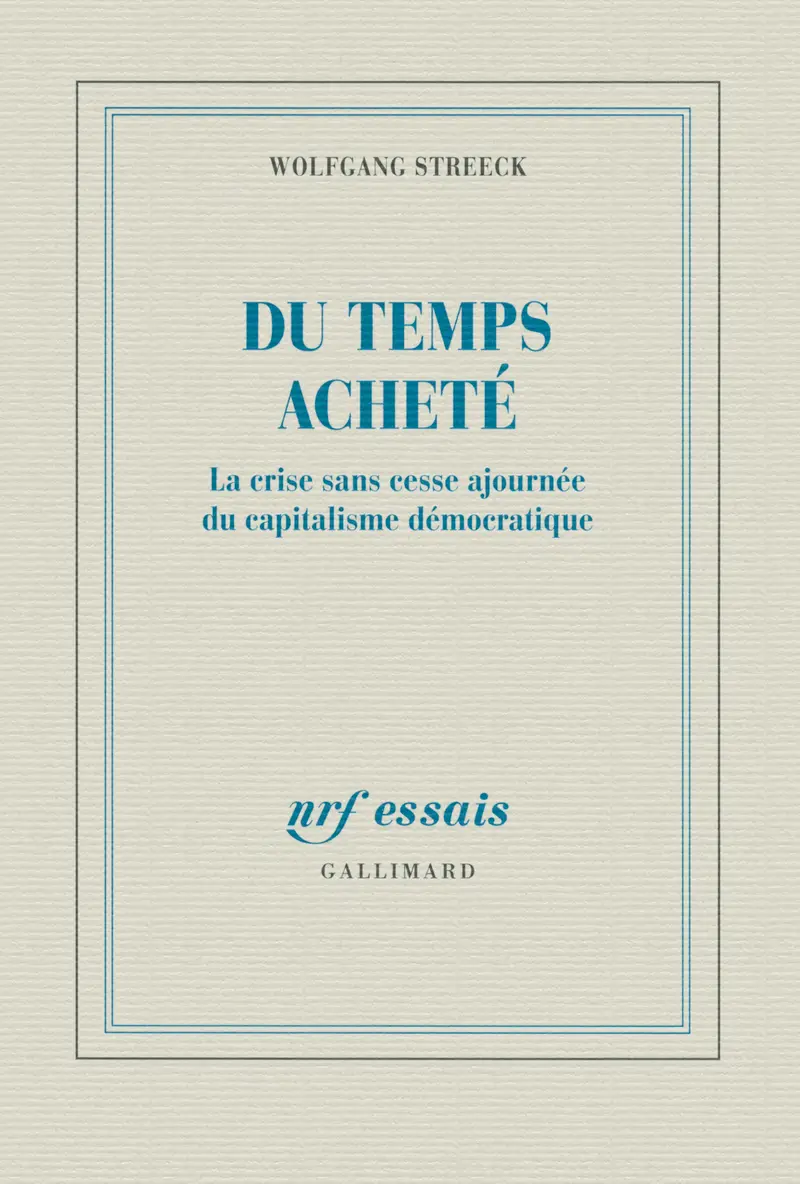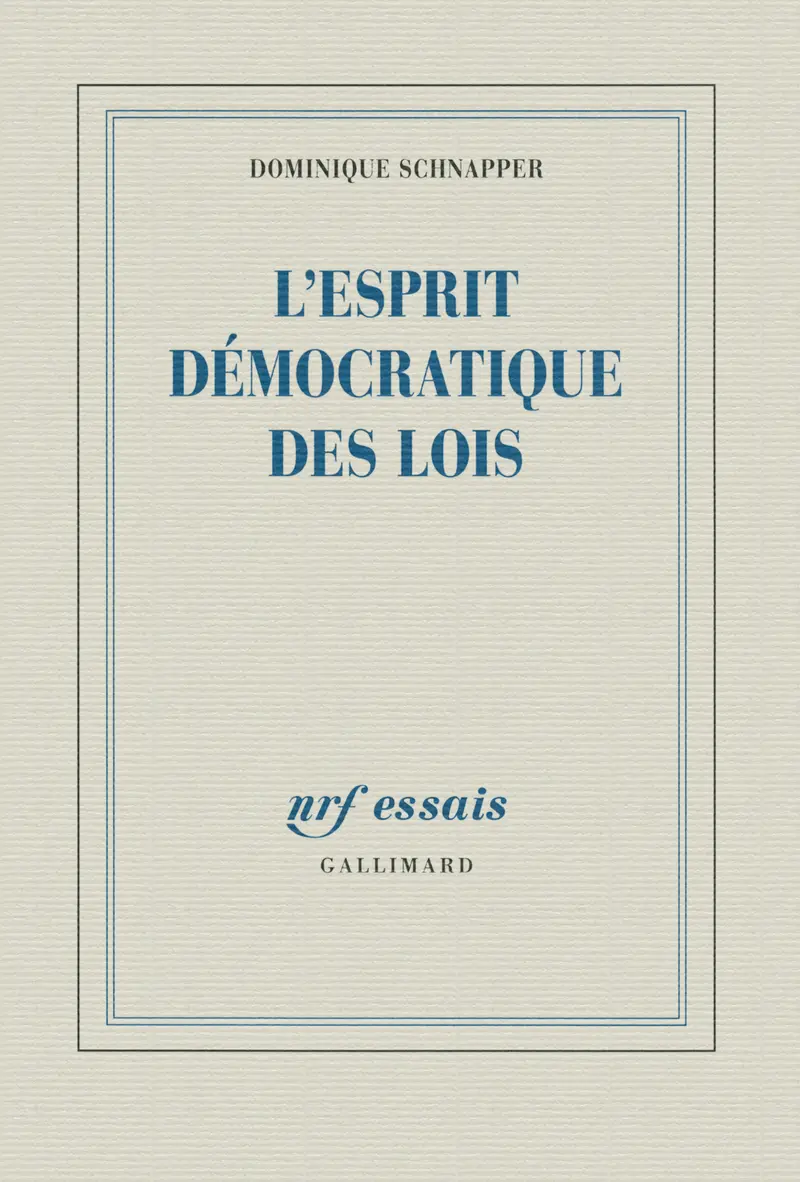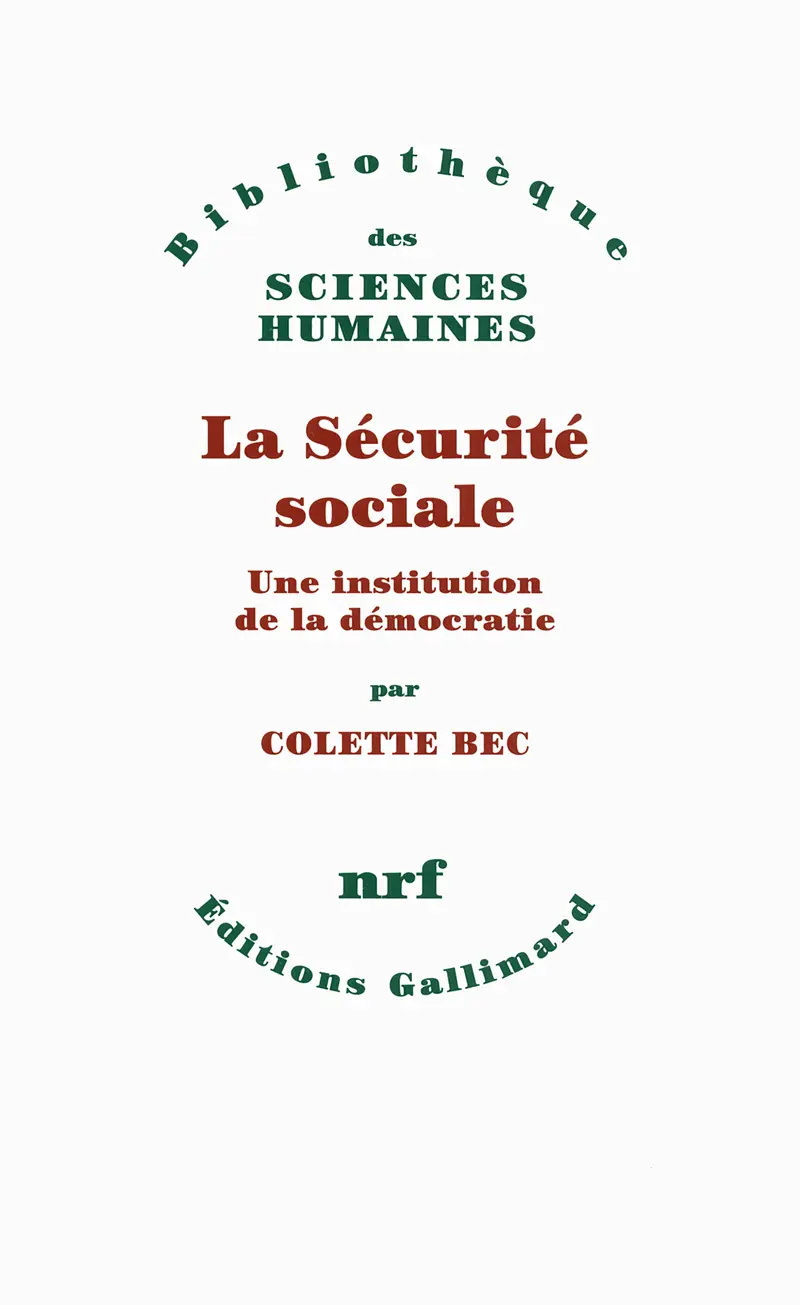Histoire des chefs d'entreprise
Collection La Pensée contemporaine
Gallimard
Parution
Longtemps sont restés confondus les traits du chef et ceux du guerrier. L'époque actuelle, vivant sous le signe de l'économique, devait mettre au premier plan les meneurs d'industrie, les chefs qui «viennent aux entreprises tentaculaires, fascinés par les masses d'hommes en
mouvement et les masses de matière auxquelles il s'agit d'imprimer un rythme créateur.»
À cette aristocratie moderne, le livre de Jean-Paul Palewski apporte ses titres de noblesse ; cette recherche généalogique est en même temps le plus passionnant des romans d'aventure. Depuis les fondateurs de dynastie dont l'existence et l'œuvre restent entourées d'un nuage confus de mythes, depuis les fonctionnaires des grands despotismes hiératiques de l'Orient ancien, les métèques remuants d'Athènes et les chevaliers concussionnaires de Rome jusqu'aux grands abbés du Moyen Âge, aux patriciens des cités italiennes, aux exploitants vénitiens, hanséatiques ou français (Jacques Cœur) du trafic maritime, depuis les banquiers faiseurs de rois du XVIᵉ siècle, les chefs de manufactures royales au XVllᵉ siècle jusqu'aux capitaines d'industrie dont les derniers représentants nous étonnent encore aujourd'hui, – c'est une immense fresque historique, bariolée, pittoresque, infiniment suggestive en ses moindres détails, véritable résurrection du passé qui nous permet de nous expliquer bien des évènements de l'histoire, car ce n'est pas d'aujourd'hui que date la dépendance réciproque du politique et de l'économique.
Arrivé à l'époque actuelle, l'auteur change de méthode. Il se souvient que, disciple d'Henri Fayol, il est l'un des premiers théoriciens de la science de l'organisation. Avec un grand souci d'objectivité et d'impartialité, il s'interdit de reproduire les faits et gestes de tel ou tel chef d'industrie. Sa monographie théorique de l'entreprise moderne et du «technicien de la direction» qui est à sa tête, constitue une étude originale, un peu systématique, mais que tous liront avec intérêt et beaucoup avec fruit. Comme les économistes américains, Jean-Paul Palewski – auquel Werner Sombart a tenu à dire les ressemblances qu'il trouvait entre sa démarcbe de pensée et la sienne propre, – isole le chef moderne à sa place véritable à mi-chemin entre le capital et le travail ; il dégage ses moyens d'action et son idéal, ce devoir vis-à-vis de l'entreprise que son exemple peut insuffler à tous ceux qui coopèrent à ses côtés à l'œuvre de production.
Le livre de Jean-Paul Palewski suscitera peut-être d'ardentes controverses ; mais tous reconnaîtront l'originalité, le don de vie intense qui en caractérisent l'auteur.
À cette aristocratie moderne, le livre de Jean-Paul Palewski apporte ses titres de noblesse ; cette recherche généalogique est en même temps le plus passionnant des romans d'aventure. Depuis les fondateurs de dynastie dont l'existence et l'œuvre restent entourées d'un nuage confus de mythes, depuis les fonctionnaires des grands despotismes hiératiques de l'Orient ancien, les métèques remuants d'Athènes et les chevaliers concussionnaires de Rome jusqu'aux grands abbés du Moyen Âge, aux patriciens des cités italiennes, aux exploitants vénitiens, hanséatiques ou français (Jacques Cœur) du trafic maritime, depuis les banquiers faiseurs de rois du XVIᵉ siècle, les chefs de manufactures royales au XVllᵉ siècle jusqu'aux capitaines d'industrie dont les derniers représentants nous étonnent encore aujourd'hui, – c'est une immense fresque historique, bariolée, pittoresque, infiniment suggestive en ses moindres détails, véritable résurrection du passé qui nous permet de nous expliquer bien des évènements de l'histoire, car ce n'est pas d'aujourd'hui que date la dépendance réciproque du politique et de l'économique.
Arrivé à l'époque actuelle, l'auteur change de méthode. Il se souvient que, disciple d'Henri Fayol, il est l'un des premiers théoriciens de la science de l'organisation. Avec un grand souci d'objectivité et d'impartialité, il s'interdit de reproduire les faits et gestes de tel ou tel chef d'industrie. Sa monographie théorique de l'entreprise moderne et du «technicien de la direction» qui est à sa tête, constitue une étude originale, un peu systématique, mais que tous liront avec intérêt et beaucoup avec fruit. Comme les économistes américains, Jean-Paul Palewski – auquel Werner Sombart a tenu à dire les ressemblances qu'il trouvait entre sa démarcbe de pensée et la sienne propre, – isole le chef moderne à sa place véritable à mi-chemin entre le capital et le travail ; il dégage ses moyens d'action et son idéal, ce devoir vis-à-vis de l'entreprise que son exemple peut insuffler à tous ceux qui coopèrent à ses côtés à l'œuvre de production.
Le livre de Jean-Paul Palewski suscitera peut-être d'ardentes controverses ; mais tous reconnaîtront l'originalité, le don de vie intense qui en caractérisent l'auteur.