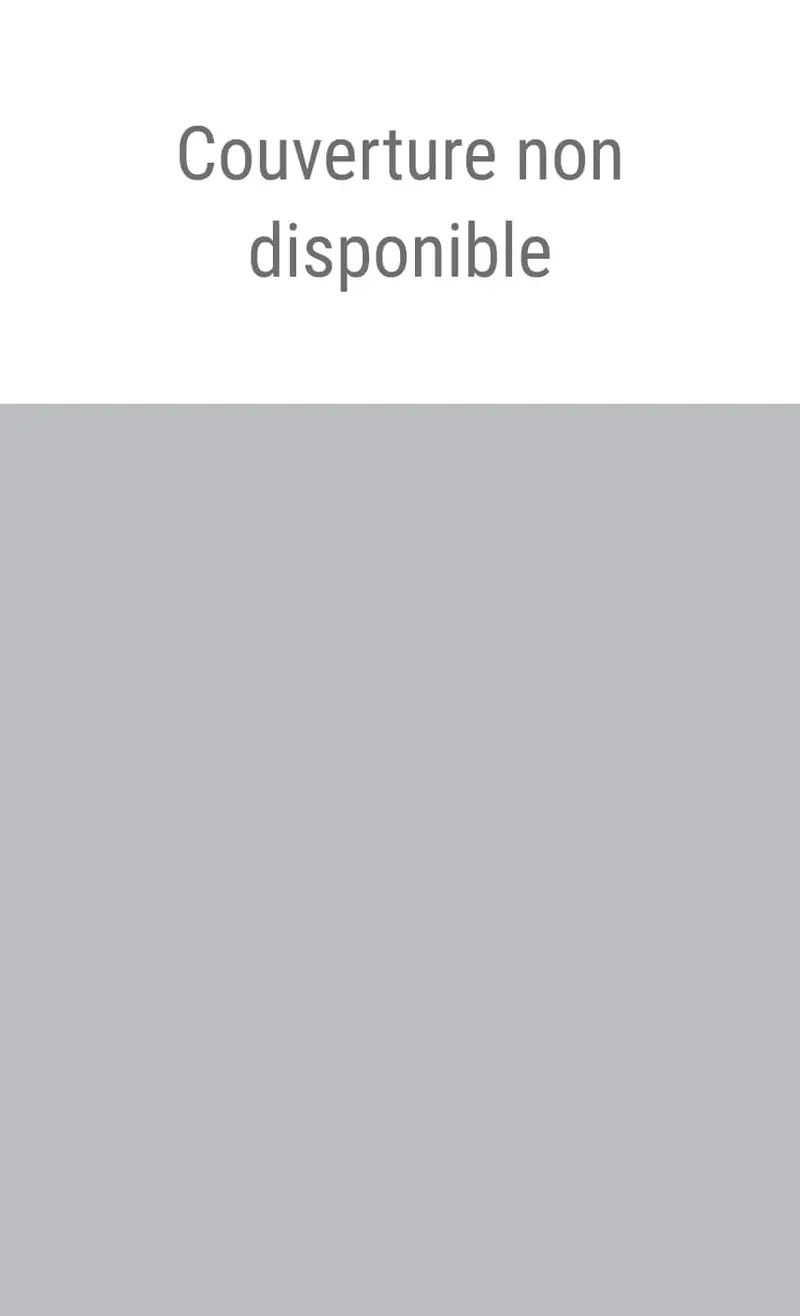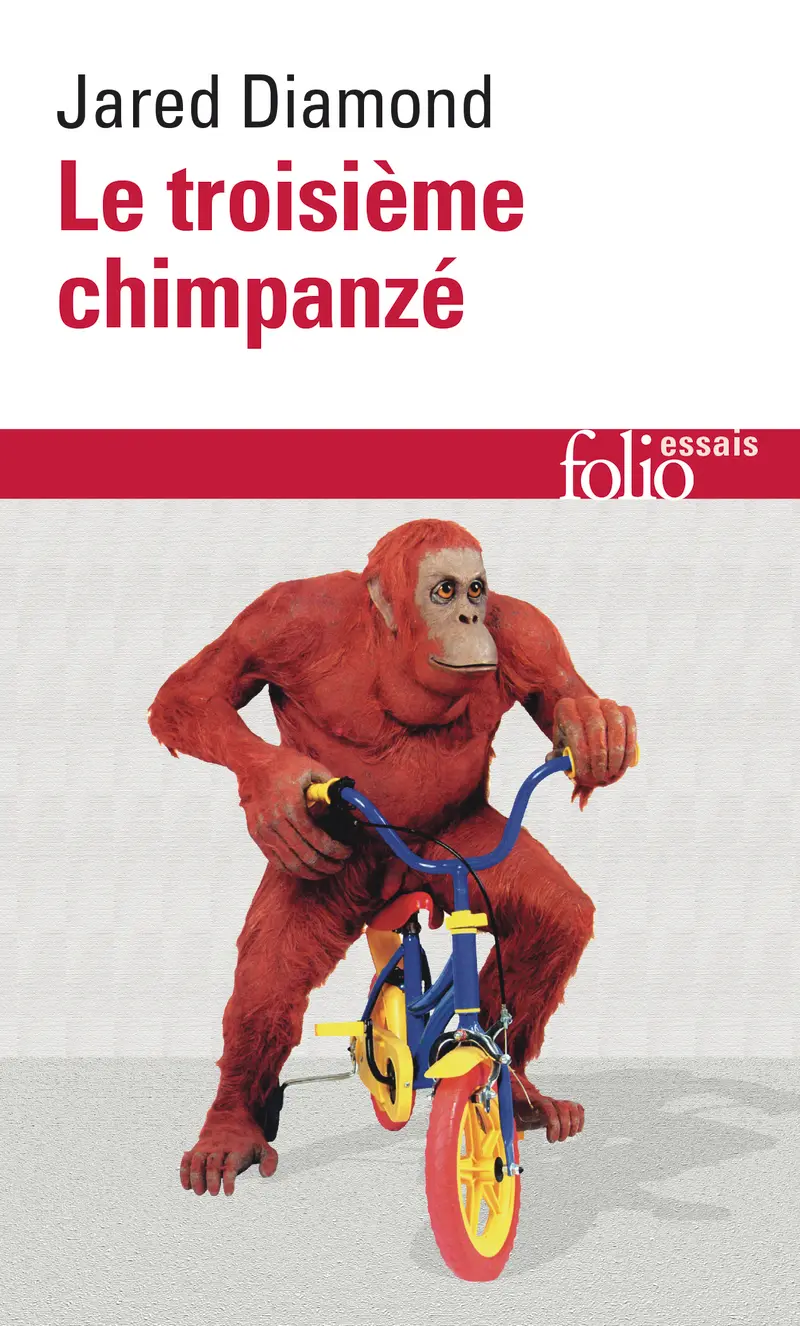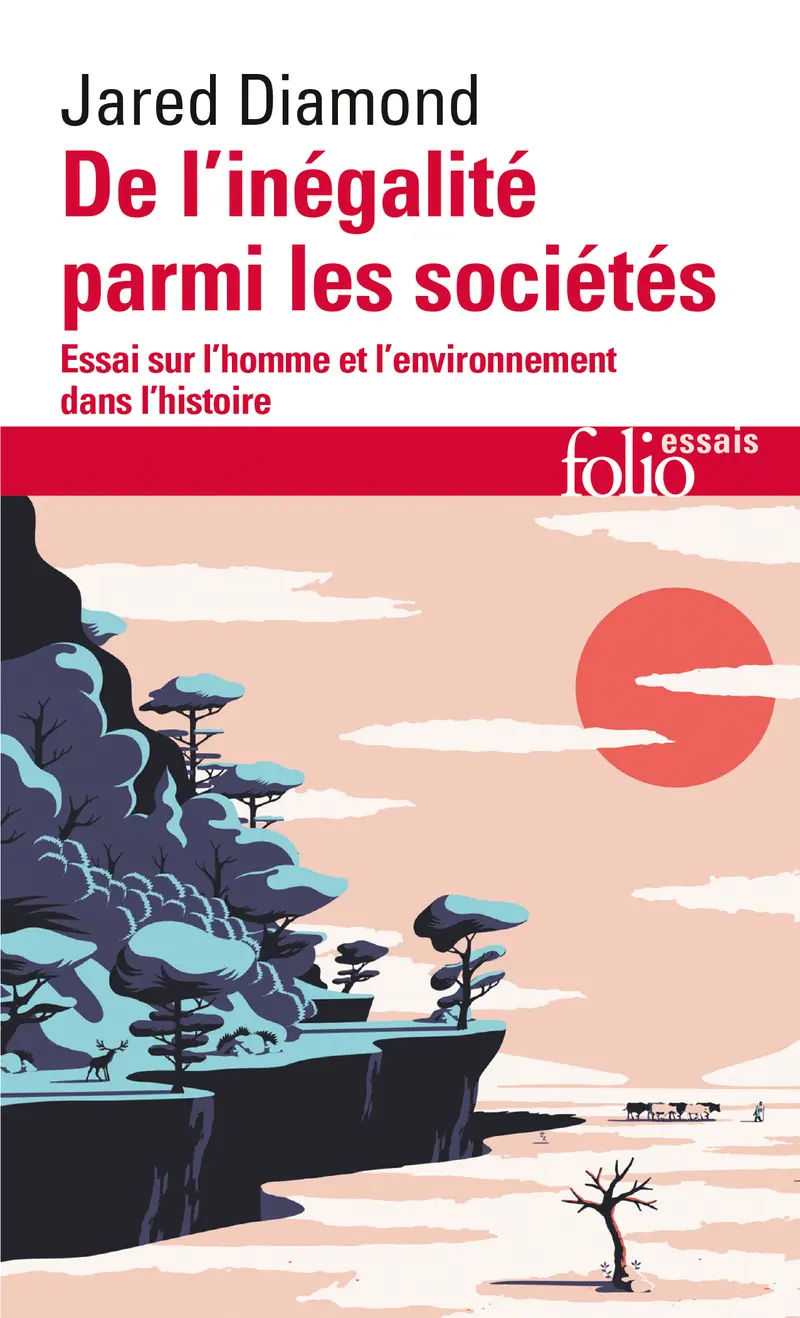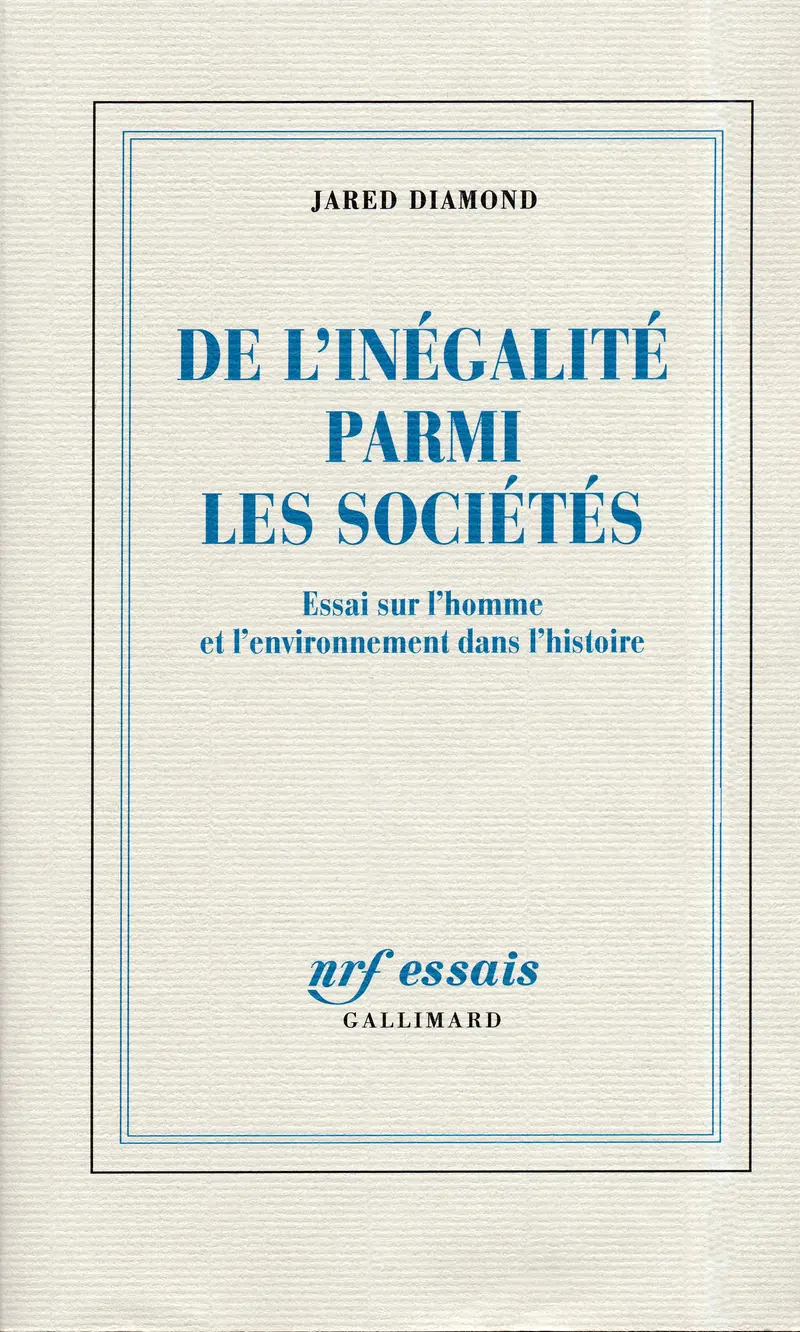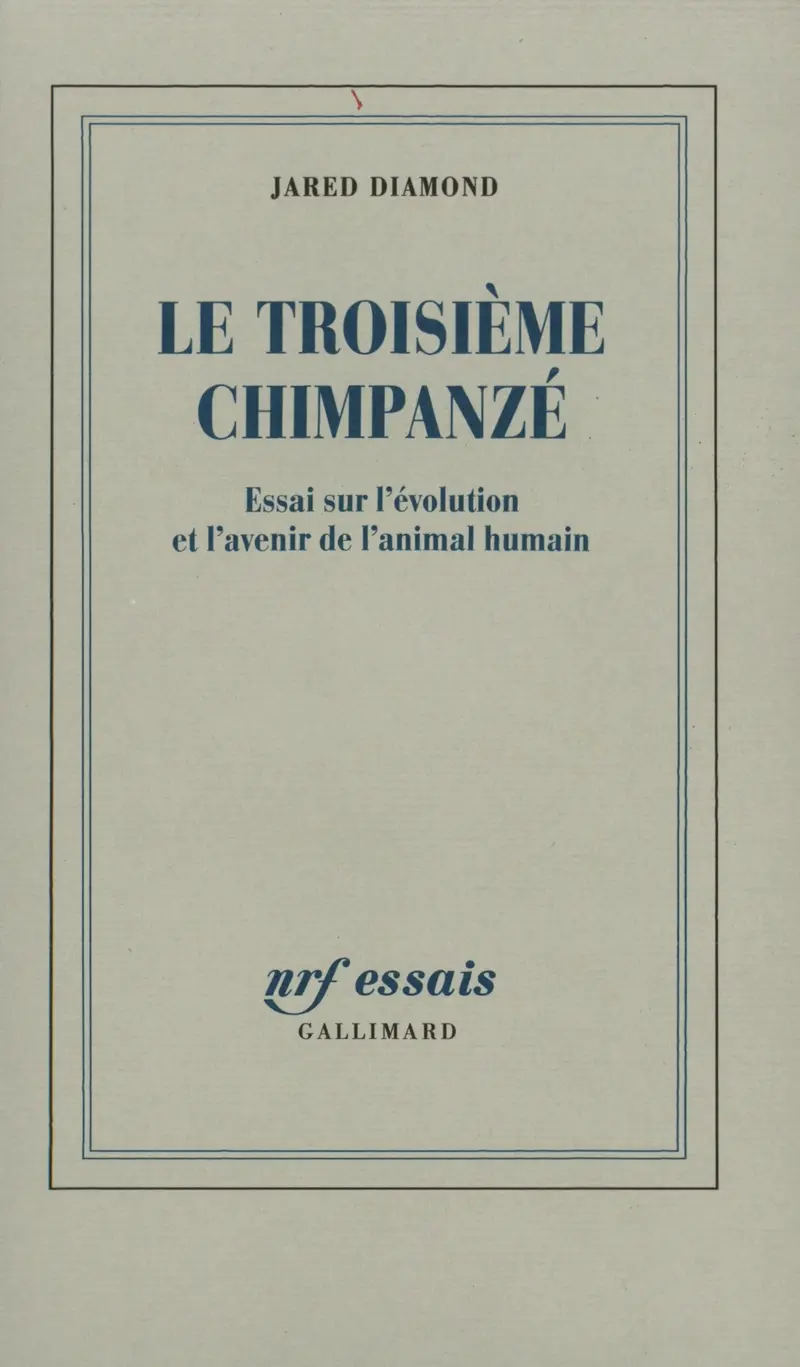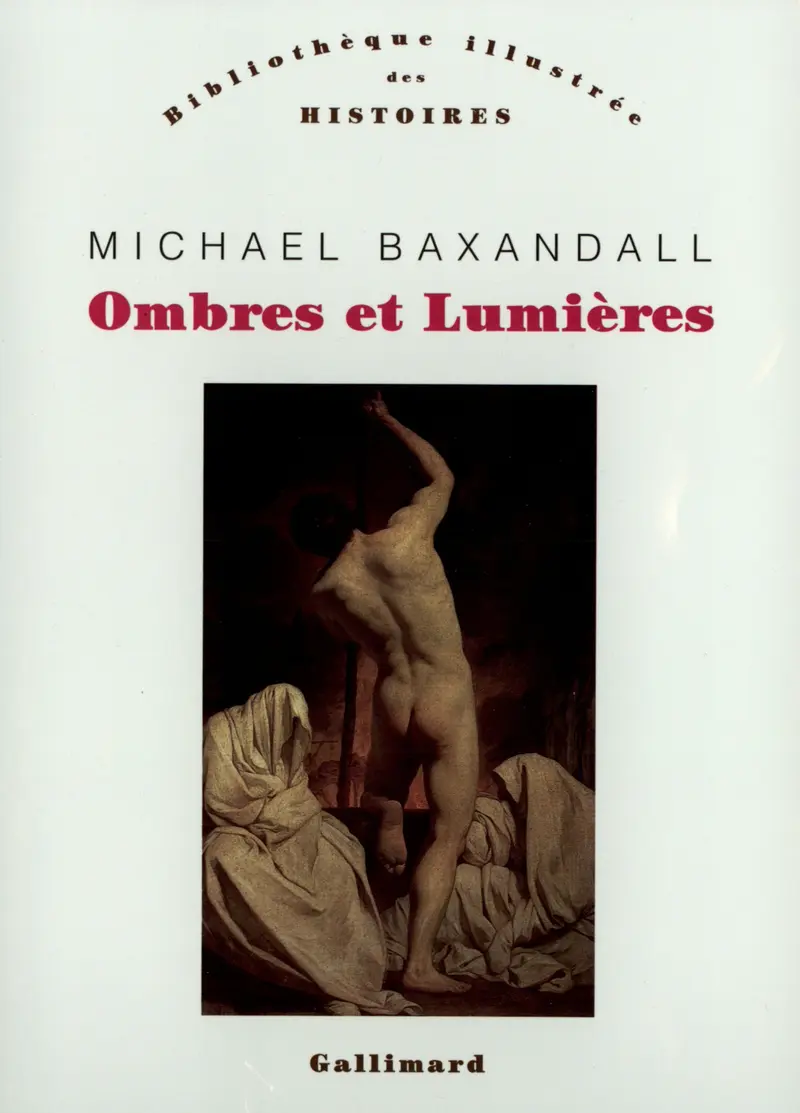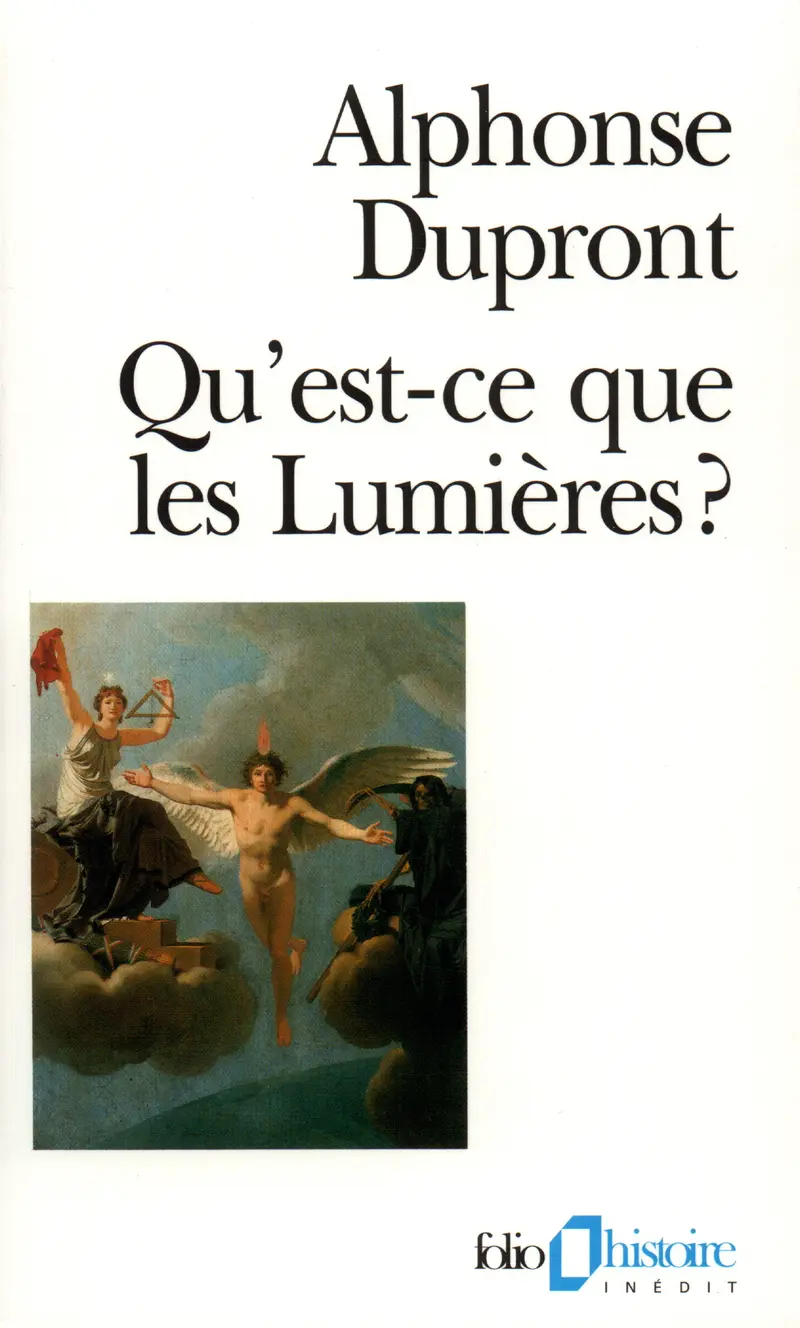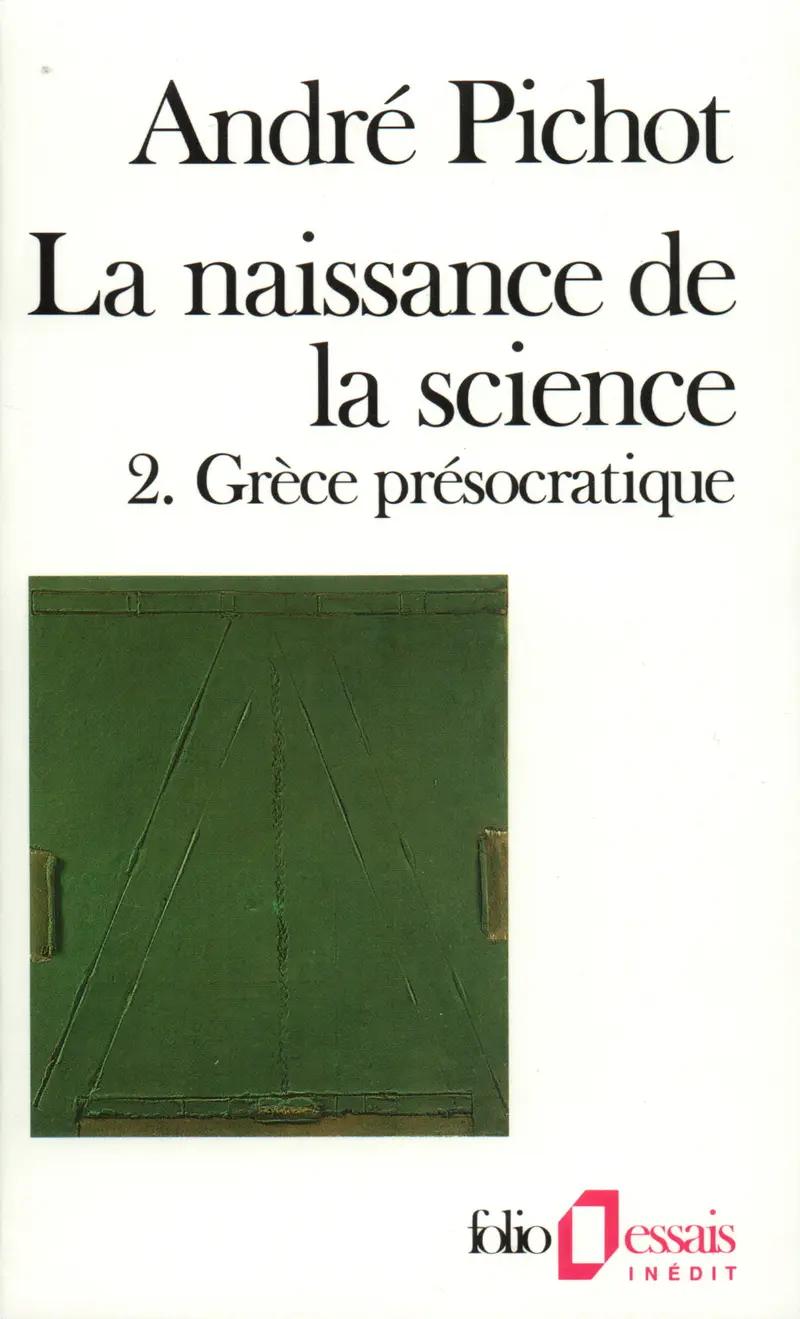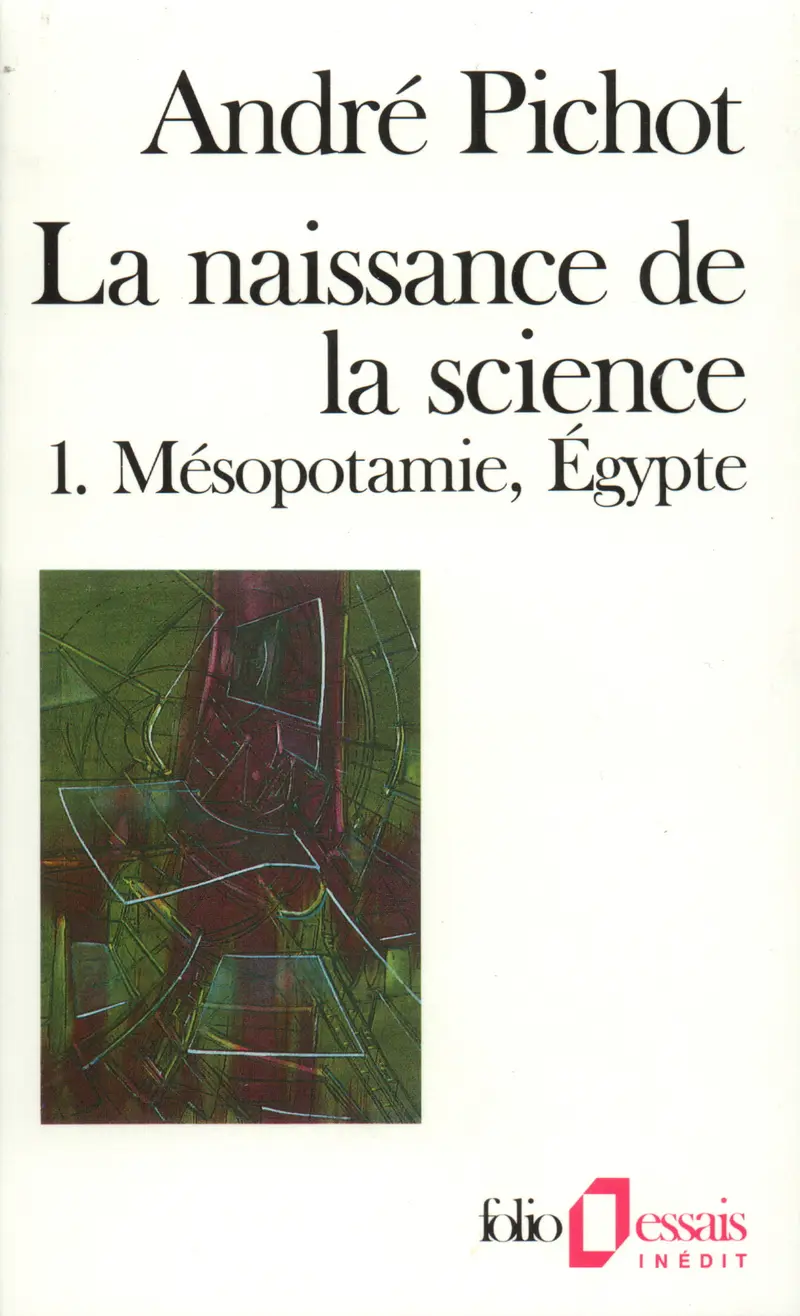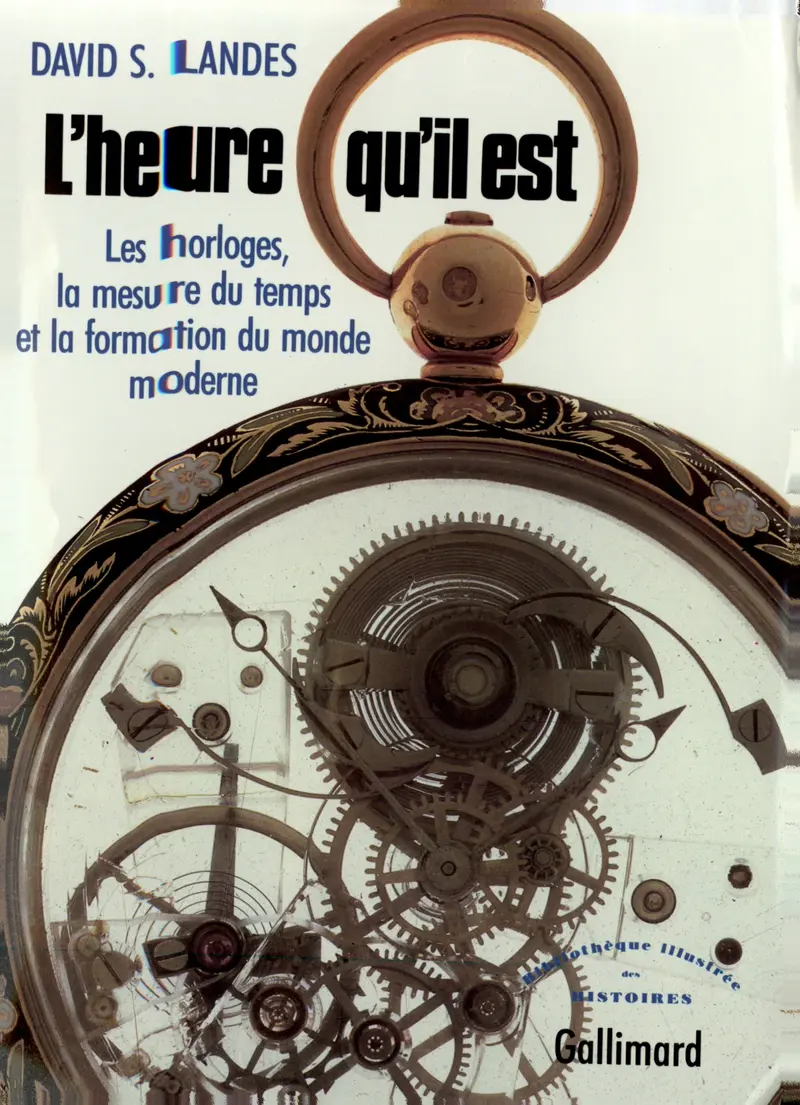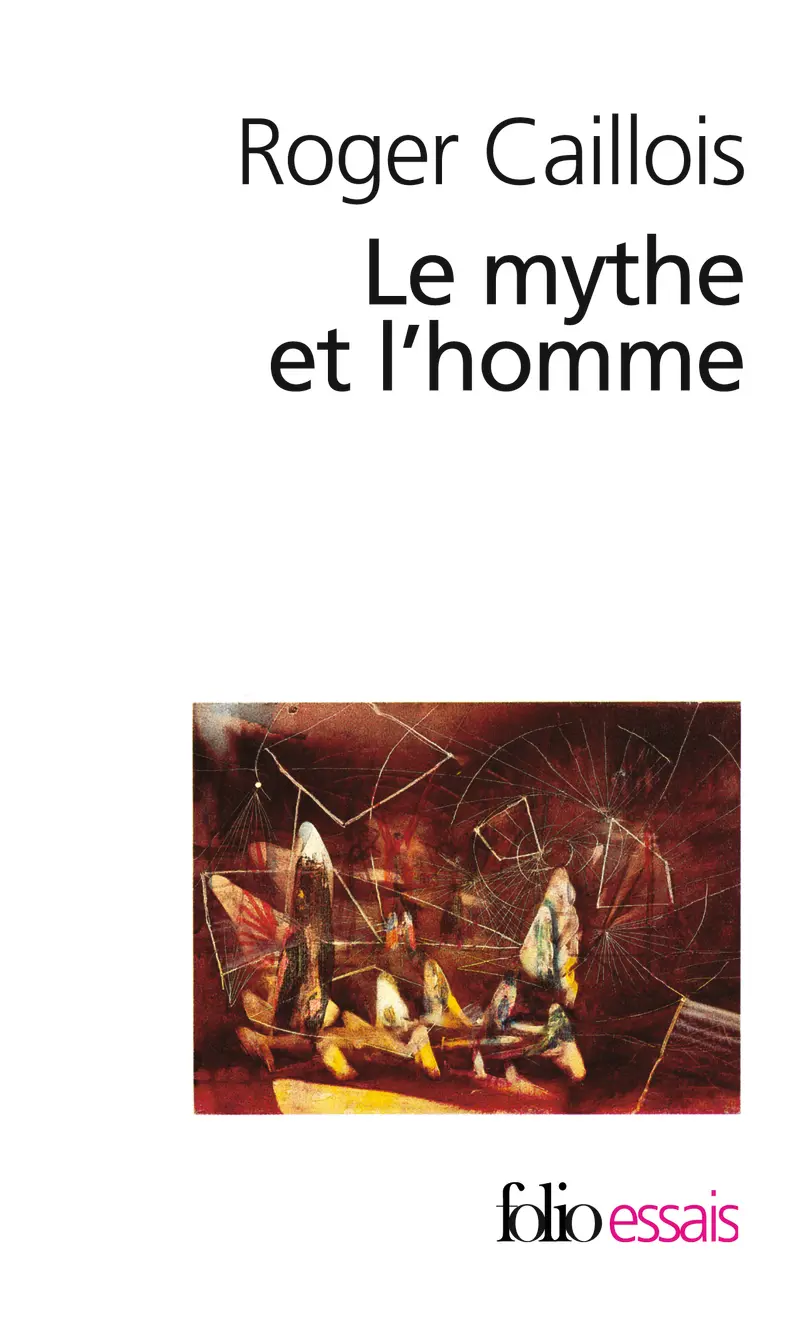Collectif
De Vienne à Cambridge
. L'héritage du positivisme logique de 1950 à nos jours
Ouvrage collectif de Paul Feyerabend, Jerry A. Fodor, Nelson Goodman, Norwood Russell Hanson, Carl Hempel, Thomas Kuhn, Paul Oppenheim, Karl Popper, Hilary Putnam, Dudley Shapere et de Willard Van Orman Quine. Édition et trad. de l'anglais et de l'allemand par Pierre Jacob
Précédé de Comment peut-on ne pas être empiriste ? par Pierre Jacob
Collection Bibliothèque des Sciences humaines
Gallimard
Parution
Depuis que la science existe, la philosophie n'a sans doute pas caressé de rêve plus précieux que de concilier l'empirisme avec l'existence des vérités logiques. Les positivistes logiques du Cercle de Vienne croyaient l'avoir enfin réalisé : les vérités scientifiques dépendraient de l'expérience. Or Wittgenstein voyait dans ces mêmes vérités logiques des conventions indépendantes de la réalité. Dès 1934, Popper s'opposait à l'interprétation positiviste de l'empirisme : les hypothèses scientifiques, conjectures réfutables mais invérifiables par l'expérience, ne sont pas des généralisations inductives de données observables. Après la Seconde Guerre mondiale, Quine, Goodman et Putnam soumettaient la philosophie conventionnaliste à une critique dévastatrice. Dans les années 1950, Feyerabend, Hanson, Kuhn, Lakatos et Toulmin ont rejeté carrément l'empirisme.
Si le positivisme a eu tort de voir dans les vérités logiques des conventions, s'il a eu tort de faire peser sur la créativité scientifique la tyrannie de l'empirisme, comment établir les rapports entre expérience et imagination au sein de la démarche scientifique.
Si le positivisme a eu tort de voir dans les vérités logiques des conventions, s'il a eu tort de faire peser sur la créativité scientifique la tyrannie de l'empirisme, comment établir les rapports entre expérience et imagination au sein de la démarche scientifique.