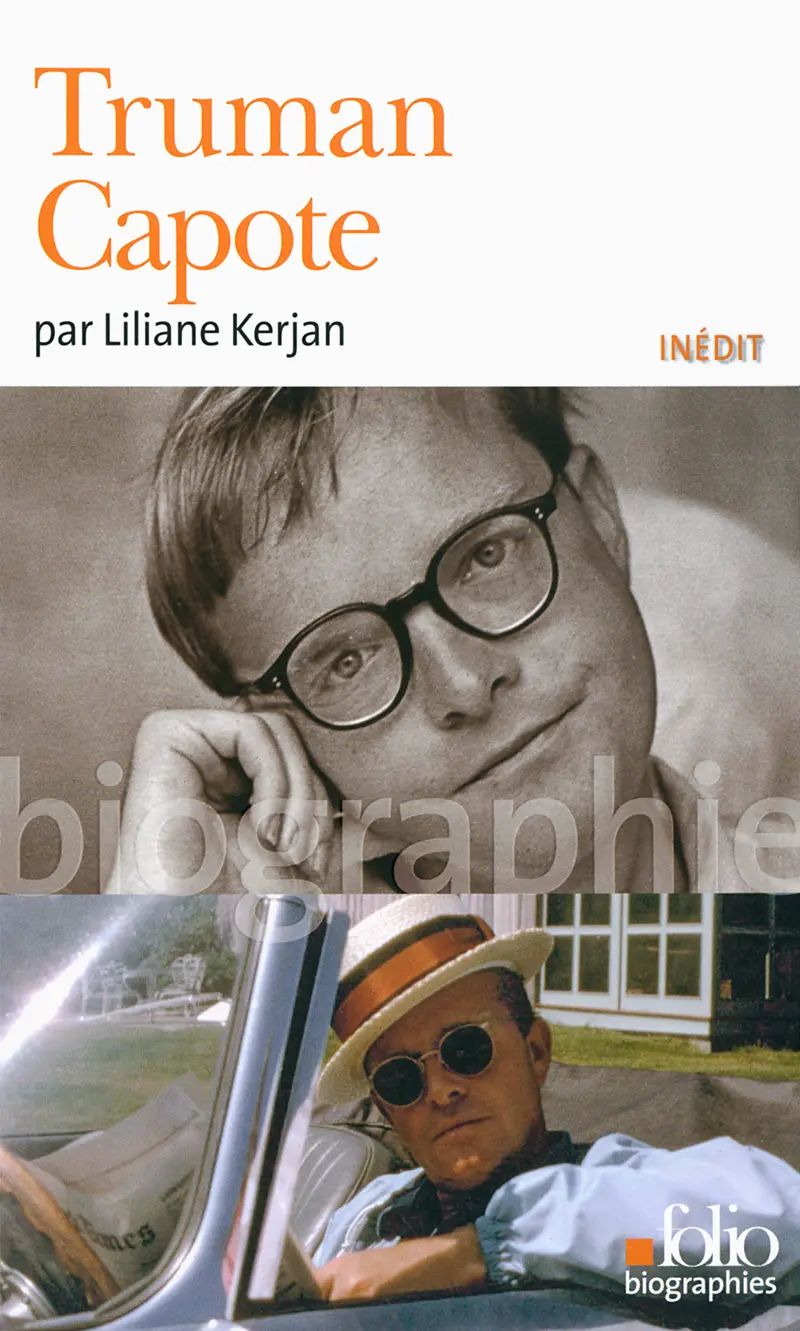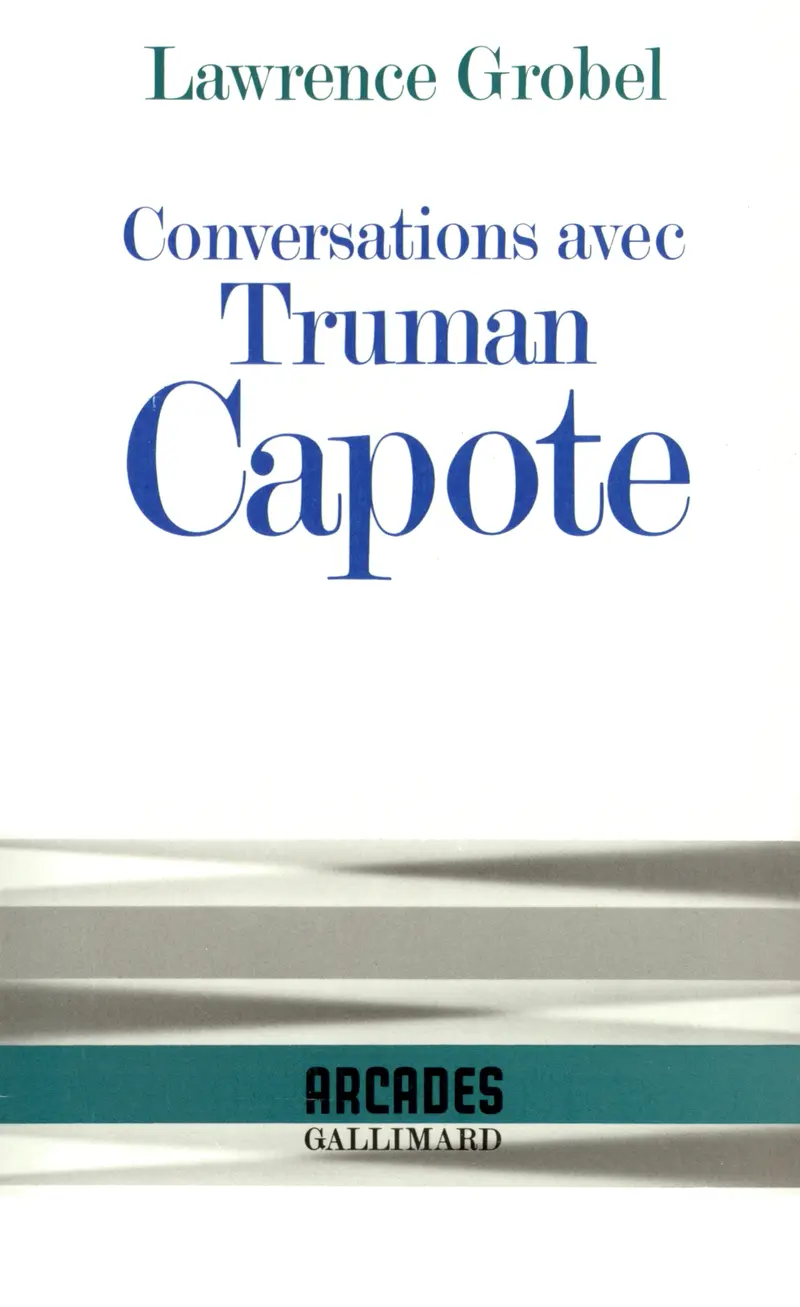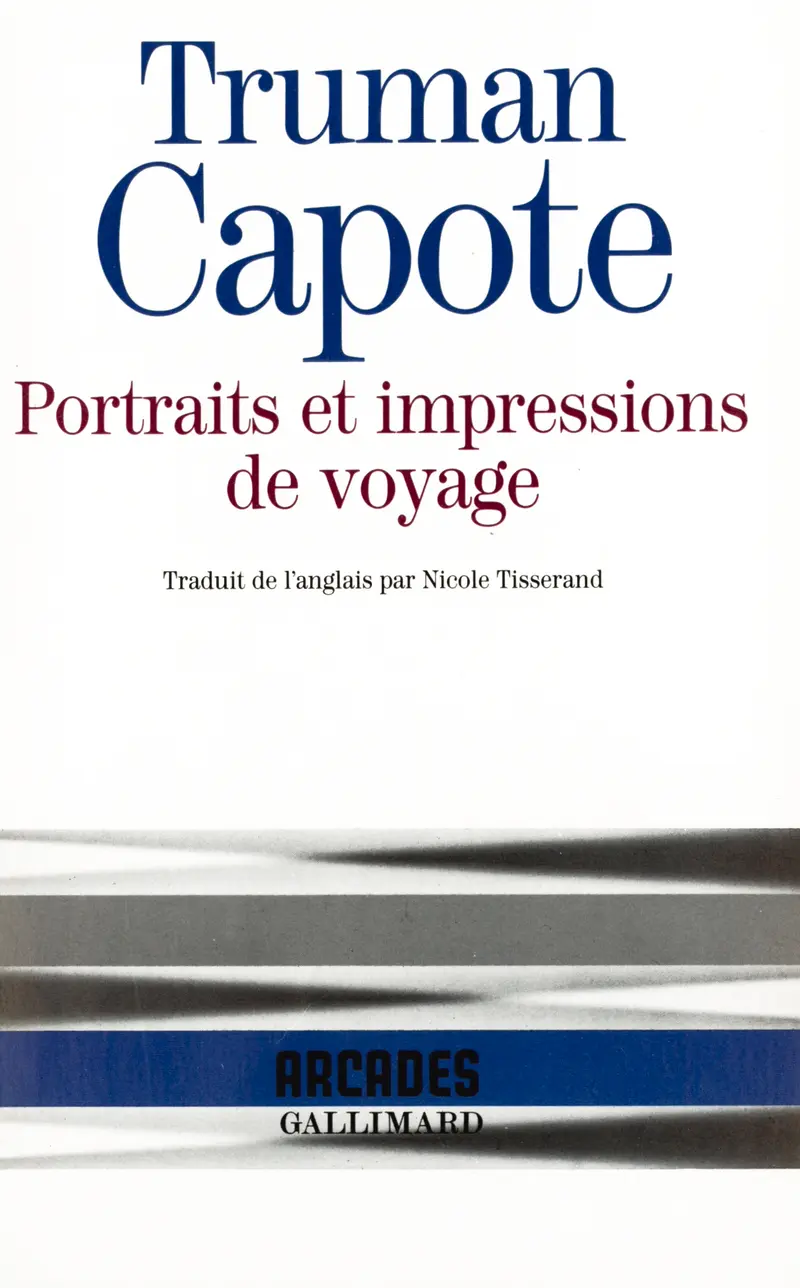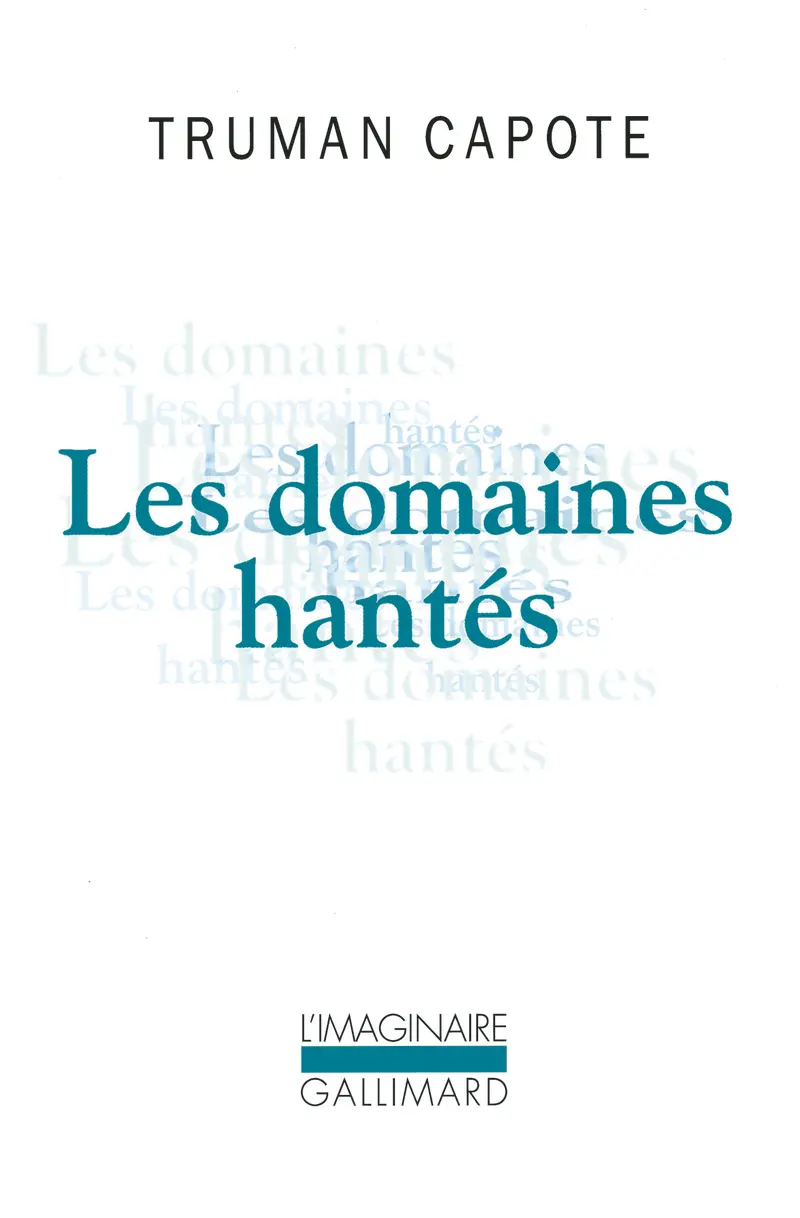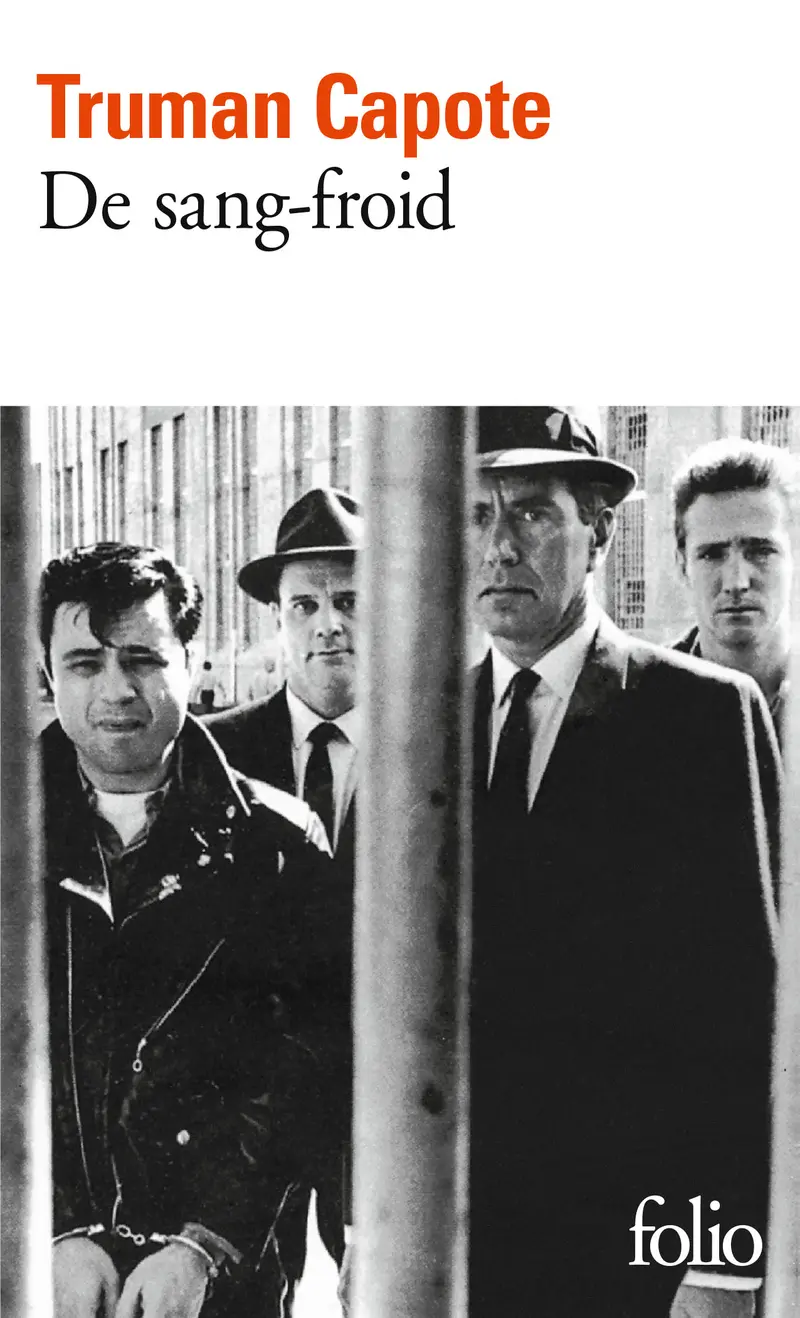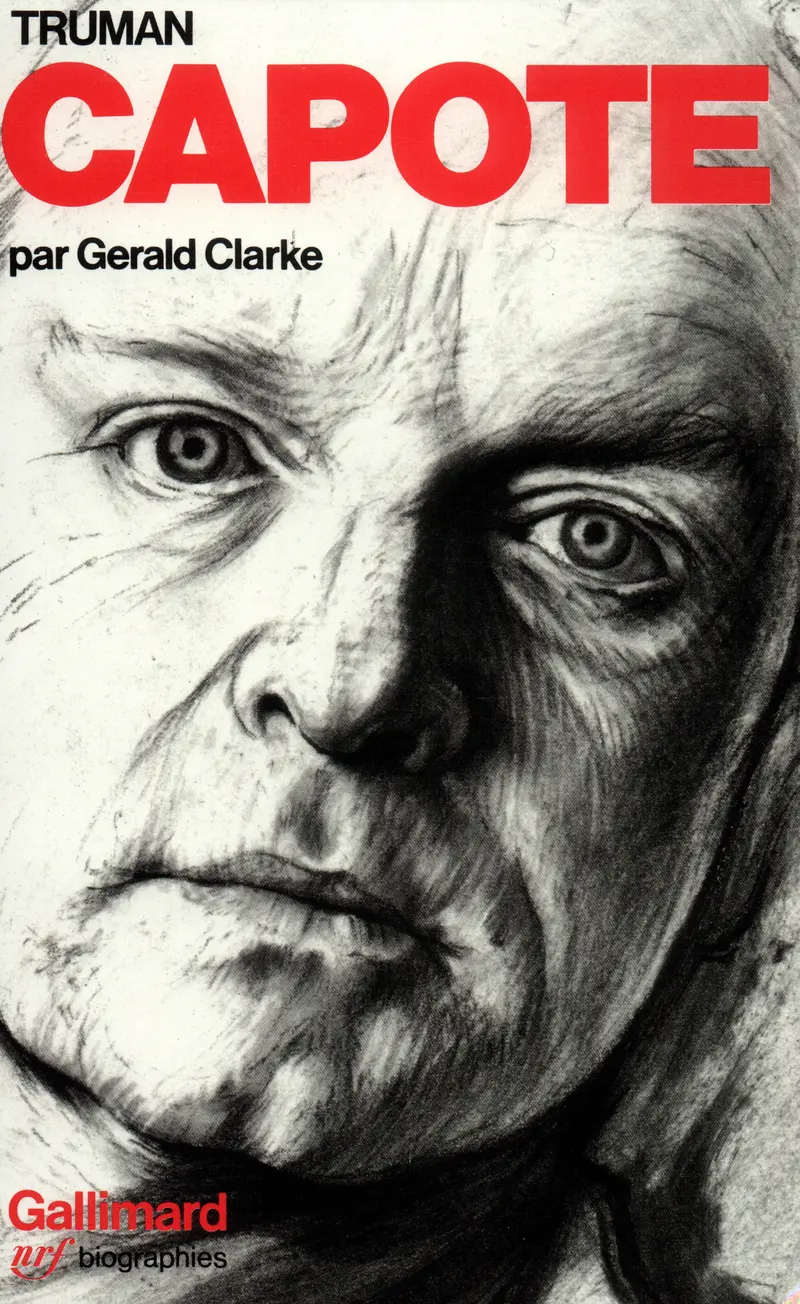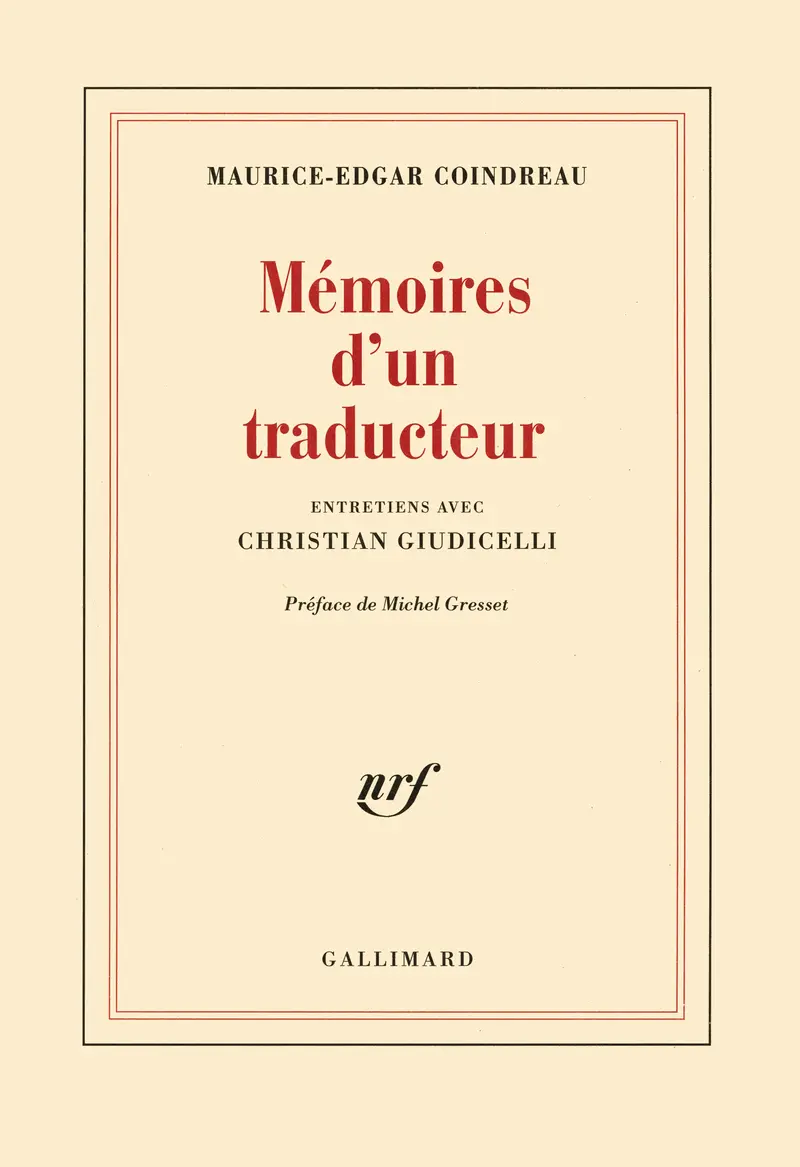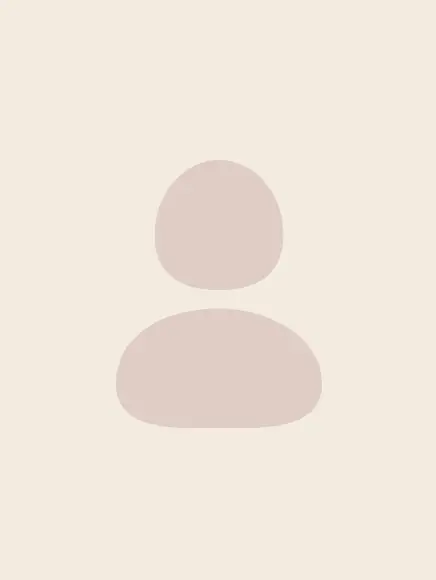Truman Capote (1924-1984)
Tour à tour romancier, journaliste et scénariste, Truman Capote a marqué la vie littéraire et mondaine américaine. Considéré comme le chef de l'école néo-romantique du Sud, il a publié, notamment, les célèbres Petit déjeuner chez Tiffany et De sang-froid.
« Le début de l'adolescence, quand l'enfant croit encore aux sortilèges, est l'âge privilégié de Truman Capote. Tout montre qu'il est resté marqué par cette période de sa vie, et qu'il n'en est peut-être jamais sorti. »
Michel Mohrt, L'Air du large, Gallimard, 1988.
« Ma vie – ma vie d'écrivain, du moins – pourrait être consignée avec la précision d'une feuille de température, avec ses hauts et ses bas, ses cycles parfaitement définis. J'ai commencé à écrire à huit ans – comme ça, d'un coup, sans être inspiré par le moindre exemple. Je n'avais jamais connu personne qui écrivît. En vérité, je connaissais même bien peu de gens qui lisaient. Mais le fait est que les quatre et seules activités qui m'intéressaient étaient les suivantes : lire des livres, aller au cinéma, faire des claquettes et dessiner. Un jour je me suis donc mis à écrire, ignorant que je m'enchaînais pour la vie à un maître très noble mais sans merci. Quand Dieu vous gratifie d'un don, il vous gratifie aussi d'un fouet ; et ce fouet est strictement réservé à l'autoflagellation. » (Extrait de la préface de Truman Capote à Music for Chameleons, 1980, traduite par Henri Robillot et reprise dans les Œuvres en « Quarto » en 2014.)
De son vrai nom Truman Streckfus Persons, Truman Capote est né à La Nouvelle-Orléans en 1924, et a été élevé dans une plantation de l’Alabama. Il manifeste très tôt un grand don d’observation, du goût pour l’écriture et une grande virtuosité littéraire. Avant de pouvoir vivre de sa plume, il sera danseur sur un bateau de plaisance, puis peintre.
Mais il fait rapidement partie, avec son amie et rivale Carson McCullers, des Wunderkinder (enfants prodiges) littéraires arrivés de leur Sud natal à la conquête de New York. Son premier roman, Les Domaines hantés (1948), remporte un vif et immédiat succès. L’année suivante, il publie un recueil de contes, Un arbre de nuit. Suivent Local Color en 1950, La Harpe d'herbes en 1951 et Les Muses parlent en 1956.
Après la parution, en 1958, du célèbre Petit déjeuner chez Tiffany (adapté au cinéma sous le titre « Diamants sur canapé » avec Audrey Hepburn), il abandonne le domaine poétique de l’enfance, qu’il aura souvent exploité, pour écrire selon une forme plus documentaire De sang-froid , ouvrage aujourd’hui mondialement connu, et que lui a inspiré, en 1965, un horrible fait divers.
On a souvent dit de Truman Capote qu’il était le Cocteau des États-Unis, doué, charmant et frivole ; on l’a aussi qualifié de « caméléon littéraire ». Il est mort en 1984, deux ans après la publication en français de Musique pour caméléons — recueil de textes d’inspirations et de styles on ne peut plus divers.
Entretien
Lawrence Grobel — Dans votre préface à Musique pour caméléons, vous écrivez : « Quand Dieu vous gratifie d'un don, il vous gratifie aussi d'un fouet et ce fouet est strictement réservé à l'autoflagellation. » Qu'entendez-vous par là ?
Truman Capote — Par là, j'entends que Dieu vous accorde un don, quel qu'il soit, celui de composer ou d'écrire, mais, si grand soit le plaisir que vous en tirez, il s'accompagne d'une expérience douloureuse à vivre. C'est une épreuve atroce que de se retrouver chaque jour devant une feuille blanche et d'être obligé d'aller chercher l'inspiration là-haut, quelque part dans les nuages. Je peux dire que tous les jours, en me mettant au travail, je suis terriblement nerveux. Ça me prend un temps considérable de m'y mettre. Quand j'ai démarré, ça se calme un peu, mais je ferais n'importe quoi pour continuer à surseoir. Je dois avoir cinq cents crayons taillés que je retaillerais jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Toujours est-il que, tant bien que mal, je réussis à écrire à peu près quatre heures par jour. [...]
Quand vous avez fini d'écrire pour la journée, vous arrêtez-vous au milieu d'un paragraphe ou avec la première phrase du paragraphe suivant pour enchaîner avec le travail du lendemain ?
Oui, j'ai toujours utilisé ce truc-là. Il est très efficace.
Mais c'est toujours une épreuve qui vous use les nerfs ?
Mm-hmmm.
Vous vous relisez avant de vous remettre à écrire ?
Voilà ce que je fais. Je travaille quatre heures par jour et d'habitude, au début de la soirée, je revois ce que j'ai écrit dans la journée et je fais beaucoup de corrections et de changements. Vous comprenez, j'écris à la main et j'établis deux versions de tout ce que j'écris. J'écris d'abord sur du papier jaune et ensuite sur du papier blanc, et quand le texte s'est organisé à peu près comme je le désirais, je le tape à la machine. Et pendant que je le tape, je fais ma dernière révision. Après, je ne change pratiquement plus un mot. [...]
Pensez-vous avoir exercé une influence quelconque sur les écrivains en Amérique ?
Je sais que j'ai eu beaucoup d'influence sur eux en raison de celle que j'ai eue sur ceux qui faisaient du journalisme. Je veux dire, j'ai inventé ces choses-là, mon cher. D'autres se démènent pour récolter les lauriers.
Et pensez-vous prospecter des voies inédites dans vos écrits futurs ?
C'est fait. Les textes qui ont été publiés dans Answered Prayers ont ouvert tout un champ d'expériences nouvelles déjà exploitées au-delà des mots. Je parle de tous ces romans mettant en scène des personnages célèbres et ainsi de suite.
Le journalisme est-il la dernière zone inexplorée sur la frontière littéraire ?
Je crois, oui. Mais je crois aussi que les deux activités font leur jonction comme deux grandes rivières.
La fiction et la non-fiction ?
Oui. Elles se rejoignent, divisées par une île qui va en s'amincissant et, tout à coup, ces deux rivières vont se confondre pour ne former à jamais qu'un seul courant. Cela se voit de plus en plus souvent dans l'écriture. [...]
Croyez-vous que Joyce et Proust se soient aventurés dans la fiction jusqu'à ses limites ?
Oh, non, pas du tout. La fiction a toujours ses racines, mais je crois qu'elle va s'inspirer de plus en plus de ce que j'essaie de réaliser, c'est-à-dire de muer la vérité en fiction ou la fiction en vérité. Je ne sais pas ce que c'est au juste, mais, fondamentalement, il s'agit de la vérité traitée sous une forme fictive.
Pourtant, dans votre esprit, fiction et non-fiction sont confondues ?
Ce n'est pas vraiment un problème de vérité ou de non-vérité. C'est avant tout un problème d'écriture narrative. La question est d'apprendre à contrôler le récit de sorte qu'il progresse plus vite et plus en profondeur en même temps. Techniquement, je peux manœuvrer aussi bien dans les deux directions. La seule chose que j'écrive avec facilité, ce sont les scénarios. La raison est la suivante : on croit être capable d'écrire un dialogue, cela va de soi. La difficulté dans ce domaine et la raison pour laquelle il y a si peu de scénaristes réputés bien qu'il y en ait beaucoup de florissants, c'est que tout repose sur la construction. Une fois le sujet construit dans votre tête, scène par scène, avec son début et sa conclusion, le problème est résolu. C'est que la construction est d'une grande difficulté. Et voilà pourquoi des inconnus réussissent si bien à Hollywood. On n'a jamais entendu parler d'eux mais ils ont ce don de la construction. J'ai moi-même un sens développé de la construction. Je construis à reculons. Je commence toujours par la fin et je remonte vers le début. Après tout, c'est toujours agréable de savoir où on va !
Cela signifie-t-il que vous devez écrire avec une compréhension intime du thème plus grande au début, c'est-à-dire quand vous en êtes à la fin, qui se restreint ensuite à mesure que vous progressez vers le commencement du livre ?
Oh, je parle du stade où je construis l'intrigue, pas de celui où je me mets à écrire vraiment, quoique, pour la rédaction, je commence toujours par écrire le dernier chapitre ou les dernières pages d'une nouvelle.
Dans quelle mesure le cinéma a-t-il influé sur votre écriture ?
Per se, aucune.
Pourriez-vous comparer l'écriture aux autres arts, comme la peinture ou la musique ?
Je crois que c'est une activité totalement à part.
Dans Musique pour caméléons, vous écrivez que vous relisez mot par mot tout ce que vous avez publié pour en venir à la conclusion que jamais dans votre vie d'écrivain vous n'avez libéré toute l'énergie et la dynamique esthétique dont étaient chargés les matériaux utilisés. Vous dites que vous n'avez jamais mis en œuvre plus de la moitié, ou même parfois du tiers, de vos possibilités. Êtes-vous toujours de cet avis ?
Non, je ne suis plus de cet avis. En fait, rétrospectivement, je crois que je me trompais. Quand j'ai écrit cela, je pratiquais une espèce d'autohallucination. Je ne voyais pas les choses d'un œil clairvoyant car, à coup sûr, j'écrivais toujours de mon mieux. Et mon écriture n'a pas beaucoup changé. Comme je vous l'ai dit, je me suis mis à écrire à huit ans et, à seize ans, j'étais réellement un écrivain accompli. À dix-sept, j'ai commencé à publier. Lisez les plus anciennes de mes histoires et vous verrez que mon style ne s'est guère modifié. Le sujet traité, bien sûr, peut être différent mais le style est à peu près le même et l'explication tient à mon oreille. J'écris énormément à l'oreille. J'écoute le timbre des mots comme un fanatique et je dois faire très attention car, de temps à autre, je me surprends à utiliser un mot simplement pour sa sonorité plutôt que pour le sens qu'il donne à la phrase. Je revois donc mes manuscrits avec une minutie de maniaque, je biffe, je corrige, je reprends sans arrêt.
Extraits de Lawrence Grobel, Conversations avec Truman Capote, Gallimard, 1987 (« Arcades »). Traduction de Henri Robillot.