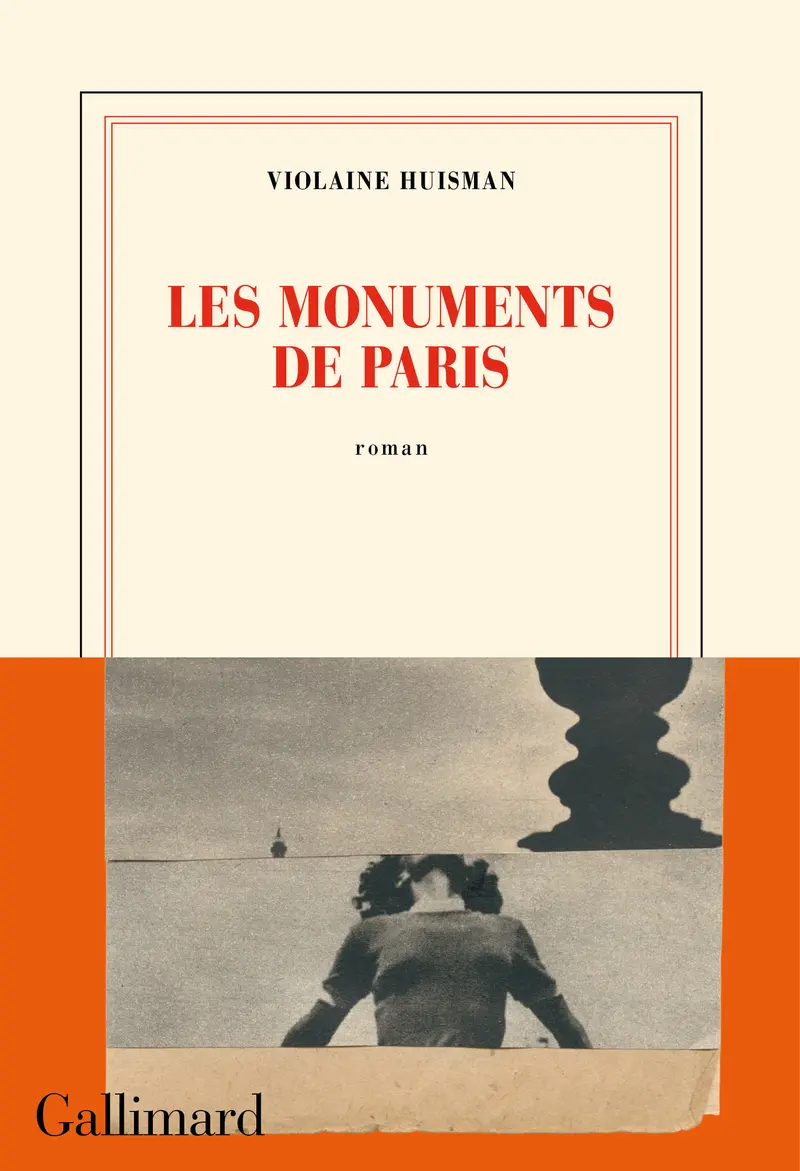Violaine Huisman nous parle des Monuments de Paris

« Mon père était un homme d’une autre génération, aurait-on dit pour excuser sa misogynie ou son pédantisme, un homme dont les succès justifiaient l’arrogance, dont l’affabilité surprenait autant que la fureur, dont la tendresse excessive, baroque, totalement débridée, trahissait l’excentricité ou expliquait en partie l’attachement qu’il inspirait en dépit de ses abominables défauts. J’étais sa petite dernière, sa numéro huit, avait-il coutume de dire pour me présenter dans le grand monde. Dans l’intimité, il m’appelait son petit ange. »
Votre père semble avoir toute sa vie mis en pratique – inconsciemment ? – un conte écrit par ses parents, La folle largesse…
Je me suis aperçue bien plus tard que ce conte, que j’avais lu petite, était le plus célèbre du recueil. La coïncidence entre ce titre et la façon d’être de mon père semble folle, mais il y a bien d’autres coïncidences, comme la fragilité de ses pieds, qui en faisait, quasi littéralement, un « colosse aux pieds d’argile », et par association un personnage d’une démesure quasi mythologique. Ce réseau de coïncidences, de correspondances et d’associations est d’une certaine façon la matière du livre : dans cette entreprise autofictionnelle, ou de fictionnalisation du réel, on ne saisit plus très bien ce qui vient avant : est-ce la fiction qui organise le réel, ou le réel qui s’organise par l’entremise de la fiction ? Cela peut fonctionner dans les deux sens.
Le roman s’attache également aux figures de Georges Huisman, votre grand-père, et de Hartog Huisman, votre arrière-grand-père…
C’est un point de vue romanesque qui m’est cher : la perspective du passé venant expliquer le présent, l’histoire venant expliquer le moment. Ou, si on veut le regarder de manière plus psychanalytique, l’histoire des parents venant expliquer les enfants. Je suis parvenue à me former une image mentale du personnage de Hartog à la lecture des cartes postales envoyées à Georges pendant la Seconde Guerre mondiale, retrouvées dans le grenier de la maison de famille de Valmondois. En découvrant son écriture, celle d’un homme à la limite de l’analphabétisme, j’ai là aussi trouvé extraordinaire que son fils soit devenu haut fonctionnaire et occupe des fonctions politiques jusqu’à être nommé directeur général des Beaux-Arts, l’équivalent de ministre de la Culture.
On croise aussi la mystérieuse Choute, la maîtresse de ce grand-père, présentée comme une duchesse mais qui s’efface sans laisser de traces… Comment peut-on perdre une duchesse ?
Disons qu’on peut découvrir une duchesse en ouvrant La Recherche et la perdre en refermant le livre ! Elle est là et elle n’est pas là, à la fois personnage de fiction et personnage réel : je ne sais d’elle que ce que mon père m’en a dit, et il en parlait comme d’une duchesse. Mais la façon dont elle apparaît et disparaît de la vie de Georges relève de la fiction. D’autant plus que, d’un point de vue à la fois intime et de romancière, Choute est la réincarnation fictionnelle du personnage de ma mère.
Vous évoquez ces gens qu’on a connus vivants, aujourd’hui devenus des noms de rues…
Toutes ces personnalités du XXe siècle, que je regardais comme de simples noms sur les plaques des rues de Paris, étaient pour mon père des personnages de son enfance, qui avaient construit sa vie. En écrivant cela, j’ai pensé à ce philosophe qui regardait nos villes comme des cimetières parcourus en compagnie de fantômes qui nous attendent aux coins des rues.
Romancière et traductrice, Violaine Huisman vit à New York où elle organise des festivals et des événements littéraires. Elle est l’autrice de Fugitive parce que reine (2018), prix Françoise-Sagan, prix Marie-Claire et dans la première sélection de l’International Booker Prize, et de Rose désert (2019).