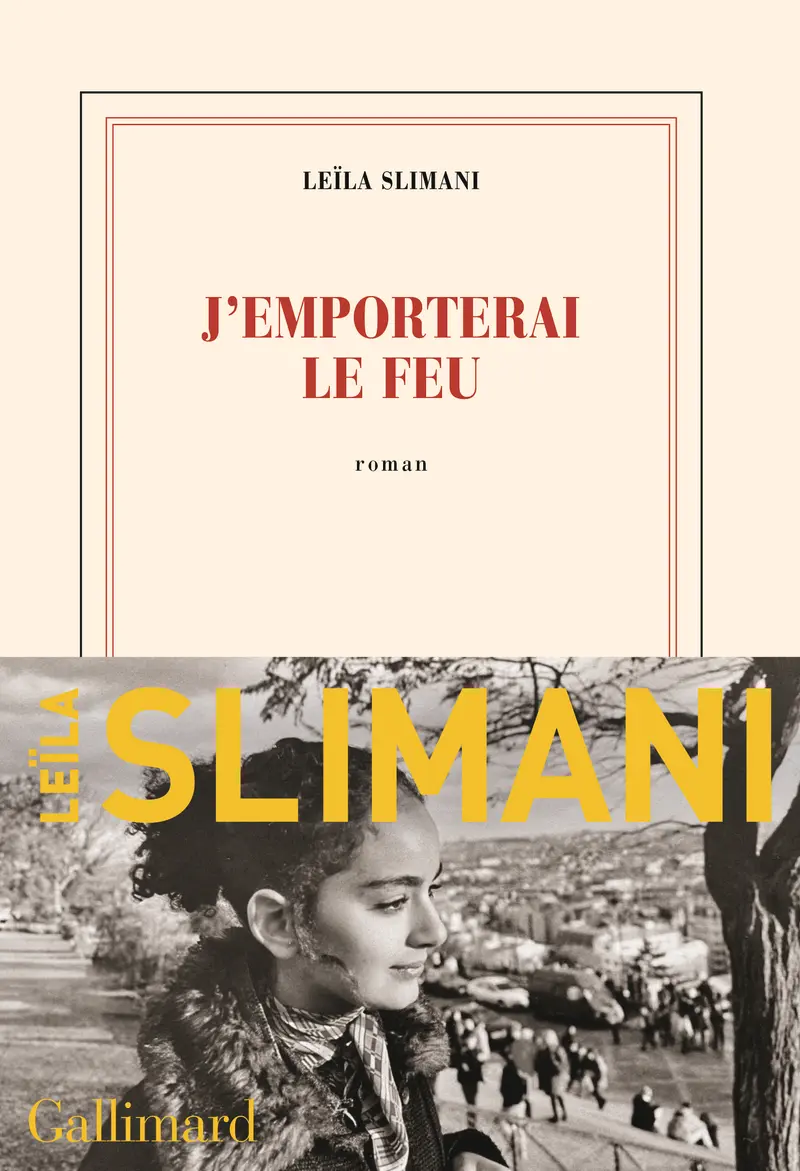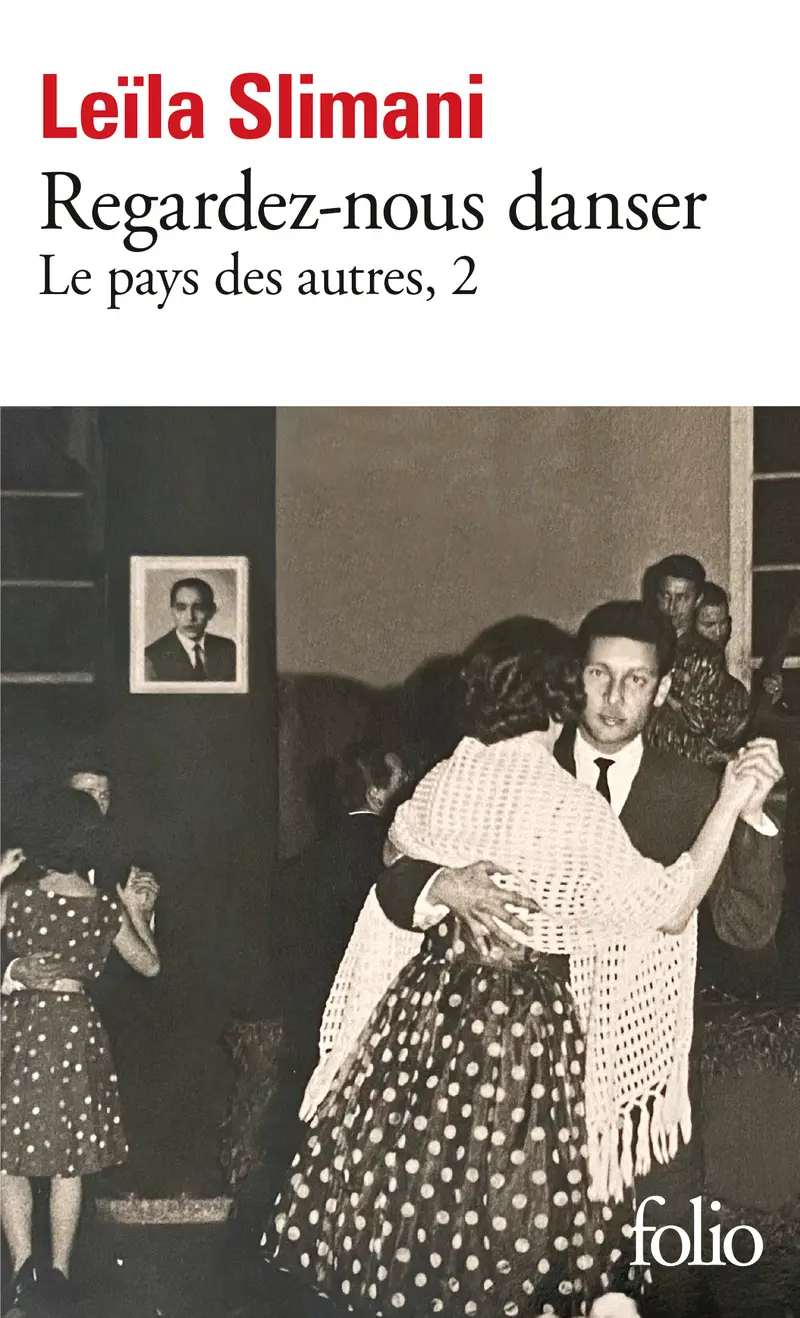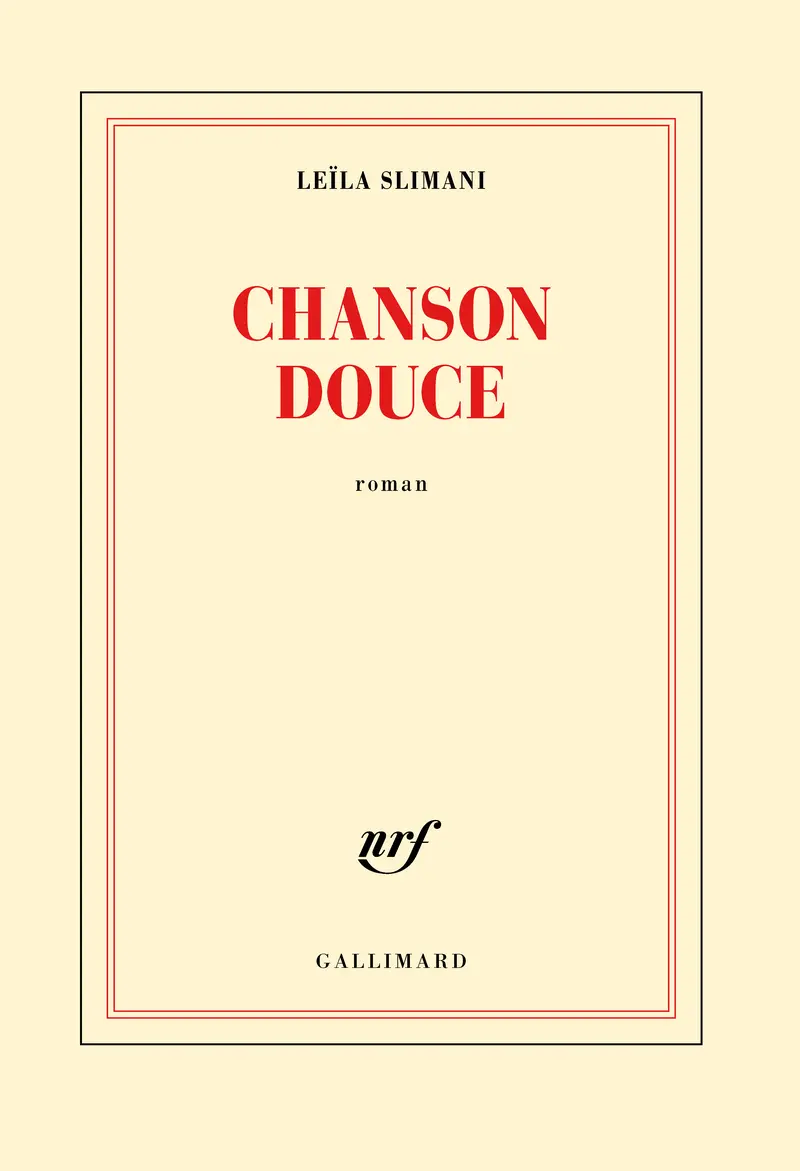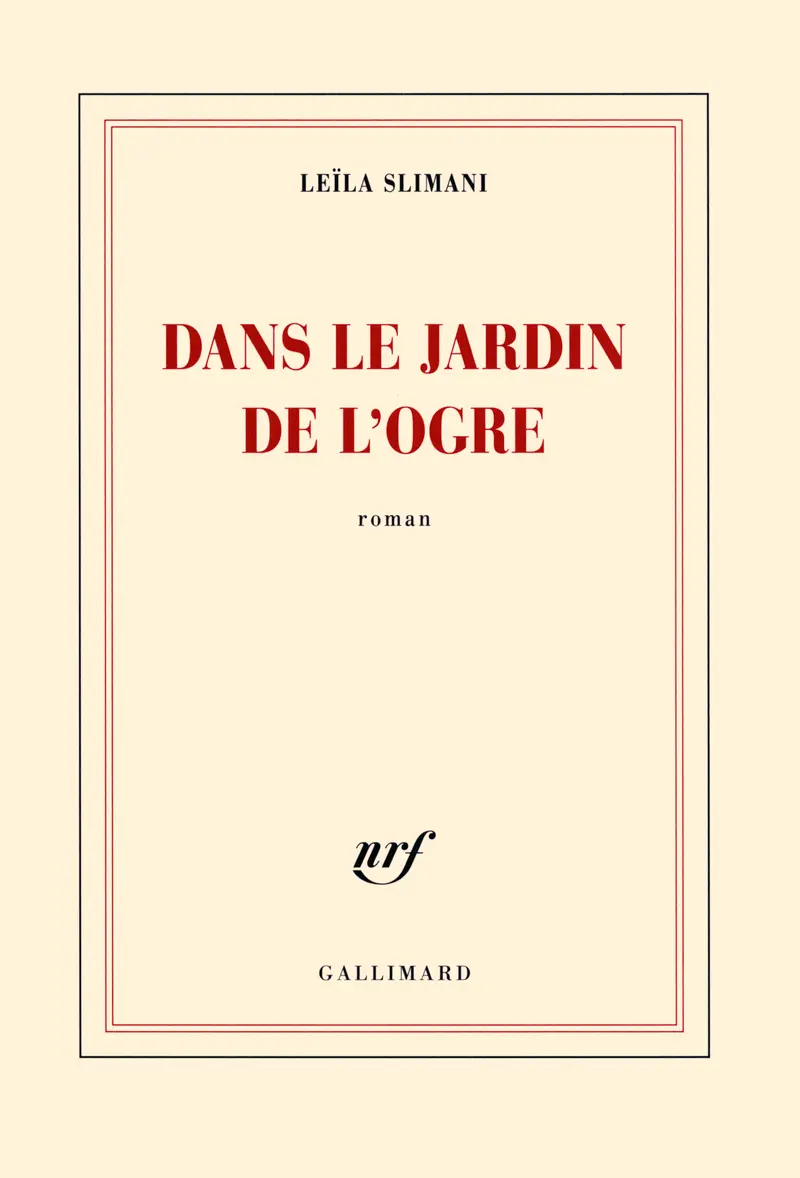J'emporterai le feu , le nouveau roman de Leïla Slimani

« Je lui ai expliqué où j’allais. “Le domaine Belhaj, sur la route de Meknès” […] À présent, une autoroute mène jusqu’au domaine. […] Quelques mètres avant la sortie qui mène à la ferme, on a construit un immense centre commercial. Des femmes voilées, toutes voilées, poussaient des chariots sur le parking. Au loin, j’ai reconnu l’allée de cyprès et j’ai indiqué au chauffeur la direction de la maison. Alors qu’on approchait, j’ai aperçu au loin d’immenses toboggans en plastique bleu et en lettres géantes, le mot AQUALAND. »
Ce troisième volet du Pays des autres se déroule dans un Maroc en route vers la mondialisation, dans les années 1980-2000. Un Maroc qui semble se chercher sans vraiment se trouver…
Comme pour les autres opus, j’ai choisi une période de transition, où des changements profonds sont en gestation. C’est la fin des années de plomb du règne de Hassan II et la fin de la guerre froide. Le pays se débat dans des difficultés économiques terribles et le fossé des inégalités se creuse. Les grandes idéologies révolutionnaires – le communisme ou le tiers-mondisme – auxquelles adhérait Mehdi Daoud, laissent place à l’ultralibéralisme. Bientôt, la mondialisation va faire sentir ses effets et tout comme mes personnages, le Maroc semble déchiré entre aspiration pour la modernité et peur de perdre son âme et ses traditions.
Autre évolution très nette, le pouvoir, privilège des hommes, passe dans les mains des femmes…
En effet, c’est un volet dans lequel les hommes s’éteignent, disparaissent. Les uns meurent, d’autres quittent le pays, Mehdi subit une injustice et perd son statut social. Ce sont alors les femmes qui vont prendre le pouvoir : Mathilde reprend la ferme, Aicha lutte pour aider son mari en pleine disgrâce, leurs filles vivent leur vie en Europe… Lorsque le dernier homme de la famille meurt, elles ne sont plus que des femmes à cet enterrement, comme si les femmes Belhaj survivaient à tout.
Malgré cette prise de pouvoir féminine, la sexualité semble toujours aussi taboue…
Dans les années 1980 à 2000, il était très difficile d’aborder le sujet dans le débat public, et même dans le cercle privé. Ainsi Mia, la fille aînée d’Aïcha, vit mal son homosexualité et souffre d’être constamment sous la pression de ses parents qui lui interdisent d’en parler. Elle les voit comme des hypocrites, des gens finalement très conformistes, qui professent une chose à l’intérieur de la maison et une autre à l’extérieur. Depuis, la société a évolué : même si le sujet reste délicat, il existe un débat public autour des droits individuels et de la séparation entre sphère privée et publique.
Lorsque Mia revient à la ferme afin de trier des objets ayant appartenu à sa mère, on la met en garde contre les serpents qui ont fait leur nid dans les vieux vêtements. Est-ce à dire qu’il n’est pas sans risque de fouiller dans les souvenirs ?
Ce roman interroge la mémoire et partant, la littérature. Jusqu’à quel point faut-il suivre l’exemple des poètes qui retourne dans le passé pour converser avec les morts ? Peut-être faut-il savoir arrêter de fouiller dans les souvenirs, arrêter d’y chercher des réponses qu’on ne trouvera jamais, et regarder vers l’avant. La narratrice, qui a perdu la mémoire et vit une profonde crise, finit par penser qu’il faut aussi savoir oublier et peut-être même pardonner.
Vous évoquez les papillons belle dame, ces grands migrateurs dont vous écrivez « ce n’est jamais celui qui part qui arrive à destination mais son petit enfant »…
C’est une métaphore à la fois de l’écriture et de l’immigration. Je suis frappée par le discours politique et médiatique sur le sujet, généralisateur et sans nuances, comme si l’immigration pouvait se résumer à un mot. Elle est non seulement multiple et complexe, mais ce sont surtout des mouvements très longs, très lents. Un processus continu qui s’étend sur des générations – entre la France et le Maroc pour ma grand-mère, ma mère et moi, et je n’ai pas l’impression que ce chemin soit terminé. Ça demande du temps de s’en aller, et ça demande du temps de s’installer. C’est aussi une métaphore de l’écriture car si Mathilde et Mehdi ont eu le désir d’être écrivains, c’est finalement Mia « le petit enfant » qui parviendra à raconter leur histoire.