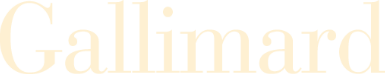Fille de Camille Laurens. Entretien
« Laurence Barraqué est née en 1959 dans une famille de la petite bourgeoisie de Rouen. Son père est médecin et sa mère femme au foyer. Très tôt elle comprend, à travers le langage et l’éducation de ses parents, que la position des filles est inférieure à celles des garçons. Cette expérience se prolonge à l’école, au cours de danse, à la bibliothèque municipale, partout où le langage impose la position dominante du genre masculin : "Garce. Le mot revient et la hante. C’est une injure. Mais n’est-ce pas d’abord le féminin de garçon ? ". »
Très tôt, Laurence, la narratrice, a le sentiment qu’être fille, c’est être moins. Ce sentiment vous semble-t-il générationnel ou est-il toujours actuel ?
L’évolution des mentalités et le mouvement féministe ont certainement contribué à casser un peu le modèle traditionnel fondé sur la valorisation du masculin, mais une enquête récente montre que les futurs pères continuent de souhaiter, peut-être par désir mimétique, avoir un garçon. Cela dit, c’était évidemment plus violent dans les années 1960, quand le patriarcat s’épanouissait sans entraves. Les femmes elles-mêmes intériorisaient alors l’idée d’une supériorité masculine parce que dans la loi, les hommes étaient privilégiés. Rappelons que les femmes n’ont eu le droit de vote qu’en 1945, et celui de signer un chèque en 1965 ! Si elles voulaient travailler, elles devaient obtenir l’autorisation de leur mari. Comme l’a bien montré Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe (1949) on est fille « par défaut ». Naître fille, c’est n’être qu’une fille. La référence, c’est le masculin.
Dans son enfance, la narratrice va découvrir l’omerta imposée par les autres femmes de la famille lorsqu’elle est victime d’attouchements…
Oui, et dans omerta il y a mort — mort psychique de la petite fille, mort de l’enfance. Mais cette injonction de silence est elle aussi produite par le patriarcat et l’idée que l’homme a des « excuses » à son comportement prédateur — des pulsions inhérentes à la masculinité. Et puis la famille, ce cas d’inceste, devient une microsociété qui rend ses propres jugements, édicte sa loi interne. L’essentiel est de cacher la honte ou de dénier la gravité du crime.
Autre sujet sensible, la mainmise des médecins hommes sur le corps des femmes, à travers le récit d’un accouchement dramatique…
L’abus commence dès les consultations, quand la patiente est méprisée, déshumanisée, ou que le médecin lui raconte des histoires grivoises. Dans le roman, le médecin accoucheur est incapable d’une relation humaine authentique. Il serait certes stupide de faire une critique manichéenne genrée, cependant il me semble que les médecins hommes gagneraient à faire leurs les qualités traditionnellement attribuées aux femmes — soin, attention, écoute, ce qu’on appelle le care.
Quel regard portez-vous sur l’évolution de la place des femmes dans la société française au cours des dernières décennies ?
Il y a eu une formidable évolution, d’abord avec le mouvement de libération des femmes dans les années 1970, puis avec MeToo. La parole se libère et la loi en tient compte. Reste que c’est fragile. Il faudrait que les hommes soient partie prenante au lieu de seulement craindre de perdre leurs aises.
L’autre « fille » du roman, c’est la fille de Laurence, Alice. Pour elle, être fille, c’est être, tout simplement. La liberté d’Alice serait-elle la libération et la victoire de Laurence ?
Oui, c’est ainsi que j’ai construit la progression du roman. L’aliénation de Laurence, la mère, son enfance contrainte et abusée trouvent une sorte d’échappée merveilleuse dans la liberté de sa fille, hors des assignations de genre. C’est un parcours difficile, un apprentissage où le rôle des générations s’inverse : c’est la mère qui reçoit le don de la liberté que lui transmet sa fille.
Entretien réalisé avec Camille Laurens à l'occasion de la parution de Fille.
© Gallimard