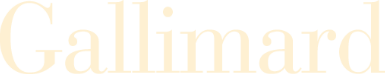La nouvelle par Paul Morand
« On peut écrire un roman avec mauvais goût, outrance et génie, mais il n'y a pas d'exemple d'une belle nouvelle qui ne soit techniquement réussie », écrit Paul Morand en 1934 dans la préface du volume inaugural de la collection « La Renaissance de la nouvelle », exclusivement consacrée au conte et à la nouvelle et dont Gaston Gallimard lui a confié la direction. Paul Morand donne ici sa conception d'un genre littéraire qu'il estime déconsidéré et où le Français, « analyste, méchant et décortiqueur », excelle.
Premier volume de la collection
« La Renaissance de la nouvelle »,
octobre 1934
À la vérité, il ne saurait y avoir renaissance, puisqu'il n'y a jamais eu mort. Depuis l'époque où elle arriva d'Italie avec de telles lettres de noblesse qu'elle rejeta immédiatement dans l'ombre les récits des troubadours, jusqu'aux temps actuels, la nouvelle a traversé les siècles d'un si vigoureux élan qu'elle a même pris en remorque quelques traînards : quel chemin aurait fait la lourde fable picaresque sans ces aventures détachées, semblables à des contes, qui en soutiennent l'intérêt ? N'est-ce pas à l'art dense et sec des conteurs que le seul roman du dix-septième siècle qui ait survécu, La Princesse de Clèves, doit sa pérennité ? Ingambes et allègres, L'Homme aux quarante écus et Candide permettent à Voltaire d'être impunément fastidieux dans ses tragédies. Atala et René (ces Mémoires d'Outre-Mer), présentés en « épisodes », réveillèrent les lecteurs assoupis sur les illisibles romans de la Révolution et de l'Empire. Marcel Proust avait pour Balzac l'admiration que l'on sait : « Quel romancier ! » s'écriait-il. Mais quand il avouait ses préférences, elles allaient à La Femme abandonnée, à Une Passion dans le désert, à La Fille aux yeux d'or, à La Grenadière ou au Bal de Sceaux. Ce sont des nouvelles, Les Soirées de Médan, qui ont lancé le naturalisme. Ce sont Les Nouvelles Asiatiques qui ont révélé au grand public Gobineau, inconnu malgré les Pléiades. C'est la traduction des Histoires Extraordinaires qui a valu à Baudelaire la notoriété (et d'ailleurs puisqu'il est question de Baudelaire conteur, je ne mets par La Fanfarlo au-dessous de L'Invitation au voyage). C'est dans des nouvelles, dans Clara d'Ellebeuse, Le Retour de l'enfant prodigue, Les Amants Singuliers, que le symbolisme a donné quelques-unes de ses plus belles proses. Ce sont des nouvelles qui ont fait connaitre Giraudoux, Arnoux, Kessel, Durtain, Jouhandeau, bien d'autres.
Affiche de librairie pour Films parlés d'Irène
Némirovsky dans « La Renaissance de
la nouvelle », 1934.
Rien ne m'étonne autant que de voir confondre roman et nouvelle, que d'entendre déclarer que la nouvelle est un roman court. La nouvelle est courte, cela va sans dire, mais ce qui la distingue du roman, ce n'est pas une différence de métrage ; en vérité, c'est une différence d'essence. Portés à l'écran, Le Rosier de Madame Husson et Boule de Suif perdent aussitôt leur surface lisse, leur force percutante ; c'est que, pour leur faire remplir l'heure et demie qui est la durée obligatoire d'un film, le cinéaste a dû les allonger en cascade, les charger de péripéties ornementales, appuyer sur le trait et, du coup, attenter aux lois qui conditionnent ces chefs-d’œuvre. Le roman se laisse, à volonté, étirer ou rogner, non la nouvelle : ses proportions lui sont imposées par son sujet même et ne dépendent pas du caprice de l'écrivain ; un roman peut être abandonné par l'auteur, puis repris, sans que sa composition en souffre ; à l'opposé, la technique de la nouvelle s'apparente à celle de la fresque ; cela « prend » d'un coup, comme un enduit, et durcit aussitôt. (À ce durcissement, Mérimée doit son éclat d'émail.)
Une nouvelle DOIT être courte ; cela ne veut pas dire qu'il faille la confondre avec l'esquisse ; elle est un travail soigné, non un brouillon hâtif ; bien plus que le roman, elle vaut par l'achèvement. Le roman est ce que chaque nouveau génie le fait ; la nouvelle obéit à ses lois propres, qui n'ont presque pas varié depuis la Renaissance. Elle a pour objet d'isoler un personnage, une action, de les dépouiller de l'accessoire, de les extraire de la vie, tandis que le roman tend à nous immerger dans une atmosphère ou, comme disait Péguy, dans un « climat » moral ; aussi l'Anglais, avec sa puissance de suggestion, est-il bon romancier, et le Français, analyste, méchant et décortiqueur, est-il bon faiseur de nouvelles. Constante dans ses intentions, ferme dans ses conclusions, telle est la nouvelle ; alors que le roman osera des reculs, des repentirs, des jeux, car sa flexibilité peut tout se permettre. Parfois le romancier est tenté de mépriser le souffle court de son rival ; mais le conteur qui écrit en se contractant et en se délivrant d'une seule secousse, se moque de son confrère empêtré dans un inventaire de passions, dans un musée de paysages, la tête perdue dans sa rhétorique ou ses péripéties.
On peut écrire un roman avec mauvais goût, outrance et génie, mais il n'y a pas d'exemple d'une belle nouvelle qui ne soit techniquement réussie. Un écrivain qui n'est pas un artiste ne produira jamais une nouvelle de qualité. Si, au deuxième chapitre, il entrevoit la possibilité de développer son sujet et de partir dans un roman, c'est que sa nouvelle n’est pas bonne ou c'est qu'il n'a pas le sens de la nouvelle ; il manquera les siennes ; il n'a pas le coup de main. Pour parler le jargon des cuisiniers, le roman est une « composition » avec marinade ou sauces de base, tandis que la nouvelle est une grillade ; une pièce bien grillée ne se retourne jamais deux fois.
Les Sept minutes de Georges
Simenon dans « La Renaissance de
la nouvelle », 1938.
La nouvelle se place en pleine lumière, sous le jour le plus cru : son sujet, ses personnages, son ton même ne sauraient être faux sans que cela se voie ; tandis que, sous le torrent de la fécondité, le romancier peut dissimuler tout ce qu'il veut. Assurément, il y a de longues nouvelles, des nouvelles-fleuves : ce ne sont pas les meilleures : on attend impatiemment de les voir déboucher dans la mer ! Il existe surtout des romans-fleuves qui, avançant par épisodes juxtaposés, ne constituent parfois qu'un chapelet de nouvelles reliées entre elles par l'enchaînement artificiel du procédé simultanéiste. (« Pendant que Mlle X... pleurait au Père-Lachaise sur la tombe de sa mère, à Bar-le-Duc, au même moment, M. de Z..., penché sur son poêle à gaz ... ».) Ces nouvelles-là, non plus, ne pourraient être citées comme des modèles parfaits du genre, car le lecteur, quand il a terminé l'épisode, se demande naturellement ce qui va arriver par la suite. Or, c'est une question que le lecteur ne doit pas se poser : la nouvelle n'est pas, comme le roman, un déroulement dans le temps, une fraction plus ou moins longue de la durée dans toute sa multiplicité, ses entrelacs, ses contingences ; la nouvelle est statique ; l'auteur ne sent pas naître et sortir de lui, en un obscur enfantement, toutes les conséquences de son sujet ; il les a embrassées d'un seul regard. La nouvelle est une coupe rapide pratiquée dans le réel ; elle ne saurait prendre l'homme à sa naissance, l'expliquer par ses racines, l'accompagner dans sa croissance ; elle fond sur lui dans une de ces minutes suprêmes où tout le potentiel d'un caractère ou d'une situation se convertit en acte, et elle l'immobilise dans cet acte qui le résume. En ce sens seulement peut-on dire qu'elle est un choc, choc d'une expression inconnue et révélatrice, surprise sur un visage familier ; et si elle est cruelle, c'est que toute révélation l'est. On peut concevoir une nouvelle où il ne se passerait rigoureusement rien. Instantané d'un athlète capté dans son saut, au moment où il est en l'air. Mais, dans cet instantané, quelle richesse d'images, d'émotions, d'enseignements ! Pour un poète, quel thème que ce jet d'eau qui ne retombe pas ; quelle pureté dans cet effort coupé de ses causes et de ses effets. Le désintéressement vis-à-vis de ce qui arrive, de tout ce qui, en outre, pourrait arriver, voilà par où la nouvelle s'apparente au poème. N'est-ce pas ce qui nous enchante dans L'Inutile Beauté ou dans Le Sphinx ? Et, s'il m’est permis de prononcer leurs noms après de tels noms, est-ce que Tendres Stocks, La Nuit de Charlottenburg, Les Amis Nouveaux ne sont pas aussi des compositions immobiles dont on ne retient que quelques profils, l'humeur d'un moment, un certain éclairage ? Le mouvement dans lequel je les ai écrits n'était pas un mouvement d'horlogerie, mais plutôt une sorte de poussée, de raid, de coup de main poétique sur un objet, un être, un pays.
Aujourd'hui, les hommes n'ont plus le loisir de pénétrer les antécédents et les secrets des gens à qui ils serrent la main. N'est-il pas naturel qu'avec les personnages fictifs aussi ils entretiennent ces rapports sommaires, brefs, mais nets auxquels les habitue déjà l’écran, et qu'ils demandent leur plaisir à des récits fulgurants et bourrus ? La faveur que le public témoigne en ce moment à la nouvelle, dans les hebdomadaires, en est la preuve. Les éditeurs n'en conviennent pas encore, au nom d'anciennes préventions. Je souhaite que les talents que cette collection s'est efforcée de réunir réussissent à les faire changer d'avis.
Paul Morand, 1934
Préface au Sphinx et autres contes bizarres d'Edgar Allan Poe, Gallimard, 1934 (« La Renaissance de la nouvelle »).
Retrouvez « La renaissance de la nouvelle » en d'autres collections :
|
|
|
|
|
|
|
Sur le site
› En savoir plus sur : Paul Morand éditeur
› Histoire d'un livre : Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar
› Tous les titres de la collection « La Renaissance de la nouvelle »
© Éditions Gallimard