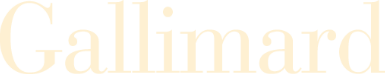Le Chant du monde de Jean Giono
« Je souhaite, j'appelle, j'implore un Giono déchaîné ! » écrivait Marcel Arland en 1953, se félicitant de la parution, vingt ans auparavant, du Chant du monde, roman mythique à tous les sens du terme : « l'œuvre résiste à l'épreuve ; quelque admiration que l'on puisse avoir pour l'auteur du Hussard, l'auteur du Chant sait encore nous entraîner. »
Le Chant du monde, 1934.
Apparemment la première version du Chant du monde, Jean Giono se l’est fait voler. Fin 1931, durant une absence, sa mère, qui commençait à être aveugle, a fait entrer dans son bureau plusieurs personnes qui voulaient le voir ; à son retour, son manuscrit, gros de trois cents à trois cent cinquante pages d’écriture environ, avait disparu. Pour n’importe qui cela aurait constitué bien sûr un drame ; mais pour Giono, chez qui l’écriture est une sorte de respiration naturelle, ce vol n’a pas eu beaucoup de gravité. Après avoir fouillé toute sa maison, il est passé sans amertume à autre chose. En janvier 1932, voici qu’il travaille au Lait de l’oiseau, c’est-à-dire à Jean le Bleu. Et le 20 juin déjà, il annonce à son vieil ami Lucien Jacques qu’il « refait » le Chant du monde : « Je l’étends en plus large et en plus haut que la conception première, et si je le réussis, les petits copains se casseront le nez cette fois sur quelque chose de grand. »
Or, cette deuxième version, elle-aussi, se perd, on ne sait diable pas comment. Le 3 janvier 1933, Giono décide de ne pas récrire les pages perdues et commence un roman tout à fait différent sous le même titre — le « chant du monde » lui rappelle sa lecture enthousiaste des Feuilles d’herbes de Walt Whitman. Dès lors, des neuf dix heures par jour, il s’attelle à sa tâche, « lancé là-dedans comme un taureau ». Sa volonté première est de rompre, au moins provisoirement, avec la Provence, avec le pays sec et l’été dont il a imprégnés ses livres précédents ; il veut faire place à un « paysage plus liquide » : « Je sais très nettement que j’ai commencé à voir un fleuve, à voir un personnage qui était un homme du fleuve ». Ce qu’il désire aussi, histoire de changer, comme il dit, c’est introduire de plain-pied dans son œuvre l’élément montagnard qu’il a seulement évoqué dans Angiolina et Prélude de Pan. Or, depuis la crise de 1929, il a choisi de tirer ses ressources de ses seules productions littéraires, alors il a besoin d’écrire avec confiance, et rapidement. Il reconnaît improviser ici tout à vau-l’eau, sans difficultés particulières. Son roman prend vite sous son stylo des allures de « western », devient « une sorte de Saga norvégienne », beaucoup plus libre en tout cas dans l’intrigue que ne l’ont encore jamais été ses histoires antérieures. En juin 1933, il y travaille en Haute-Provence chez le peintre Eugène Martel puis s’installe dans le Jura suisse, à Vallorbe, chez sa cousine Antoinette Fiorio. On lui aménage dans le grenier de la maison une sorte de bureau ; de la lucarne, il voit la Dent de Vaulion et les forêts qui entourent la source de l’Orbe. S’il observe avec attention la nature au dehors, ce n’est pas pour la restituer à l’identique dans son texte : il prend au contraire un plaisir divin à mettre une montagne à la place d’un col, à modifier fantastiquement le paysage réel sous l’influence des saisons ; à remplir son fleuve de congres mythologiques ; à faire parler entre eux les oiseaux et les arbres. Il écrit ainsi de toutes ses forces contre l’esthétique naturaliste de ses contemporains. Revenu pacifiste et anarchiste de la guerre de 1914, il rêve d’imposer en littérature une nouvelle utopie, un monde qui n’ait « absolument rien d’actuel » : « Les temps présents me dégoûtent même pour les décrire. C’est bien assez de les subir. […] des hommes existent aussi qui ne connaissent rien de l’horrible médiocrité dans laquelle la civilisation, les philosophes, les discuteurs et les bavards ont abaissé la vie humaine. »
En septembre 1933, il achève Le Chant du monde et le soumet, comme convenu, à Gaston Gallimard, avec qui il s’est rabiboché après un couac (en novembre 1930, Giono avait signé simultanément et pour les mêmes livres deux contrats avec Gallimard et Grasset). Du 1er mars au 15 avril 1934, le roman paraît en feuilleton dans la Revue de Paris. Giono le sous-titre alors « I. Le besson aux cheveux rouges », ayant l’espoir d’en faire une suite, peut-être un cycle de quatre romans (il ne l’écrira pas). Le Chant du monde paraît chez Gallimard le 16 mai, avec un succès immédiat. La presse de tous bords politiques le salue avec enthousiasme : Marcel Arland signe un article dans La NRF ; Eugène Dabit dans Europe ; Brasillach dans L’Action française. Dans L’Humanité, Aragon voit en Jean Giono « le seul poète de la nature », ne lui reprochant que d’« abuser » par son don lyrique le « Giono sociologue ». On parle un moment du Chant du monde pour le Goncourt ; mais Giono n’est pas dans la course à Paris, où se dispute le prix. Au reste, il ne sait plus lui-même s’il aime son roman. Courant juillet, il écrit à Lucien Jacques qu’il le juge raté, la fin du volume ayant « un petit côté imbécile et couillon ».
Le Cheval fou, adaptation scénique
du Chant du monde, 1974.
Reste qu’il en tire un scénario de film (non tourné) en 1941, et une pièce presque achevée en 1958, Le Cheval fou — ce qui témoigne pour ce roman d’une affection plus grande qu’il ne le reconnaît. Pour les lecteurs actuels, comme pour Gide qui fut l’un des premiers « écouteurs » de Colline (1929), ce qui frappe chez le Giono d’avant guerre est « bien mieux qu’un simple don verbal : une vigueur, un relief surprenant, une joie contagieuse ». Car il est à peu près le seul dans son temps à faire ressentir une antique conscience perceptive très largement négligée depuis le début du siècle, cette espèce de saveur virgilienne et sensuelle qu’on retrouvait certes un peu avant lui chez Ramuz, mais qu’on a peu retrouvé depuis, sinon, toutes proportions gardées, dans les meilleures pages de Maurice Chappaz et Jacques Chessex.
Amaury Nauroy
|
| ||
|
|
|
|
|
Deux éditions du Chant du monde en Folio, |
||
Bibliographie indicative
- Jean Giono, Le Chant du monde, Gallimard, 1934. Repris en « Folio » en 1972.
- Jean Giono, Œuvres romanesques complètes, II, Gallimard, 1972 (« Bibliothèque de la Pléiade »).
- Jean Giono, Jean-Pierre Grenier, Le Cheval fou (adaptation scénique du Chant du monde), Gallimard, 1974 (« Le Manteau d'Arlequin »).
- Laurent Fourcaut. Le Chant du monde de Jean Giono (essai et dossier), Gallimard, 1996 (« Foliothèque »).
© Éditions Gallimard