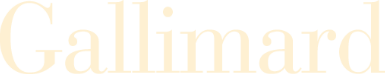Le Bavard de Louis-René des Forêts
Publié au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Le Bavard de Louis-René des Forêt interroge le pouvoir de la parole. Cette œuvre singulière, resté confidentielle à sa parution, est devenue dans les années 1960 un livre de référence pour toute une génération.
Louis-René des Forêts
par Marc Foucault.
Certains écrivains ne sont peut-être nés que pour aider un autre écrivain à écrire une phrase. Ainsi, quelques années avant d’entamer Le Bavard, Louis-René des Forêts a lu avec passion dans un vieux numéro de la revue Mesures un article de Kleist, « L’élaboration de la pensée par le discours », traduit par Jacques Decour. Il a appris à cette occasion que l’« orateur » se définit comme celui « qui ne [sait] pas encore ce qu’il [va] dire au moment d’ouvrir la bouche ». Il le saurait donc, lui, lorsqu’il écrit volontairement « au petit bonheur ». Sous l’influence de Joyce qu’il a une fois rencontré chez Adrienne Monnier, Des Forêts s’est tôt intéressé au monologue intérieur, aux plus profonds ressorts de la voix. Déjà dans Les Mendiants (1943), le premier livre qu’il a publié chez Gallimard et qui lui a de suite valu à la fois l’estime de Camus et l’amitié de Queneau, il a mis en scène « onze figures vocales ». Mais à travers la parole il interroge plus que le langage, ce qu’il est.
Depuis le début de la guerre, et pendant la rédaction intermittente du Bavard, entre 1944 et 1946, Des Forêts semble buter contre une question grave qu’il formulera de la sorte : « Suis-je un homme, une ombre, ou rien, absolument rien ? » Car il vient de vivre trois traumatismes : en 1940, son père est mort ; en 1944, son frère aîné, qui a rejoint les Forces françaises libres, a été tué au combat devant Belfort ; en 1945, son ami Jean de Frotté, à qui il dédiera son poème Les Mégères de la mer (1967), est déporté et fusillé par les nazis. La découverte des charniers frappe son écriture de suspicion, sa parole, peut-être, d’inanité. Des Forêts cherche en vain un discours vrai à prononcer pour justifier ces morts, la vérité semblant être devenue « pacte avec l’illusion ». C’est à ce moment qu’il lui vient « cette illumination » que ce qu’il cherche, il l’a sous la main : « Je parlerais de mon besoin de parler. » C’est-à-dire moins du « bavard », en fait, que du « bavardage » ; et sans aucune volonté de dégager un type, ni un de ces caractères au sens où l’entendait La Bruyère. Il veut plutôt fouiller le complexe usage qu’on se fait chacun de la langue, et pose la garrulité, vous savez, cet incessant pépiement d’oiseaux dans le langage, comme origine de la littérature. Aussitôt il place, en exergue du Bavard, une citation de Rivarol : « Il a une furieuse démangeaison de parler ; il étouffe, il crève s’il ne parle pas. » Puis, il se retire dans sa campagne du Berry pour écrire. À l’opposé d’un roman d’analyse ou d’un roman psychologique, il cherche à composer là un « roman ontologique » et musical. Un des buts auxquels il vise – si tant est qu’il vise à un but précis – « serait de pouvoir exprimer, par une concentration de plus en plus grande des éléments rythmiques, la pulsation intérieure, la scansion de l’être ».
Pour ce faire, il s’arme de ruses. D’abord, il transpose dans son texte des citations illusoires de Kleist, Breton, Constant, Hemingway, Faulkner (dans la traduction de Maurice-Edgar Coindreau) ; il dissimule de façon oblique un récit de Dostoïevski – tout ce travail de tissage revenant à faire entendre que, à son avis, parler est être dépossédé de sa parole.
Le « stratagème », dit-il, consisterait « à mettre en œuvre tous les prestiges de la fiction (sous des dehors rassurants et avec un souci de cohérence qui se tourne bientôt en dérision) pour maintenir à la fois une distance et une relation entre le lecteur hypothétique et lui-même, relation et distance sans lesquels il n’aurait pas la force de parler, ni l’autre de l’entendre. Confrontation sans intimité qui ne peut se poursuivre qu’au prix d’une duperie, et qu’il dénonce pour finir en démontant pièce par pièce le mécanisme, ce qui est encore une façon de prolonger le pouvoir qu’il exerce par la parole, mais en même temps de s’en dessaisir et de signifier sa propre mise en congé. (Cet acte brutal de dévoilement est aussi un acte subtil de dissimulation. » Cela fait, au final, un livre étrange, une sorte de « ventriloquie de l’intime contrariété », si l’on reprend la formule de son ami Michel Deguy (futur collègue, aussi, au comité de lecture des Éditions Gallimard).
Dans « L'Imaginaire »,
édition de 1978.
Au printemps 1945, Des Forêts envoie la première partie du volume à la revue L’Arbalète qui le publie dans sa dixième livraison. Le Bavard paraît chez Gallimard en 1946. Le 21 septembre, Jean Blanzat en parle dans Le Littéraire comme d’un « divertissement intellectuel », alors que Nelly Cormeau, dans le numéro 9 de Synthèses, le décrit comme un livre « amusant et déconcertant tout ensemble » – autant dire que sa réception est nulle. Dix-sept ans plus tard, en 1963, Des Forêts reprend son texte pour une édition en poche chez 10/18. Il supprime la citation de Rivarol et opère sur le contenu du livre quelques corrections stylistiques. Son ami Blanchot, grand critique de La NRF, écrit une postface faisant du Bavard un « pur récit de fantôme où même le fantôme est absent ». L’année suivante, des entretiens avec Des Forêts paraissent dans le numéro 10 de la revue Tel Quel, dirigée par Sollers. Le Bavard est mieux compris dans cette période d’expansion du Nouveau Roman et d’intenses recherches linguistiques que dans le contexte de l’après-guerre, où l’heure était aux romans naturalistes. Il devient un livre de référence pour toute une génération, défendu par Bataille, Nadeau et Pingaud d’abord, puis par Jabès, Puech, Millet, Rabaté, Bonnefoy… En 1978, Quignard signe la quatrième de couverture de la réédition du volume dans la collection « L’Imaginaire ». Il se pourrait que Le Bavard soit avec Bouvard et Pécuchet un des constats les plus terribles sur l’inanité de la littérature. À tout le moins met-il les scribouillards en garde, comme autrefois Montaigne dans son chapitre « De la vanité des paroles », contre les apprêts stylistiques. « Les mots dont chacun use et abuse jusqu’au jour de sa mort. / Les a-t-on jamais vus agiter les feuilles, animer un nuage ? » (Poèmes de Samuel Wood).
Indications bibliographiques
- Louis-René des Forêts, Le Bavard, Gallimard, 1946. Repris dans « L'Imaginaire » en 1978
- Maurice Blanchot.« Sur les poèmes de Louis-René des Forêt », dans Une voix venue d'ailleurs, « Folio essais », 2002
- Yves Bonnefoy, « Une écriture de notre temps », dans La Vérité de la parole, Mercure de France, 1988
- François Dominique. À présent. Louis-René des Forêts, Mercure de France, 2013
- « Hommage à Louis-René des Forêt », dans La NRF n° 559, octobre 2001
- Bernard Pingaud, « Les pouvoirs de la voix », dans L'Expérience romanesque, Gallimard, 1983
© Éditions Gallimard