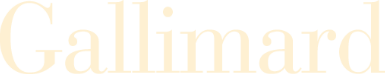La punition de Tahar Ben Jelloun. Entretien
« Des ordres fusent, des insultes du genre “on va l’éduquer ce fil de pute”. Le moteur de la jeep militaire crache une fumée insupportable. C’est l’époque où l’on vit dans la peur, où l’on parle à voix basse, en soupçonnant les murs de retenir les phrases prononcées contre le régime, contre le roi et ses hommes de main. Avant de repartir, l’un des deux soldats dit à mon père : “Demain ton rejeton doit se présenter au camp d’El Hajeb, ordre du général. Voici le billet de train, en troisième classe. Il a intérêt à ne pas se débiner.” »
De quelle punition s’agit-il ?
C’est une punition d’ordre politique, à la suite des manifestations d’étudiants, puis de chômeurs, de mars 1965 à Casablanca et Rabat. Quatre-vingt quatorze membres de mouvements étudiants, dont moi, ont été rendus responsables de ces manifestations férocement réprimées. Ordre a été donné de nous arrêter et de nous envoyer dans un camp disciplinaire de l’armée. Officiellement, nous faisions un service militaire. La punition consistait à nous maltraiter par tous les moyens, en nous plaçant entre les mains de soldats analphabètes, stupides et brutaux, qui avaient la haine de l’écrit, de l’intellectuel. Cette punition psychologique et physique a duré dix-neuf mois.
Une punition qui se transforme progressivement en machination…
À l’époque de Hassan II, le peuple n’avait qu’à bien se tenir et à se taire, ceux qui parlaient étaient punis. Au camp, nous étions sous la coupe du commandant Ababou et de son bras droit, l’adjudant Aqqa, une énorme brute, chargé de nous punir. Jusque-là tout était simple, puis Ababou a commencé à nous convoquer pour parler de Marx, de Lénine… C’était ubuesque de se retrouver chez son bourreau pour répondre à des questions sur le communisme. En fait, ces deux hommes préparaient un coup d’État. On ne saura jamais si c’est nous qui leur avons donné l’idée de renverser le pouvoir ou s’ils avaient déjà prévu de nous manipuler dans ce but. On l’a échappé belle : s’ils avaient réussi à nous entraîner dans cette machination, nous aurions tous été exécutés.
Vous racontez cette période comme si vous étiez en train de la vivre…
C’est une décision littéraire. Je voulais raconter au présent, de manière factuelle, sans fioritures, sans adjectifs, sans rien. Raconter les choses telles qu’elles s’étaient passées à l’époque, au jour le jour, sans savoir ce qui allait nous arriver le lendemain.
C’est au cours de cette période que vous êtes devenu écrivain…
Nous n’étions pas certains d’être libérés un jour, on nous répétait «vous ne sortirez pas de là vivants». Notre peur était légitime, et j’ai commencé à écrire avec l’idée un peu romantique de laisser quelque chose après ma mort pour dénoncer ce qui se passait. Comme je ne pouvais pas écrire directement les choses, je passais par le symbolisme, les allégories, les métaphores, la poésie. Mon premier poème a été publié à ma libération.
Vous avez peint une série de tableaux sur le thème des portes. Peut-on y voir un lien avec la privation de liberté ?
Au départ, j’ai peint dans une cellule d’une ancienne prison de l’île de Lipari, en Italie, une immense fresque avec une porte ouverte sur la mer, le ciel, les oiseaux, la liberté, et j’ai continué sur ce thème de la porte, de l’évasion, car j’ai gardé entre autres séquelles de cette période l’angoisse de l’enfermement. La punition a été terrible : j’ai dû attendre cinquante ans avant de pouvoir écrire ce livre…
Entretien réalisé avec Tahar Ben Jelloun à l'occasion de la parution de La punition.
© Gallimard