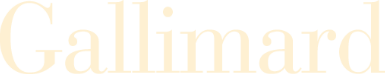Michel Déon (1919-2016)
« Le roman est l'outil idéal qui nargue le temps et l'espace. Il interprète l'irréalité pour en faire de la réalité, ou le contraire. Divagation, intuition, condamnation, délire ou pure complaisance de l'auteur envers soi-même, le roman est tout à la fois. Il mérite seulement quelques soins de son créateur et la complaisance d'un lecteur idéal. » Le romancier et académicien Michel Déon, auteur des Poneys sauvages, d'Un taxi mauve et du Jeune Homme vert, s'est éteint le 28 décembre 2016. Sa vie vagabonde entre la France, la Grèce et l'Irlande a nourri ses livres et provoqué son imagination.
› Œuvres de Michel Déon aux Éditions de la Table Ronde ; › aux Éditions Gallimard
« Le classicisme de Jacques Chardonne n'exigeait pas de lui qu'il se déplaçât en dehors de France. Celui, plus nerveux, de Paul Morand s'accommodait, au contraire, de vagabondages planétaires. Michel Déon, qui écrit avec la mesure du premier et la ferveur du second, est un homme qui va à l'étranger pour connaître d'autres sollicitations que celles de la France contemporaine il a beau l'aimer, il lui faut revoir les sources grecques et se plonger dans les brumes irlandaises; parfois aussi, il prend la température des excès américains. Lorsque le temps vient de retrouver les méandres de la Seine ou les lenteurs délicieuses de la Loire, il garde cette sorte de distance toute de pudeur, qui marque chacun de ses livres. L'exotisme peut ainsi se métamorphoser en familiarité parcourue de surprises. » Alain Bosquet, « Bagages pour Vancouver, de Michel Déon (La Table Ronde) », La NRF n° 394, novembre 1985.
| Michel Déon évoque les éléments qui ont nourri son écriture : l'imagination et la sensibilité, les paysages, les influences poétiques. Il faut une sacrée dose de naïveté pour entreprendre un roman « En y réfléchissant, j'ai passé bien plus de temps dans mon existence à travailler qu'à courir les routes, mais si je comptabilisais les heures à ma table, je ne trouverais en bas de l'addition que les livres qui en sont le fruit. Une vingtaine au plus. Ce n'est pas excessif. On ne doit pas abuser de la permission de publier. Si peu que ce soit en près de quarante ans d'écriture je pense avec plaisir aux journées de travail. Les premières furent certainement les plus heureuses. Je n'ai pas souvenir de longues batailles avec les mots lors de mes débuts. Sans doute parce que le journalisme contraint et habitue à écrire vite sur une matière donnée, sans doute parce que, pour mes premiers livres, j'avais plus à faire avec l'imagination et la sensibilité. Au fil des ans, l'imagination refroidit et la sensibilité durcit. Le langage, qui n'était qu'un moyen, a tendance à devenir une fin, même une fin en soi. On s'est enrichi pour découvrir qu'on s'appauvrit et que la création passe par un autre stade. Il y a peut-être un moment d'équilibre parfait pour un écrivain quand sa faculté créatrice est encore impulsive, que les mots qu'il trie prennent une valeur sacrée et qu'il se met à en inventorier le contenu exact, à en caresser la musique. La maturité engendre le doute. Un jeune écrivain matelassé de dictionnaires et de manuels du bien écrire est un futur fruit sec. Il prend le problème à l'envers et a des chances d'étouffer l'expression avant qu'elle naisse et qu'il l'ait identifiée. Il n'écrira rien d'autre, ou si, par hasard, une critique bienveillante l'a encouragé, il se répétera avec une complaisance vite intolérable. Trop tôt il a maîtrisé un langage que la vie n'irriguait pas. Plus tard… c'est une autre affaire. La conscience de soi, le jugement, le discernement prennent le pas sur l'imagination. Les idées pour s'imposer ressentent le besoin aigu d'une forme. Tout ce que l'on croyait savoir est oublié au nom d'une autre expérience plus réfléchie et personnelle. Entre-temps un homme est né. Kléber Haedens disait qu'il faut une sacrée dose de naïveté pour entreprendre un roman. » Michel Déon, Bagages pour Vancouver, dans Pages françaises, Gallimard, 1999 De l'importance des paysages
« Je me suis promené en Europe avec peu de bagage. De quoi un écrivain a-t-il besoin ? Une table, une rame de Michel Déon, Parlons-en… Conversations avec Alice Déon, Gallimard, 1993 Sur la poésie
«Souvent, dans ces séances de signatures auxquelles il faut sacrifier de temps à autre, des lecteurs questionnent ingénument l'auteur : "Où êtes-vous allé chercher ça ?" Impossible de répondre. Le lieu mythique où nous allons "chercher ça" n'existe pas et, pourtant, parviennent des messages auxquels on ne saurait rester sourd. La forme poétique est la transcription brute ou décodée de ces messages. Paul Valéry disait d'un vers du Cimetière marin dont on lui demandait le sens : "Quand il m'est venu, nous étions deux à le savoir : Dieu et moi. J'ai oublié et maintenant il n'y a plus que Dieu." Michel Déon, Parlons-en… Conversations avec Alice Déon, Gallimard, 1993
© Éditions Gallimard |