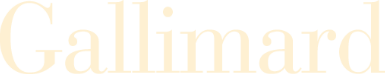Quinze causeries en Chine de J.M.G. Le Clézio. Entretien
« Mon aventure en Chine, commencée il y a bien longtemps lorsque, en été, sous le ciel jaune de Nice, je m’efforçais d’apprendre les idéogrammes pour mon futur voyage — cette aventure est aussi celle de mon amitié avec Xu Jun, qui a ouvert pour moi un horizon sans limites. Je ne prétends pas connaître la Chine — il y faudrait plusieurs vies —, mais le petit peu que j’ai compris, par les livres, par la vie de tous les jours, par les rencontres, je le dois à Xu Jun, qu’il soit remercié ici.»
Au-delà de votre intérêt personnel pour la Chine, pensez-vous nécessaire d’établir un pont culturel entre les deux extrémités de l’Eurasie ?
J’ai éprouvé depuis mon enfance, à la lecture du récit de Marco Polo, une grande curiosité pour ce qu’on appelle communément l’« Orient », et cette curiosité exotique s’est transformée en intérêt intellectuel plus tard, à la lecture des textes importants, de la Chine, du Japon ou de l’Inde. Ces textes m’ont donné le sentiment que les sociétés européennes (communément appelées « Occident ») étaient incomplètes parce qu’elles n’avaient pas accepté les propositions venues de l’Asie, et même qu’elles avaient dénigré ces propositions dans l’ensemble, comme si cette part comportait un risque. Ainsi, encore aujourd’hui, il y a une grande méfiance et un grand préjugé à propos de tout ce qui est venu de la Chine, sans doute plus qu’au temps de Marco Polo ou même d’Alexandra David-Néel (elle fut la première à publier les pensées du philosophe Mozi, un génie comparable à Leonard de Vinci, qui reste malgré cela quasiment inconnu en Europe).
Vous faites l’éloge du livre sous sa forme papier. Comment envisagez-vous l’articulation entre le livre papier et les nouveaux supports numériques ?
Pour moi cela n’est pas en contradiction, la lecture sur écran est un des moyens d’accéder au livre, mais j’appartiens à une génération qui lisait en bibliothèque, et je préfère ce support — de même que je préfère écrire à la main, au stylo à encre sur du papier.
Vous semblez opposer mondialisation et internationalisation…
Je ne crois pas que la « mondialisation » soit un fléau, sauf si elle donne lieu à la domination d’une langue, ou d’une culture. Je suis un militant de l’« interculturel », comme d’un idéal qui est loin d’être atteint actuellement. Si on classe les États (à la manière d’Amartya Sen) selon leur capacité de réaliser l’interculturel, des pays comme la Bolivie ou l’Équateur apparaissent au premier rang, et je crains que la France ou les États-Unis soient au bas de l’échelle…
Vous abordez la question de l’art dans ses rapports avec la science. Estimez-vous que ces deux branches très divergentes puissent marcher main dans la main ?
C’est un des programmes phares de la Chine nouvelle, qui incite, par exemple, les étudiants en sciences à s’intéresser aux disciplines littéraires et à la culture. J’attends beaucoup de cette réforme, qui vient d’une culture historiquement plurielle, ou l’équilibre est la notion fondamentale.
Vous évoquez l’art comme indispensable à l’équilibre psychologique de l’humanité. Diriez-vous que le monde est menacé par un excès de rationalité ?
Je ne suis pas sûr que ce soit par excès de rationalité — après tout, pour prendre l’exemple de l’Orient (je n’aime pas ce mot mais il est pratique pour résumer la situation) il me semble que la pratique des sciences (astrophysique, sciences de la terre, sciences pures) permet de développer une autre forme de rationalité, qui n’exclut pas l’instinct, ni l’invention poétique. Plutôt que l’excès de rationalité, le danger serait dans l’excès de spécialisation. L’art lui-même est un exercice composite, où le réel et l’imaginaire se complètent — le poète Lu Ji l’a écrit, dans sa « Rhapsodie de l’art littéraire » (au 3e siècle) :
Grande est l’utilité de la littérature
Par quoi sont réunis les principes multiples.
Elle va à dix mille lieues sans obstacle
Elle est le gué qui traverse un million d’années...
L’ouvrage s’ouvre par un avant-propos de votre traducteur en chinois, Xu Jun. Un traducteur peut-il être, d’une certaine manière, co-auteur d’une œuvre ?
J’ai rencontré Xu Jun il y a de nombreuses années, et au fil des ans cette rencontre s’est transformée en amitié, c’est-à-dire en dialogue, en échange culturel et affectif. C’est pourquoi j’ai eu envie d’appeler ce recueil « Causeries » plutôt que « Leçons » ou « Conférences », parce que ces textes sont le résultat de ces échanges, de ces mises au point, comme d’un livre collectif, une découverte mutuelle, une aventure.
Entretien réalisé avec J.M.G. Le Clézio à l’occasion de la parution de Quinze causeries en Chine.
© Gallimard