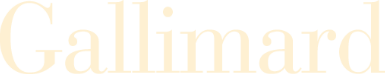Le grand jeu de Graham Swift. Entretien
Quand votre précédent roman, Le dimanche des mères, est devenu un best-seller mondial, vous avez songé à en rester là. Et maintenant, Le grand jeu va être publié. Que s’est-il passé ?
C’était de toute évidence une idée sans lendemain, rien de plus qu’un songe. Et ce qui s’est passé a été Le grand jeu ! Pour moi Le dimanche des mères avait représenté une expérience d’écriture si intense et, en tant que l’histoire de quelqu’un qui devient écrivain, un tel hommage à tout ce en quoi je crois au sujet de la fiction, alors comment pouvais-je aller plus loin ? Je savais que c’était un livre que je n’aurais pu écrire sans tous ceux que j’avais écrits antérieurement, et j’ai pris conscience comme jamais auparavant que j’avais une « œuvre ». J’ai donc à nouveau eu le sentiment que Le dimanche des mères pouvait marquer un point d’arrêt. À bien des égards je me fais une idée romantique de l’écriture – Le dimanche des mères a pour sous-titre « Romance » –, mais je ne suis pas romantique au point de croire que les écrivains doivent « continuer jusqu’à la fin », qu’ils sont incapables de dresser l’inventaire de ce qu’ils ont accompli et de penser : Bon, peut-être ai-je achevé mon œuvre, elle est là. Peut-être pourrais-je prendre ma retraite. Shakespeare l’a bien fait !
Mais à vrai dire, l’écriture ne marche pas ainsi. Il me suffit de me souvenir qu’à une époque, je n’avais aucune idée que j’écrirais Le dimanche des mères – pas la moindre étincelle. Et puis un jour, c’est « advenu ». Soudain, et avec l’extraordinaire sensation que c’était plus fort que moi, j’écrivais ce roman. Je ne me posais plus la question : « Que vais-je faire après ? » Je suis écrivain depuis assez longtemps, j’ai écrit plus d’une douzaine d’œuvres de fiction, mais je ne comprends pas mieux aujourd’hui qu’à mes débuts comment vient l’inspiration pour un roman ou une nouvelle. C’est un mystère. Cela advient, tout simplement. J’ai appris, souvent à mes dépens, que l’on ne peut pas écrire seulement par la force de ses intentions, de sa volonté et de sa détermination, si vertueuses puissent-elles paraître. Cela advient, tout simplement. Après Le dimanche des mères, je me suis tout à fait détendu. Je n’aurais aucune intention. Rien ne m’obligeait à écrire quoi que ce soit, à moins que quelque chose ne me vienne mystérieusement et ne m’y incite.
C’est bien ce qui s’est passé avec Le grand jeu. Je n’avais rien prévu. Je me suis surpris à écrire ce roman, exactement comme cela avait été le cas pour Le dimanche des mères. Je suis très fier de tout ce que j’ai publié, mais à ma fierté se mêle une perplexité sincère. Je peux me dire : à une époque, aucun de ces livres n’existait. Maintenant ils sont tous là. Ils sont advenus. Si je dis qu’ils sont « advenus, tout simplement », je sais qu’il y a un mystère plus profond auquel je ne peux échapper : d’une façon ou d’une autre, c’est moi qui les ai fait advenir. Mais c’est une question à laquelle je ne peux vraiment pas répondre, dont je ne mesure même pas toute la portée.
Dans Le grand jeu, un artiste de music-hall et un magicien tombent amoureux de la même femme durant l’été 1959. En quoi le strass et les paillettes du show-business des années 50 vous intéressent-ils ?
J’ai grandi dans les années 50 et j’étais adolescent dans les années 60 – une excellente époque pour vivre son adolescence. Je n’en avais sûrement pas conscience alors, mais c’était une période d’importants changements socio-culturels, bien sûr précédés par une guerre catastrophique dont certaines conséquences matérielles sont gravées dans ma mémoire, et en un sens, je garde l’impression que cette guerre est juste derrière moi. Mais dans les années 50, l’ancien monde perdurait, alors même que le nouveau gagnait du terrain. Je pense que quelque chose de similaire s’est produit – peut-être avec encore plus d’acuité – dans les années 20 où se déroule Le dimanche des mères. Un immense bouleversement traumatisant avait eu lieu, et le désir d’un retour à un état antérieur se faisait sentir, en même temps que la marche vers l’avenir s’accélérait. L’idée même du Dimanche des mères, de cette autorisation donnée aux servantes de rentrer chez elles pour voir leur mère – une coutume qui avait en réalité « fait son temps » –, est un bon exemple de cette incongruité historique.
Dans les années 50, il y avait la radio, mais la télévision était encore une nouveauté pour la plupart des gens, si bien que le spectacle vivant se perpétuait, en particulier la tradition du théâtre de « variétés », du divertissement populaire sur une scène, lui-même une continuation du « music-hall ». D’ailleurs la radio et la télévision ont longtemps essayé de maintenir cette tradition, de la transporter dans le salon familial. L’un des derniers bastions du spectacle de variétés a été le bord de mer, dans des théâtres qui pouvaient même se trouver sur une jetée – comme celle de Brighton. Les années 50, et même le début des années 60, était encore une époque où la majorité des Britanniques, à moins d’être riches, ne voyageaient pas. L’idée de prendre des vacances à l’étranger, ce qui va désormais de soi, aurait été pour moi, jeune garçon des années cinquante, totalement chimérique. Même pour mes parents. Je m’attendais parfaitement à ne jamais voir un autre pays. Mon père n’avait quitté le nôtre qu’à cause de la guerre. Tout cela a changé, et très rapidement, au milieu des années 60. Mais pendant un certain temps, la plupart des gens sont allés en vacances – une fois par an, et seulement s’ils avaient de la chance – à la mer. La Grande-Bretagne a beaucoup de côtes. C’était le terrain de jeux de la nation, dont faisaient partie les théâtres sur les jetées, les spectacles de stations balnéaires. Pour beaucoup de Britanniques, ils étaient indissociables des vacances.
Toute personne qui lit mes œuvres connaît ma fascination pour le bord de mer. Le grand jeu n’est pas mon premier roman à s’en inspirer. D’ailleurs Making an Elephant, mon recueil d’essais, en comporte un qui s’intitule « I Do Like to Be Beside the Seaside », le premier vers d’une chanson de music-hall célèbre (dans mon pays). Le cœur du problème, selon moi, c’est ce paradoxe fondamental : les gens vont sur le littoral pour s’amuser, se détendre, or il s’agit d’un territoire où les éléments, la terre et l’eau, se rencontrent, où il existe une précarité implicite. Et rien ne peut être plus emblématique de cette précarité qu’une jetée, cette fragile structure construite au-dessus des flots, où les gens affluent pour prendre du bon temps, même en assistant à un spectacle tandis que les vagues se brisent sous leurs pieds.
J’ajouterais qu’en tant qu’écrivain, j’ai toujours eu un faible pour le théâtre, pour les acteurs et les artistes de music-hall. Tous les écrivains ne diraient pas cela. Personnellement, je n’aurais jamais pu être acteur et je suis très heureux d’être écrivain, mais je ne crois pas qu’il y ait une différence radicale entre les deux. Nous essayons les uns et les autres de sortir de nous-mêmes pour habiter un territoire imaginaire. Et même si l’on peut prétendre que l’écriture requiert un certain courage, une certaine présomption – écrire un livre et l’offrir au monde ! –, c’est une activité très sûre, comparée au fait de monter sur les planches dans le but de conquérir le public. J’admire l’audace que cela demande, et j’admire aussi la capacité de ces artistes à faire « advenir » quelque chose sur scène.
Je suis très ouvert au « divertissement ». Tous les écrivains ne diraient pas cela non plus. Certains verraient même le divertissement comme une quête plutôt de bas étage, vulgaire. Mais qu’ai-je envie d’offrir à mes lecteurs ? Je veux les divertir, leur faire plaisir. Le divertissement et le plaisir ne prennent pas obligatoirement la forme d’une chanson et de quelques pas de danse – bien que l’on chante et que l’on danse beaucoup dans Le grand jeu. Il est parfaitement possible d’être diverti par les choses les plus graves, de vibrer pour elles, et, par respect pour mes lecteurs, pour leur ouverture d’esprit et leur expérience de la vie, voilà le genre de divertissement que je veux leur offrir. Il est parfaitement possible de vibrer même pour les choses les plus douloureuses. Pour revenir à Shakespeare, pourquoi allons-nous voir des tragédies ? Parce que nous y prenons plaisir.
Le théâtre de variétés, comme Hamlet ou Macbeth, a sa place sur le vaste éventail du divertissement. Certains iront sans doute jusqu’à dire que le théâtre de variétés est très présent chez Shakespeare. Celui-ci mêle constamment la comédie à la tragédie. J’espère qu’il y a toujours une veine comique dans mes œuvres, peu importe leur gravité. Et qui donc a prononcé ce vers qui nous rappelle le poids de l’existence autant qu’il nous en libère : « Le monde entier est une scène » ? Pour revenir à votre question, « au strass et aux paillettes du show-business des années 50 » : bien sûr que j’aime tout cela. Bien sûr que j’aime Evie, l’assistante du magicien, quand elle sort de toutes ces boîtes avec ses plumes, sa séduction et son éclat, les bras levés, pour offrir « son moi éblouissant, invulnérable ». Qui ne l’aimerait pas ?
Vous avez placé en épigraphe de ce roman une citation de Joni Mitchell : « Ce sont les illusions de l’existence qui me reviennent. » Que signifie pour vous cette citation ?
Le mot « illusion » apparaît plusieurs fois au cours du roman, dans le contexte spécifique de la magie, mais après le vers que je cite, la chanson de Joni Mitchell continue : « I really don’t know life at all » – Je ne sais vraiment rien de la vie. Ce n’est pas mal de faire preuve d’une telle sincérité, surtout si l’on est en vie depuis un certain temps. Et même si cela peut sembler bizarre, ce n’est pas une mauvaise hypothèse de travail pour un écrivain. Tout est un mystère extraordinaire.
Entretien accordé par Graham Swift aux Éditions DTV en Allemagne à l'occasion de la parution du Grand jeu.