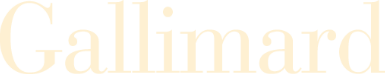Raymond Queneau (1903-1976)
Romancier et poète, cofondateur de l'OuLiPo, Raymond Queneau fut également éditeur. Entré aux Éditions Gallimard comme auteur avec Le Chiendent en 1933, il devint lecteur à partir de 1938, traducteur puis membre du comité de lecture. Il y dirigea après-guerre « L'Encyclopédie de la Pléiade ». Placé au cœur de la scène éditoriale par son élection au jury Goncourt en mars 1951, il fut l’une des dernières grandes figures de la « NRF de Gaston ».
« Ma mère était mercière et mon père mercier. »
Telle est l'introduction à sa biographie qu'avait livrée un jour Raymond Queneau. Il est né au Havre en 1903, où il commence ses études. Puis il entre en faculté de lettres à Paris où il suit le cours d'Alexandre Kojève sur Hegel, et obtient sa licence de philosophie. De 1925 à 1927, pendant son service militaire, il s'initie à ce qu'il appellera la langue verte des « crocheteurs du Port-au-Foin ». Il collabore à La Révolution surréaliste mais, dès 1929, et pour des raisons personnelles, il rompt avec le mouvement d'André Breton. Après un voyage en Grèce en 1932, lors duquel Raymond Queneau est frappé par l'hiatus entre la langue parlée et la langue « littéraire » qui reste fidèle au grec ancien, il publie son premier roman, un roman-poème, Le Chiendent, dans lequel on trouve cette phrase qui apparaît comme une critique interne de l'ouvrage : « Sa complexité apparente cachait une simplicité profonde. » C'est à l'occasion de la parution du Chiendent qu'est créé le prix des Deux-Magots, dont Queneau est le premier lauréat. Suivent trois romans autobiographiques : Les Derniers jours (1936) ; Odile (1937) ; Les Enfants du limon (1938), dans lequel est intégrée une enquête sur les « fous littéraires ».
Après avoir été employé de banque et vendeur, il entre aux Éditions Gallimard comme lecteur d'anglais en 1938 et se consacre à l'écriture. Il fonde avec Henry Miller la revue Volontés, et publie Un Rude hiver en 1939.
Il connaît son premier succès littéraire avec Pierrot mon ami, en 1942. Après Loin de Rueil (1945), Saint Glinglin (1948), l'extravagant Dimanche de la vie (1952), c'est, bien sûr, et avant la publication des Fleurs bleues (1965), par Zazie dans le métro (1959), surtout, que son œuvre romanesque s'est fait connaître. Il appartenait au Collège de Pataphysique depuis 1950, il présidait aux travaux de l'Oulipo (OUvroir de LIttérature POtentielle) qu'il avait créé avec François Le Lionnais, il était membre de l'Académie Goncourt depuis 1951 et, depuis 1954, assurait la direction de la publication des Encyclopédies de la Pléiade.
Parallèlement à toutes ces activités — dont le moins que l'on puisse dire est qu'elles requièrent des compétences sinon contradictoires au moins diverses —, Raymond Queneau écrit son œuvre romanesque d'abord, son œuvre poétique, depuis Chêne et chien, la même année que Odile, jusqu'aux Sonnets de 1960, ensuite tout un éventail de figures, de jeux stylistiques, rhétoriques ou typographiques, tels les célèbres Exercices de style (1947) — quatre-vingt-dix-neuf variations stylistiques sur la même insignifiante anecdote —, tels encore Les Temps mêlés de 1943 qui reprennent trois récits sous trois genres littéraires différents (poésie, prose et théâtre) ou les Cent mille milliards de poèmes de 1961. À part, enfin, si tant est que chaque ouvrage de Raymond Queneau ne soit pas « à part », irréductible à un genre, à une esthétique, à part, donc, sont la Petite cosmogonie portative (1950), en raison de son inspiration scientifique, ou les études critiques réunies dans Bâtons, chiffres et lettres (1965), ou les récits pseudonymes — et leur obscénité — rassemblés sous le titre Les Œuvres complètes de Sally Mara, datant de 1962 et composés d'un roman (On est toujours trop bon avec les femmes), d'un Journal intime et d'une sorte de recueil d'aphorismes (Sally plus intime).
Où classer, maintenant, les chansons ? les traductions ou textes pour le cinéma ? tous ces écrits dits « mineurs » réunis, après sa mort survenue en 1976, dans Contes et propos (1981) ?
Tout, il aura joué de tout, et — osons le dire, avec quel sérieux ! —, il aura joué de toutes les formes — du simple aphorisme au roman, en passant par l'ode ou la ballade, le proverbe ou le texte critique —, et de tous les styles, depuis les formules les plus sobrement littéraires jusqu'à l'écriture phonétique, en passant, là encore, par des monologues en argot, des contrepèteries ou les dialogues comme « pris sur le vif » qu'échangent les personnages de son univers romanesque : bistrotiers, boutiquiers, petits marlous et cartomanciennes, hurluberlus et autres Pierrots lunaires.
Documents
Autoportrait fictif : l'arrivée à Paris
« Lorsque Vincent Tuquedenne débarqua du train du Havre, il était timide, individualiste-anarchiste et athée. Il ne portait pas de lunettes bien qu'il fût myope, et laissait croître sa chevelure afin de témoigner de ses opinions. Tout cela lui était venu en lisant des livres, beaucoup de livres, énormément de livres.
Supportant mal au bout de son bras le poids d'une valise trop lourde pour ses muscles inexercés, il marcha d'un pas hésitant vers le petit hôtel de la rue de Caboul, près de la gare Saint-Lazare [...].
Il ne séjourna pas longtemps en sa mansardeuse chambrette et se lança dans le Nord-Sud pour se rendre au quartier Latin. Il commit une erreur en descendant à Rennes, croyant qu'il pouvait changer pour Saint-Michel, mais fut cependant stupéfait de se débrouiller si bien. Il prit sa première inscription de licence ès lettres, nouveau régime. Il y passa sa journée, considérant avec mépris la folle jeunesse qui l'entourait, avide de diplômes et stupidement chahuteuse. Ce n'était pas très différent de la rentrée des classes au lycée du Havre.
Vers les quatre heures, il se trouva en possession d'un livret universitaire et d'une carte d'étudiant ornée de sa photographie. (Il ne se trouvait pas mal sur cette photo ; il y avait bien l'air d'un lecteur de Stirner et de Bergson.) L'horloge de la Sorbonne lui apprit qu'il était quatre heures cinq ; il ne sut que faire jusqu'au dîner. Il monta le boulevard Saint-Michel jusqu'à la rue Gay-Lussac, puis le redescendit jusqu'à la Seine. Ensuite il le remonta jusqu'à la rue Gay-Lussac, puis le redescendit jusqu'à la Seine. Il essaya le trottoir de gauche après avoir arpenté le droit.
La nuit se coucha sur la ville. Vincent Tuquedenne continuait à tuer le temps à coups de talon, à piétiner ces minutes désastreusement vides qu'il ne savait même pas remplir avec des cafés-crème. À sept heures tapant, il pénétra dans le Chartier de la rue Racine, à lui conseillé par son père, et y absorba, assis à une table au premier étage à gauche en montant, un filet de hareng à l'huile, une andouillette aux pommes, un mendiant et un quart de vin rouge. Puis il alla prendre l'AI place Saint-Michel et rentra sans difficulté à l'Hôtel du Tambour, comme se nommait cette cassine.
Lorsqu'il eut derrière lui refermé la porte de sa chambre il constata qu'il n'y avait là que lui-même. Il essaya de détruire sa solitude en rangeant ses objets de toilette, ses vêtements, ses livres. Il tenta de s'exalter en pensant qu'il logeait rue de Caboul et que cette ville est la capitale de l'Afghanistan, mais sans y réussir. Il entendait tout le temps fonctionner la chasse d'eau. Il installa une petite table sous la lampe, prit un cahier tout neuf et s'assit devant la page blanche qu'il égratigna de son écriture. Vincent Tuquedenne savait que ce jour était un grand jour et qu'il inaugurait une nouvelle période de sa vie. Il lui fallait donc un cahier neuf pour son journal. »
Raymond Queneau. Les Derniers jours, Gallimard, 1936
Raymond Queneau par Michel Leiris (1962)
« Un autre trait qui me frappe chez lui, c'est son horreur de l'exotisme. Vous savez, bien sûr, qu'il n'aime guère les voyages, et cela peut surprendre puisqu'on lui connaît une curiosité inlassable à l'égard de toutes choses. Sans doute regarde-t-il l'exotisme — cette mythification de ce qui est étranger — comme une mystification pure et simple. Je me rappelle que nous étions allés en vacances ensemble à Ibiza, dans les Baléares, juste à la veille de la guerre d'Espagne. Ni Queneau ni sa femme ne connaissaient l'Espagne, alors que j'en étais un admirateur fervent. À Barcelone, je les ai emmenés un peu partout. Nous avons vu des églises, des musées, des cabarets, des marchés. Nous avons assisté à une course de taureaux, l'une des plus médiocres que j'aie jamais vues.
Tout se passa un peu comme dans les histoires de tables tournantes, où pour que rien n'arrive il suffit de la présence d'un incrédule. J'ai senti assez vite que Raymond n'était pas à mon diapason, qu'il se fermait de plus en plus. Je pense qu'il était positivement gêné par mon obstination dans l'enthousiasme. Franchement déçu, il refusait, quant à lui, de se laisser leurrer par le clinquant du pittoresque. Je crois qu'il est encore exactement le même à ce point de vue. Quand il voyage, c'est moins pour découvrir du nouveau que pour retrouver, ailleurs, son folklore familier, — ce folklore tout personnel que l'usage mi-sérieux mi-ironique d'une ou de plusieurs rhétoriques lui permet de transformer, magistralement, en une poésie au plus haut point singulière et efficace. »
Michel Leiris, dans Jacques Bens. Queneau, « La Bibliothèque Idéale », 1962
© Éditions Gallimard