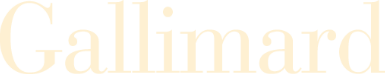Jean d'Ormesson (1925-2017)
Élu à l'Académie française en 1973 au fauteuil de Jules Romains, l'écrivain et journaliste Jean d’Ormesson est entré dans la Pléiade en 2015. Il est l'auteur de nombreux romans et récits où la fiction se mêle souvent à l’autobiographie. Il a ainsi publié, entre autres, Au revoir et merci (1966), La Gloire de l'Empire (Grand prix du roman de l'Académie française 1971), Au plaisir de Dieu (1974), Histoire du Juif errant (1991), Le Rapport Gabriel (prix Jean Giono 1999) et, dernièrement, Je dirai malgré tout que cette vie fut belle et Guide des égarés (2016). Son dernier livre, Et moi, je vis toujours, a paru dans la collection Blanche en janvier 2018.
|
Au commencement « J'ignorais à peu près tout du monde de l'édition, mais, comme beaucoup de jeunes gens, j'avais grandi au milieu des couvertures blanches à filet noir et rouge de la NRF. Tous ceux que j'aimais, Proust, Hemingway, Aragon, et tant d'autres, étaient chez Gallimard. Pour moi, la NRF, c'était la terre promise. Chardonne prétendait même que le paradis n'était qu'une vague annexe des jardins de la maison Gallimard. Donc, j'ai déposé mon manuscrit rue Sébastien-Bottin. Je l'ai remis à la standardiste. J'aurais pu dénicher quelqu'un pour le donner à l'une des grandes figures de la maison, mais l'idée ne m'a pas traversé l'esprit. J'aurais trouvé inconcevable de me signaler à ces étoiles de la littérature. Naturellement, j'ignorais que, la maison Gallimard travaillant pour l'éternité, son temps n'était pas le temps des autres, et que ses délais de réaction et donc de réponse étaient assez longs. D'ailleurs, j'ignorais tout des délais habituels. J'ai attendu trois semaines. Puis, lassé d'attendre, un samedi soir, j'ai pris un double du manuscrit et je l'ai déposé, en face de Gallimard, rue de l'Université, chez Julliard. Le dimanche matin à sept heures, le téléphone sonnait. J'habitais encore rue du Bac, chez mes parents. C'était René Julliard qui avait lu le livre dans la nuit et me proposait de signer un contrat. Bien sûr, cette hâte ne signifiait pas que j'avais écrit un chef-d’œuvre, mais plus probablement que L'Amour est un plaisir s'inscrivait un peu, en moins bien, dans la ligne de Sagan, qui avait beaucoup de succès à l'époque. Et sans doute est-ce la même raison qui a poussé peu après Gaston Gallimard à me dire qu'il aurait été heureux de publier ce livre, si seulement j'avais daigné attendre. […]
Quand Julliard est mort, je me suis naturellement tourné vers Privat, avec lequel j'entretenais depuis longtemps déjà des relations confiantes. Il avait bien aimé les petits livres de la première partie de ma vie. Je lui ai apporté le fruit monstrueux de mes rêves de toujours et de mes travaux de l'Unesco, qui était La Gloire de l'Empire. Et là j'ai vu Privat, cet homme si ouvert et si aimable, s'affaisser sur son fauteuil, l'air horriblement gêné. C'était comme si j'étais venu lui proposer un traité de métaphysique ou un ouvrage pornographique. Lui avait toujours voulu du d'Ormesson, mais ça, vraiment, ça ne ressemblait à rien. Après un court moment d'hésitation, il m'a annoncé sans enthousiasme qu'il publierait ce livre, bien sûr, mais qu'il n'y croyait pas beaucoup. Je l'ai immédiatement repris, pour le donner à Caillois. Il m'avait fallu cette rebuffade pour me décider à le faire, alors que pourtant je voyais Caillois tous les jours. En le lui remettant, j'avais de la sueur sur les tempes et pendant qu'il le lisait je ne tenais pas en place. Et puis, je l'ai vu émerger plutôt radieux, content de me voir sortir de l'ornière de la facilité, et il a porté La Gloire de l'Empire chez Gallimard. C'est La Gloire de l'Empire qui m'a valu, sans doute, l'Académie française. Et aussi l'entrée au comité de lecture de Gallimard, en 1971 ou 1972. J'ai vécu là un grand moment. Je le dis avec une certaine émotion, parce que ce cénacle représentait beaucoup pour moi. À la vérité, il représentait, tout simplement, l'univers de l'essentiel, l'univers de ce qui vaut d'être fait, des livres, alors que tant d'activités humaines ne méritent pas d'être poursuivies. Et moi, je me sentais terriblement indigne, mais j'étais heureux et fier de pouvoir contribuer à cette œuvre collective. Je voyais la maison Gallimard comme une forteresse de la littérature française et le comité de lecture comme la plus haute de ses tours de guet. Et puis je suis sensible aux légendes, et il me semblait voir autour de la table les ombres de Gide, de Rivière, de Schlumberger, de Malraux, de Drieu, de Martin du Gard, de Paulhan, Gaston Gallimard imposant Simenon sur les conseils de Gide, Malraux défendant Dashiell Hammett, Nimier partant pour Meudon retrouver Céline. Et autour de la table il y avait Arland, Dominique Aury, Caillois, Raymond Queneau que j'admirais beaucoup et que je ramenais souvent à Neuilly où il habitait, Michel Mohrt, pour qui j'ai une grande affection. » Jean d'Ormesson, François Sureau, Garçon, de quoi écrire, Gallimard, 1989. Pourquoi écrivons-nous ? « Pour l'argent ? Pourquoi pas ? Avec l'idée derrière la tête d'épater le bourgeois et les classes laborieuses, Drieu la Rochelle roulait des mécaniques : « Pour devenir riche et célèbre. » Et on trouverait, en effet, sans trop de peine, dans l'histoire de la littérature des chefs-d’œuvre nés de commandes. Du hasard. Des circonstances. Et de l'appât du gain. Il est pourtant permis de se demander si c'est la façon la plus sûre de produire de bons livres. Quelques-uns soutiennent qu'ils écrivent parce qu'ils ne savent rien faire d'autre. Beaucoup s'en tirent par des pirouettes. Valéry assurait qu'il écrivait par faiblesse et par distraction. Et Borges, pour quelques amis et pour adoucir le cours du temps. Bon. Cherchons encore un peu. Il n'est pas impossible que nous écrivions parce que nous ne sommes pas seuls et pour ne pas rester seuls. Pour créer des liens plus durables et plus forts. Pour monter un peu plus haut dans la pensée de quelques autres et dans leur estime. Vous voyez ce qui se cache derrière toutes ces grimaces : un obscur élan qui ressemble à l'amour. Mozart, d'après la légende, demandait à qui le pressait de lui jouer quelque chose : « Dis-moi d'abord que tu m'aimes. » Un double lien se forge entre l'auteur et ses personnages, entre l'auteur et son lecteur. Racine aime Phèdre, qui se croit criminelle. Voltaire aime Candide, qui est une sorte de benêt. Flaubert aime Bouvard et Pécuchet, qui sont des imbéciles, et Mme Bovary, qui est hystérique et insupportable. Et nous, nous aimons Ulysse en dépit de ses ruses ou peut-être à cause d'elles, nous aimons don Quichotte ou l'Idiot en dépit de leurs délires ou peut-être à cause d'eux. Nous aimons le Cid, Alceste et Philinte qui sont à l'opposé l'un de l'autre, Gavroche, le héros, Rastignac, l'arriviste, les filles abjectes du père Goriot et l'invraisemblable duchesse de Langeais, Julien Sorel qui prend la main de Mme de Rénal ou Fabrice del Dongo et Frédéric Moreau. Et mon amie Nane qui ne cultive pas la vertu. Et tant de jeunes filles dans des romans anglais, et de saintes, et de voyous, et de vieillards pernicieux, et d'enfants en train de mourir. Et nous aimons Hugo, et Musset, et Baudelaire, et Toulet comme nous aimons Bach ou la légende de sainte Ursule avec ses navires en fête et ses ambassadeurs, avec l'annonce en songe de la gloire du martyre. Si la littérature, au même titre que l'art, n'est pas une histoire d'amour, qu'est-ce que c'est ? J'ai longtemps espéré – je le raconte dans l'un ou l'autre de mes gribouillages de jeunesse – que de jeunes femmes penseraient à mes livres et à moi dans les bras de leur mari ou de leur amant. Le temps – notre grand maître – est passé sur ces rêves et ces provocations. J'ai reçu, en un demi-siècle, pas mal de lettres de lecteurs ou de lectrices. Plusieurs me disaient qu'un enfant, une mère, un mari ou une femme, un être aimé plus que tout tenait La Douane de mer ou Au plaisir de Dieu entre les mains à l'instant de mourir. Et ce lien tissé de larmes me rendait plus heureux que toutes les promesses et toutes les illusions de la postérité. » Jean d'Ormesson, C'était bien, Gallimard, 1989. Hommage de l'éditeur « La culture est comme une conversation qu’on a plaisir à faire durer. » En novembre 2016, Jean d'Ormesson remettait le grade de Commandeur de la Légion d'honneur à Antoine Gallimard. Ce fut l'occasion pour l'éditeur de rendre hommage à son œuvre.
« Chers amis, cher Jean
Et tu as trouvé dans cette Maison des interlocuteurs pour t’en convaincre, grands connaisseurs également de la littérature universelle, des textes sacrés, des mythes fondateurs. Je pense bien sûr à l’excellent Roger Caillois, auprès duquel tu as travaillé à Diogène pendant vingt-cinq ans. Et il y a eu aussi auprès de toi Michel Mohrt ou Raymond Queneau, qui ont œuvré en faveur de ton entrée dans la Maison pour La Gloire de l’Empire en 1971 ; je pense aussi à Étiemble ou à Jean Grosjean, qui a été le principal lecteur de tes manuscrits. Et tu as fait un bref passage à notre comité de lecture, avant de prendre la direction du Figaro. Marguerite Yourcenar, que tu as fait entrer si vaillamment à l’Académie française, a été aussi une rencontre importante pour toi.
Le vrai jardinier Merci à tous. » Antoine Gallimard, novembre 2016 © Éditions Gallimard |